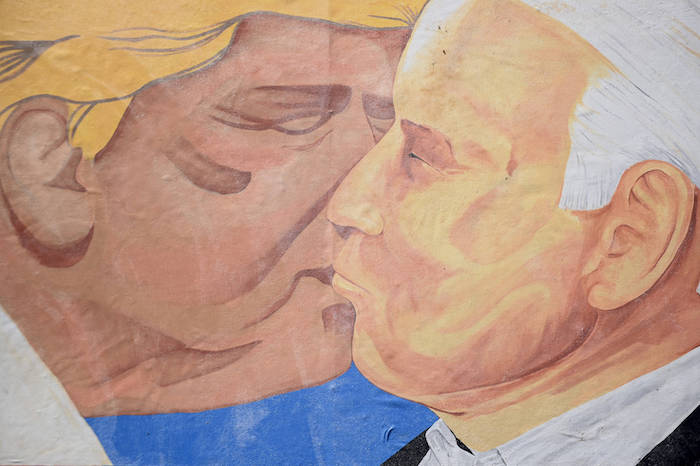Alors que les Polonais auraient pu laisser passer les immigrants amenés par les Biélorusses, qui ne comptent pas rester en Pologne, le gouvernement polonais a décidé de les affronter. Pourquoi ne pas avoir joué la facilité ?
Arrêtons-nous un instant sur ce constat. Nous avons une crise à la frontière orientale polonaise parce que la Pologne résiste : si elle n’avait rien fait, nulle crise politique ne serait advenue. Une nouvelle crise d’ordre humanitaire aurait frappé l’Union européenne justifiant, comme en 2015, l’impératif d’accueil porté par « nos valeurs ».
La question est donc : pourquoi la Pologne résiste-elle, ne laisse-t-elle pas passer ces migrants venus chercher asile en Allemagne ou en France ? La question s’était d’ailleurs posée en 2015, lorsque la Hongrie avait opposé barbelés et soldats aux migrants venus du Moyen-Orient et passés par l’ex-Yougoslavie. Pourquoi résister, au risque d’être pointé du doigt par les instances et ONG internationales ?
Premier élément de réponse : la Pologne et la Hongrie prennent à cœur leur rôle de « garde-frontières » de l’Europe, vieil écho à un mythe national que ces deux nations ont en partage : celui d’avoir été longtemps les “boucliers” de l’Europe chrétienne face aux invasions orientales. Face à cette nouvelle crise migratoire, un autre arrière-fond historique anime la Pologne : celui de la petite nation luttant pour sa souveraineté et, en l’occurrence, derrière les instrumentalisations de Minsk, face à l’impérieuse puissance de Moscou.
La volonté de défendre cette souveraineté, et les frontières qui l’incarnent, est gouvernée par cette double référence historique ; la nation garde-frontière de l’Europe et la petite patrie fragile, où souveraineté et liberté sonnent comme une parenthèse enchantée, sitôt ouverte déjà refermée, tel un âge d’or révolu (« La Pologne n’a pas encore disparu », rappelle les premiers vers de l’hymne polonais).
Notons enfin que Varsovie, tout comme du reste Budapest, derrière ses accents « souverainistes », défend une certaine idée de l’Europe ; une Europe-civilisation incarnée par des repères (moraux, culturels) et frontières jugés intrinsèquement dignes d’être préservés.
Dans ce cas précis, cette défiance vis-à-vis de la Russie de Poutine n’est-elle pas ce qui vaut à la Pologne l’inattendu soutien de l’Union européenne, qui a traité la Hongrie avec la dernière rigueur ?
Les mêmes qui, hier, vilipendaient la Pologne pour ses déclarations « souverainistes » et son refus de l’immigration (oubliant que le pays de Solidarnosc a accueilli, depuis plusieurs années, des milliers de familles biélorusses fuyant le régime de Loukachenko), la trouvent aujourd’hui très sympathique. À croire que ce qui les anime est moins la solidarité avec la Pologne ou la défense de l’Union européenne que leur anti-poutinisme… Constat qui appelle une réflexion : quelle est la politique orientale, l’ostpolitik de l’Union, sinon celle que lui dicte son prisme « otanien », entretenant une forme de conflit aussi larvé que contre-productif avec Moscou ?
La crise biélorusse pose, une fois de plus, la question du rapport de l’Europe à ses propres frontières, et donc à son voisinage. Elle traduit l’échec de la « Commission géopolitique » voulue par sa présidente, Ursula Von der Leyen. Une Commission sans consistance, fonctionnant sur fond d’admonestations et de sanctions, comme celles ayant visé les « atteintes aux droits de l’homme » de la Biélorussie, et dont il serait légitime de se demander quelles finalités en guidèrent l’édiction, sinon un besoin de légitimation aussi bien de son existence – dérisoire, il faut bien le dire, sur le terrain diplomatique – que de sa propre politique intérieure, centrée elle aussi sur la défense de « valeurs » opposées à la face des régimes « autoritaires ».
Si l’UE soutient la Pologne dans son combat contre une immigration orientale, elle accuse la Hongrie de violer le droit d’asile et les principes fondamentaux de l’UE quand les Hongrois proposent d’installer des filtres légaux dans les pays d’où viennent les immigrants…
Le grand problème de l’Union européenne, c’est qu’elle ne voit pas que son idéologie la désarme ; que les valeurs qu’elle proclame, loin de défendre l’Europe, consacrent notre impuissance collective. Si aujourd’hui les migrants sont bloqués aux portes de l’UE et que la Russie commence déjà à les rapatrier, c’est bien parce qu’un État-nation déterminé, la Pologne, armé de sa légitimité historique et de son souci pour la sauvegarde de ses frontières, a décidé de tenir bon. Quelle leçon allons-nous tirer de ce volontarisme national, qui permet à toute l’Europe de se protéger d’une nouvelle tentative de déstabilisation massive ?
Si Frontex avait été seule en charge de notre frontière orientale, nul doute que la donne aurait été toute autre. Frontex est pieds et poings liés par la rhétorique des « valeurs » européennes, ceux qui ne veulent voir, derrière les migrations, qu’un défi humanitaire répliquant notre esprit d’ « ouverture » et de tolérance.
Si nous voulons que, demain, l’Europe ne soit plus la proie d’instrumentalisations aussi manifestes que celles orchestrées par la Biélorussie de Loukachenko ou hier par la Turquie d’Erdogan, il nous faut d’urgence changer notre logiciel, permettre aux États frontaliers d’agir et à l’agence Frontex de faire son travail, sans risquer d’être accusée de « violer les droits fondamentaux », comme ce fut le cas en Grèce, l’été dernier, suite à la publication d’un rapport émanant d’ONG internationales et d’eurodéputés hostiles à tout refoulement de migrants.
D’un côté ces valeurs affirmées sont, somme toute, assez imprécises, de l’autre elles deviennent terriblement précises quand l’UE accuse quelqu’un de les avoir violées.
Une première tendance historique, d’obédience plutôt libérale, consiste à rattacher les hommes et l’organisation de leur Cité à des principes structurants mais vagues, tels que les droits de l’homme, la liberté ou l’égalité, tous listés à l’article 2 du Traité de l’Union européenne. Une seconde tendance, plus progressiste, très influente au sein des institutions communautaires, comme à la Commission de Bruxelles ou au Parlement de Strasbourg, cherche à réifier ces valeurs, à leur donner un caractère plus concret, opératoire. Depuis 2015, nous voyons cette tendance s’affirmer, chercher à donner de la substance à ces valeurs, pour donner à l’UE l’identité qui lui manque.
En 1991, Vaclav Havel, grand dissident antisoviétique et premier dirigeant de la Tchécoslovaquie démocratique, accusait l’Europe d’être « un monstre froid, bureaucratique et mercantile », à qui « il manque une dimension spirituelle ». Ce temps est révolu. Désormais, l’Europe a des valeurs et entend les affirmer, y compris en son propre sein. Lorsqu’en 2019 a été créé un commissariat visant la défense du « mode de vie européen », tout l’arc progressiste du parlement européen, de l’extrême-gauche aux libéraux du groupe Renew (où siègent les eurodéputés En Marche), s’est mobilisé pour en dénoncer les finalités, accusant Bruxelles de courir derrière les populistes, d’opposer aux migrants les termes xénophobes d’une identité surannée, fermée, voire dangereuse. Ursula von der Leyen avait rappelé que la défense du « mode de vie européen » visait bien la défense de principes universels, comme ceux relatifs aux « droits des minorités » et au « principe de non-discrimination », que menaceraient « nos adversaires de l’intérieur » (sic)… Comprendre : les populistes de l’Est et autres partisans d’une Europe du « repli ».
Ce recours intempestif aux « valeurs » permet à l’école supranationale de construire un cadre contestant la légitimité même de l’État-Nation ; de l’État comme cadre de l’action collective agissant dans des frontières forcément limitées ; de la Nation comme cadre culturel dessinant la cohésion intérieure d’un peuple fortifié par les siècles. Il permet à l’école supranationale de poser les bases d’une « société européenne », comme le dit très explicitement Ursula von der Leyen, enfin émancipée des vieux ancrages nationaux.
En même temps, l’article 4 du Traité de l’Union européenne dit qu’il faut respecter les identités nationales…
L’article 1 du traité de l’UE vise à « créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ». Il dessine, autrement dit, un processus. L’article 4 fixe, lui, des limites à ce processus, en appelant l’UE au respect des identités nationales des États membres, c’est-à-dire « leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles. »
Aujourd’hui, au sein de l’Union, il existe un rapport de forces entre les tenants de l’article 1, qui utilisent les valeurs de l’article 2 (droits de l’homme et des minorités, non-discrimination….) pour accélérer l’uniformisation du vieux continent et justifier l’extension continue du champ d’action des instances communautaires, comme celle de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), et les tenants de l’article 4, qui tout en participant au projet européen rappellent qu’il ne saurait effacer la diversité des nations.
Face à ce constat d’un rapport de force inhérent à l’ambiguïté des traités européens eux-mêmes, deux attitudes sont possibles : soit on fait comme si ce rapport de force reposait sur des tensions illégitimes, provoquées par les sombres desseins d’une nébuleuse populiste à combattre de toutes nos forces, et dès lors on continue de mépriser les raisons qui font le succès de cette nébuleuse : l’attachement des peuples à leur identité nationale ; soit on considère que ces identités nationales et les divergences politiques qu’elles contribuent à façonner sont légitimes, peuvent coexister avec certains projets européens, industriels par exemple (pour créer un « Google européen » ? des batteries électriques européennes ?), et dès lors on accepte que, de temps à autre, au gré des évènements, les États manifestent leur volonté de se préserver des élans supranationaux du parti fédéraliste.
Justement, chaque fois que la CJUE prend la parole, on a l’impression que la messe est dite et qu’il est hors de question qu’un État quelconque fasse valoir une quelconque spécificité nationale, même constitutionnelle. Jean Richard de la Tour, avocat général à la CJUE, explique que « l’Union risque de disparaître si chaque État interprète le droit européen à sa guise. » (Figaro, 19 novembre 2021). On sent quand même une volonté d’ignorer l’article 4…
Quand j’entends ce genre de déclaration, j’ai envie de dire à leurs auteurs : « Relisez les traités ! » Les traités rappellent que les États sont souverains mais transmettent à l’UE un certain nombre de compétences. Autrement dit, la primauté du droit européen s’applique dans le champ de compétences qui a été délégué à l’Union, comme par exemple sur les questions énergétiques ou de commerce extérieur, et seulement là.
Sur les questions énergétiques, l’UE a l’initiative et les États négocient puis transposent le droit européen, non sans disposer par ailleurs de quelques marges de manœuvre. Sur les autres sujets, les États gardent la main. En théorie tout du moins… Dans les faits, grâce à la jurisprudence de la CJUE, l’UE outrepasse régulièrement les limites théoriques de son champ d’action. Pensons à la décision de juillet dernier de la CJUE, visant à régler le temps de travail de nos militaires. De nombreux responsables français, comme Jean-Louis Borloo, ont, à raison, vu cette décision comme contraire aux traités européens, l’article 4 du TUE rappelant que la « sécurité nationale », dont la libre organisation de nos armées peut légitimement faire partie, « reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».
Lorsqu’un pouvoir outrepasse ses droits, l’institution de contre-pouvoirs s’impose. Lorsque le pouvoir s’incarne dans l’UE, l’institution de contre-pouvoirs s’incarne dans les États. Sortons d’une conception des contre-pouvoirs purement limitée au face-à-face entre l’État et ses citoyens. Élargissons-la aux relations entre l’échelon supranational européen et l’échelon national, pour penser à neuf la manière dont les États s’organisent et sont légitimes à le faire.
Face aux prétentions sans borne du juge européen, les États développent depuis des années des contrepoids « judiciaires », incarnée par l’action de leur cour suprême et le recours à la notion d’ « identité constitutionnelle », reconnue à l’article 4 du traité de l’UE. Les États sont également invités, par les traités, à développer des contrepoids « politiques », parlementaires. Rappelons que le traité de Lisbonne prévoit l’institution d’un mécanisme de « remontrances » permettant aux parlements nationaux, moyennant l’atteinte d’un certain quorum, de bloquer les législations européennes allant à l’encontre du principe de subsidiarité. Si dans les faits ce mécanisme n’est pas utilisé (faute de véritable intérêt des politiques pour la chose européenne ?), son existence rappelle que l’UE, contrairement à ce qu’affirment ses idolâtres, n’est pas pensée (dans les traités tout du moins) pour substituer aux États une hypothétique « souveraineté européenne » (la souveraineté réside dans le peuple, et il n’y pas un peuple mais « des peuples européens », rappelait le juge constitutionnel allemand en 2009), mais pour parvenir à concilier souveraineté nationale et intégration sectorielle. Intégration « jusqu’où ? » et « sur quel sujets ? » Ces questions sont consubstantielles à la construction européenne, mais elles n’obligent en rien à renoncer à nos différences nationales.
Ursula von der Leyen a quand même menacé en 2020 de poursuivre l’Allemagne suite à une décision de la Cour de Karlsruhe, au motif que « le droit européen prévaut sur le droit national ».
Karlsruhe contestait en effet l’extension des prérogatives de la BCE. En réponse : une procédure d’infraction contre l’Allemagne a été ouverte par la Commission. La plus haute cour de Bucarest a également rappelé au juge européen que la constitution roumaine primait. Le juge français, incarné par le Conseil d’État, a récemment contesté une décision de la CJUE qui restreignait la possibilité pour l’État d’utiliser les données numériques à des fins de renseignement. Il y a des tensions partout, pas simplement face aux méchants États polonais et hongrois…
L’Union européenne n’est-elle pas surtout en train de mener un combat culturel où l’Ouest essaye de s’imposer à l’Est, la construction européenne étant presque secondaire par rapport au triomphe des idées qu’elle porte ?
Il existe en effet une tentation impériale européenne incarnée par ce concept de « démocratie par le droit », où l’on aspire à uniformiser subrepticement, sous l’effet de la jurisprudence des cours de justice, les espaces nationaux.
Devant un parterre de journalistes réunis en 2011 pour le questionner, José Manuel Barroso utilisa une formule fort instructive : l’Union européenne, dit-il, n’est pas un État ni une organisation internationale, c’est un régime inédit : « un empire non-impérial ». Un « empire », c’est-à-dire donc une entité transnationale dominée par un centre, en l’occurrence Bruxelles ; « non-impérial », c’est-à-dire qui impose sa discipline à ses périphéries non par la force, comme dans les empires de jadis, mais par le droit. Droit émanant des cours de justice mais également d’une rhétorique révolutionnaire, instrumentalisant les droits de l’homme pour imposer des réformes sociétales sur la famille, l’éducation ou le modèle culturel des États. Le supranationalisme sociétal de la Commission, axé sur la défense des « droits LGBT », illustre cette tentation impériale, uniformisatrice, niant la diversité des peuples et de leurs valeurs.
Face à une telle entreprise, on comprend que la Hongrie et la Pologne, deux nations dont les élites ont connu l’impérialisme soviétique, qui ne remettait pas seulement en cause leur souveraineté politique, mais cherchait également à fabriquer un « homme nouveau », coupé de ses racines spirituelles et culturelles nationales, résistent et opposent à ses promoteurs (l’« homo bruxellicus », selon l’expression de Viktor Orban) le droit des peuples à perpétuer leur être national.
Propos recueillis par Philippe Mesnard
Diplômé en Histoire et en Science politique, Max-Erwann Gastineau est essayiste et chroniqueur politique. Spécialiste de l’Europe centrale, il est l’auteur de Le Nouveau procès de l’Est, paru en 2019 aux éditions du Cerf.