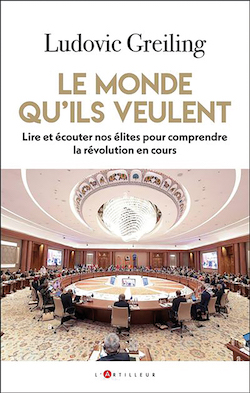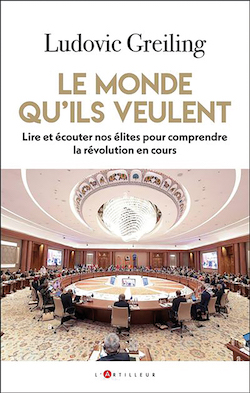Le bras de fer commercial lancé par Donald Trump, déjà entamé lors de son premier mandat, s’inscrit dans le cadre d’une politique assumée visant à réduire le poids et le pouvoir de l’économie transnationale.
L’affaire n’a pas été un sujet de discussions dans le grand public, mais elle a fait l’effet d’une bombe dans le secteur financier. Le 9 mars dernier, Donald Trump était interrogé par la chaine Fox News sur ses mesures douanières avec le Mexique, le Canada, l’Europe et la Chine. Ses annonces parfois erratiques sur les hausses de droits de douane ne risquaient-elles pas de faire dérailler la croissance économique et les marchés en créant de l’incertitude ? Le président resta insensible à cette inquiétude et porta calmement l’analyse sur un autre plan : « Pendant des années, les globalistes ont dépouillé les États-Unis et ont retiré de l’argent des États-Unis. Tout ce que nous faisons est d’en rendre une partie, et nous allons traiter notre pays équitablement […]. Je crois que si Kamala [Harris] avait gagné, toute cette idéologie, Biden, Obama, tout ce groupe de gens, s’ils avaient gagné, je ne pense pas que nous aurions encore un pays ». La journaliste se fit insistante : anticipe-t-il une récession cette année ? « C’est une période de transition, parce que ce que nous faisons est très important. Ça prend un peu de temps ». Et la Bourse ? « Écoutez, ce que je dois faire est de construire un pays fort. Vous ne pouvez pas vraiment regarder les marchés d’actions ».
« Une période de détox »
Cette interview, menée sereinement et sans effets de manche, « a provoqué un certain effroi dans la communauté financière, analysait quelques jours plus tard dans Les Échos le responsable de la gestion actions chez Edmond de Rothschild AM. Jusque-là, tous les observateurs de marché tenaient le même message ; Trump s’étant très largement entouré de gérants de hedge funds, de personnalités de Wall Street, et étant supposément très sensible à la variation de la Bourse, il ne ferait rien qui soit de nature à faire dérailler les marchés financiers. Et si, par hasard, quelque chose venait à faire dérailler les marchés financiers, il rebrousserait chemin. Personne ne s’attendait à de telles déclarations ». Et ce n’est pas tout. Au moment où le président américain entame un bras de fer commercial avec ses principaux partenaires économiques, il mène aussi la chasse aux dépenses de l’État fédéral, ce qui fait peser un autre risque à court terme sur l’activité économique. Or, là aussi, le choix est pleinement assumé par le nouveau pouvoir : « Il va y avoir un ajustement naturel à mesure que nous nous éloignerons d’une économie soutenue par les dépenses publiques pour avancer vers une économie soutenue par les dépenses privées », a reconnu le nouveau secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent.
Pour contrer les effets négatifs de ces choix politiques, Donald Trump multiplie les initiatives visant à stimuler les investissements aux États-Unis : dérégulations dans le secteur de l’énergie pour bénéficier de ressources abondantes et bon marché, baisses de taxes, incitation à la formation de pôles puissants dans le secteur informatique ou celui des transports… Si Trump mène une telle offensive favorable à l’entreprenariat, c’est parce que ses mesures peuvent avoir un effet récessif à court terme. Il le dit et le répète : « une période de détox est prévisible ». Sa « politique de long terme » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie démondialisatrice visant notamment à réduire les déficits américains (dette publique et balance commerciale) et la forte interdépendance internationale qu’ils ont créée. Sa victoire en 2016 avait déjà conduit au blocage ou à la renégociation de plusieurs accords de libéralisation commerciale, comme celui avec l’Union européenne (TTIP), celui avec le Mexique et le Canada (ALENA) ou un autre réunissant des pays comme le Pérou, la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Vietnam (TPP). Pour rapatrier usines et emploi aux États-Unis, Donald Trump n’avait pas hésité à engager un bras de fer avec la Chine, accusée de manipuler le cours de sa monnaie pour favoriser ses exportations. C’était une première depuis l’entrée fracassante du pays dans les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Enfin, Washington avait bloqué la cour d’appel de l’OMC, seule institution supranationale mondiale disposant d’un pouvoir de sanction.
Vers une nouvelle architecture financière ?
Il y a huit ans déjà, pour son premier discours à l’Assemblée générale des Nations unies, Trump avait annoncé la couleur : « Trop longtemps, le peuple américain s’est entendu dire que les accords de commerce multinationaux géants, les tribunaux internationaux irresponsables, et les bureaucraties globales puissantes étaient le mieux à même d’assurer son succès. Mais alors même que ces promesses continuaient d’être déversées, des millions d’emplois ont été perdus et des milliers d’usines ont disparu. D’autres ont joué avec le système en méprisant les règles. Et notre grande classe moyenne, jadis socle de la prospérité américaine, a été oubliée et laissée pour compte ; mais elle n’est plus oubliée et ne le sera plus jamais ». La philosophie derrière ces décisions américaines dépasse la simple thématique commerciale : il s’agit de relocaliser le pouvoir, de rendre les centres de décisions plus transparent. Ce qu’avait exprimé le futur président des États-Unis en juin 2016, quand il pointait du doigt son opposante du Parti démocrate : « Hillary [Clinton] dit que les choses ne peuvent pas changer. Je dis qu’elles doivent changer. Il faut choisir entre l’Américanisme ou son mondialisme corrompu ».
« Globalisme », « mondialisme »… Par dizaines de fois Trump a utilisé ces termes dans ses tweets et dans ses meetings, se référant ostensiblement au vecteur idéologique profond de la politique occidentale des cinquante dernières années (voir encadré). L’homme est décidé à défaire ce qui a été fait, et il pourrait aller plus loin. Dans une note de 40 pages publiée en novembre dernier intitulée « Guide d’utilisateur pour restructurer le système commercial mondial », le nouvel économiste en chef de la Maison-Blanche, Stephen Miran, a présenté des outils visant à dévaluer le dollar afin de rééquilibrer la balance commerciale américaine, la plus déficitaire au monde. L’un d’eux consisterait à limiter ou à taxer certains capitaux financiers entrant et sortant du pays. « Cela reviendrait à restaurer un contrôle des capitaux. Or toute l’architecture monétaire mondiale depuis des décennies repose sur un flux libre entre les économies avancées », s’inquiétait récemment un économiste du think tank fédéraliste Bruegel. Ces propositions ouvrent en effet la voie à une remise en cause profonde de l’industrie financière transnationale telle qu’elle s’est développée depuis les années 70.
« Interdépendance », la marotte pratique de l’utopie mondiale
L’un a présidé l’Internationale Socialiste pendant six ans avant de diriger le secrétariat général de l’ONU ; l’autre est un ancien militant maoïste devenu président de la Commission européenne ; le troisième a été commissaire européen puis directeur général de l’Organisation mondiale du commerce ; le quatrième est un lobby intellectuel malthusien ayant exercé une forte influence sur les dirigeants occidentaux. Tous ont exprimé des rêves de planification mondiale et d’unicité planétaire. Et tous ont désigné l’interdépendance comme un moyen de façonner un monde nouveau. « L’interdépendance est la logique du XXIe siècle, c’est l’idée qui guide l’Organisation des Nations Unies », avait déclaré Antonio Guterres dans son discours d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies en 2021. Pour José-Manuel Barroso, l’Union européenne et les Etats-Unis devaient façonner le monde dans la voie d’une « interdépendance mondiale » (2010). Selon Pascal Lamy, qui voyait dans l’interdépendance un vecteur logique pour cheminer vers une « Démocratie-monde », « l’Occident a produit la matrice de son déclin relatif qui est celle des progrès du reste du monde » (2012). Il y a trente-quatre ans déjà, le Club de Rome, qui disait vouloir s’attaquer aux « difficultés de l’humanité entière », affichait « l’interdépendance entre les nations » comme une réalité mais aussi comme un projet, et donnait des idées concrètes pour l’intensifier. Des idées profondément mises en cause par le nouveau pouvoir américain. nlivre Greiling :
Ludovic Greiling, Le monde qu’ils veulent, L’Artilleur, 2024