Civilisation
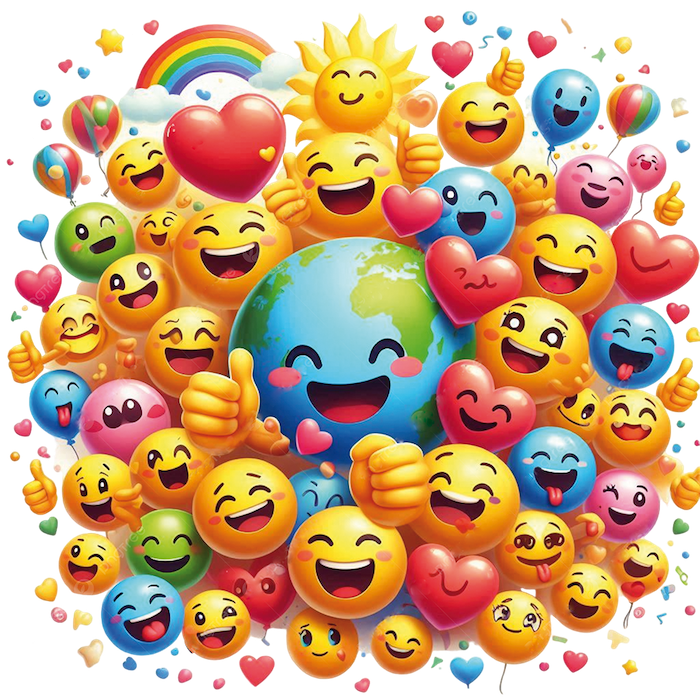
Silence, on communique
Nous allons au pas de course vers une civilisation de sourds et muets. Les signes se multiplient.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Jamais, même au temps des guerres de religion, les fractures françaises n’ont été si marquées. Peut-on envisager un pays où évolueraient des communautés “indépendantes” ? Ou la partition politique, sociale et culturelle ne peut-elle mener qu’à l’anarchie ?

On parle beaucoup du vivre ensemble. Mais il ne s’agit pas simplement de subsister les uns à côté des autres : nous vivons dans des ensembles fortement intégrés, des communautés. Or dans nos sociétés actuelles les systèmes de valeurs et les références essentielles diffèrent de plus en plus, parfois radicalement. La question est alors : peut-on faire communauté avec des gens avec qui on diverge sur des points essentiels, dont la vision du monde est complètement différente ?
En bonne logique, pour qu’il y ait communauté, il faut des éléments fondamentaux communs. Pas seulement des intérêts, car cela suppose de pouvoir se parler, de faire des choix ensemble ; cela suppose aussi une forme de solidarité, qui elle-même suppose de s’identifier ; donc qu’on ait en commun des éléments essentiels.
Quand on parle de communauté, ce qui est en jeu est distinct du niveau pragmatique de savoir comment on fait pour traiter au mieux avec les gens qu’on rencontre ou avec qui on a affaire, encore que déjà cela suppose un minimum de points communs. En effet, ce niveau pratique peut reposer au moins en partie sur la négociation et sur la coercition – si un pouvoir est à même de l’exercer. On peut alors avoir une manière de ’vivre ensemble’, mais qui reste en deçà d’une vraie communauté. Et encore, cela suppose l’existence d’éléments communs suffisants pour faire respecter un minimum d’ordre, notamment pour constituer un pouvoir qui ne soit pas violence pure.
La question se pose à notre époque et de plus en plus. Car ce qui la caractérise est l’ampleur des divergences. On pense bien sûr à la ligne de fracture résultant des migrations croissantes et de la cohabitation de cultures profondément différentes au sein d’une société qui s’affiche comme multiculturelle, notamment du fait de l’islam. Mais cette divergence restera encore en germe, ou locale, tant que la population allogène n’aura pas atteint un seuil quantitatif. En réalité, la divergence est au moins aussi profonde entre des personnes à la sensibilité classique ou traditionnelle, comme c’est mon cas, et par exemple des gens comme les Verts à la Sandrine Rousseau, ou la plupart des Insoumis, à commencer par J.-L. Mélenchon. Certes, ce sont là des positions provocatrices ou extrêmes. Mais le même effet est régulièrement obtenu par certains propos ou décisions d’E. Macron, par exemple sur la colonisation ou les migrations : ce personnage est actuellement le chef de l’État, il est supposé rassembler, mais par de telles déclarations non seulement il heurte des sensibilités mais surtout il suscite l’idée qu’il y a entre lui et nous une rupture profonde, un fossé infranchissable dans les jugements essentiels.
Bien sûr, dans la vie quotidienne il restera des points communs appréciables de langage, ou de ce qui reste de politesse. De même, lorsque des questions factuelles dominent, comme souvent dans la vie économique, dans l’entreprise, il peut être plus aisé de trouver des points d’accord ou coopération. Mais cela ne permet pas de dépasser le stade de ce que j’ai appelé la négociation ; au niveau global, cela permet de cohabiter, pas de fonder une vision commune, donc pas de communauté.
A-t-on expérimenté ce genre de situation dans le passé ? On pense ici au choix de la religion catholique ou protestante au XVIe siècle, ou encore à l’opposition entre catholiques (ou royalistes) et voltairiens (ou républicains) au XIXe et début XXe siècle. Nul doute que ces divergences devaient induire des sentiments de profonde différence. Cependant, me semble-t-il, la divergence actuelle est nouvelle. Catholiques et protestants divergeaient sur le choix de la religion, pas sur son rôle. De même, républicains et catholiques ou royalistes partageaient la même morale sur des points essentiels, et surtout le même patriotisme, sauf exceptions minoritaires. Désormais, c’est le sentiment d’étrangeté qui domine : ces gens aux valeurs très différentes sont de plus en plus des étrangers les uns aux autres. Nous ne parlons plus la même langue. En revanche, dans le même camp on peut trouver sot ce que quelqu’un dit, ou même choquant, mais ce n’est pas incompréhensible, ni étranger. Cette étrangeté mutuelle n’était, semble-t-il, pas le cas aux époques précitées.
On objectera qu’au XVIe siècle ces divergences ont conduit à des épisodes de violence mutuelle bien supérieure à ce que nous connaissons, au moins actuellement. Il règne en un sens une plus grande tolérance, alors même que la divergence est plus profonde. On pourrait expliquer en partie ce calme relatif par le fait que cette divergence est relativement récente et encore en évolution : on peut la dater des révolutions de mœurs des années 60, et encore la coupure ne s’est affirmée que progressivement. C’est vrai, mais cela ne décrit qu’une partie de la réalité. Bien sûr, on évoquera surtout ici la tolérance relative actuelle par le système de valeurs dominant, relativiste, par la reconnaissance de la liberté d’expression, etc. Mais cela ne répond que partiellement à la question posée, en tout cas pas au fond. Dit autrement, cela suppose le problème résolu. Si en effet on voit dans cette tolérance un ensemble de règles communes, de principes régulateurs de la conduite, cela peut être tout à fait utile et bénéfique ; mais cela reste au fond des règles du jeu, qui ne suffisent pas pour faire une communauté, parce que ce ne sont pas des réponses, des références communes substantielles. Si en revanche, comme le fait l’idéologie dominante, on y voit des valeurs fondamentales, cela veut dire qu’on prend précisément partie pour ce système de valeurs-là, et qu’on exclut les systèmes alternatifs, notamment les références classiques et traditionnelles. Cela d’autant plus que c’est là une idéologie de l’émancipation, constamment en mouvement, qui vise à changer la société et à dire en permanence aux gens ce que désormais il leur faut croire et respecter ; elle n’a donc pas les vertus de la stabilité et est toujours conquérante de façon nouvelle.
Pour faire une communauté, des règles du jeu aident évidemment, mais ne suffisent pas. Pas même les Droits de l’homme, trop abstraits, et susceptibles d’interprétations variables. Le fait est particulièrement évident lorsqu’un effort commun est nécessaire (guerre, grandes priorités budgétaires), ou quand les règles affectent de façon majeure une des communautés, comme dans l’exemple majeur de l’école. Le choix des matières et contenus de l’enseignement, des méthodes pédagogiques et plus généralement du système d’éducation mettent en jeu des valeurs fondamentales et affectent profondément ceux qui récusent les valeurs dominantes. C’est a fortiori vrai quand l’école (et le système de santé) s’embarquent sur des théories nouvelles comme celle du genre, et déterminent chirurgicalement le sort d’enfants supposés transgenres contre l’avis de leurs parents. Il en est de même quand un problème de société se pose comme celui de l’euthanasie, car même si on va prétendre que je reste libre de ne pas y avoir recours, savoir que cela se pratique me choque, et en outre altère mon rapport aux soignants. Ou quand on accuse de discrimination coupable devant les tribunaux ceux qui pensent que précisément il faut faire une différence entre les comportements. On soulignera aussi l’importance du budgétaire, centrale dans nos sociétés : la montée continue de l’endettement trahit cette incapacité à prendre collectivement des décisions majeures.
La difficulté est évidemment accrue par la domination d’un politiquement correct qu’on appellera progressiste ou de gauche, et notamment dans sa phase actuelle, déconstructiviste, woke et autres, de plus en plus menaçante pour la liberté d’expression. Il y a certes une forme d’incohérence entre d’un côté un principe affiché de liberté, d’émancipation et l’exaltation de la diversité, et de l’autre l’exaltation des valeurs de la République comprises comme régulatrices de la vie commune d’une façon qui tend à devenir intolérante. Ce que les idées de tolérance avaient de facilitateur pour la vie commune, malgré leurs limites, se trouve contrarié ou même remis en cause par ce militantisme, à l’occasion agressif.
Dans un tel contexte, il y a une telle opposition entre systèmes de valeurs et de références que si on parle et s’exprime, on sait qu’on ne parle véritablement qu’à une minorité culturellement proche, au moins sur certains points essentiels. Et encore, c’est trop souvent plus par une affinité de slogans simplifiés ou de symboles plus que par un véritable partage d’idées et de valeurs. À cela s’ajoute en effet l’affaiblissement de la culture, et la réduction de la communication à des formes simplifiées, proches de slogans, comme on le voit en dominante dans les réseaux sociaux. Avec les autres, et sauf heureuses exceptions, ce qui régit les relations est au mieux une forme de négociation, reposant au fond sur un rapport de forces. On le voit sur large échelle aux États-Unis actuellement, avec ce qu’on appelle la guerre des cultures, mais ce sera de plus en plus le cas en Europe. Un risque évident à terme est celui de la violence, d’une violence en outre relativement aveugle car mal dirigée et mal ciblée.
Notons cependant que la présence de contrecultures peut jouer dans certains cas un rôle important dans la vie commune, qui peut être positif tant qu’elles subsistent. Prenons l’exemple de l’armée, surtout au niveau des officiers. Choisir un tel métier ne peut être une simple question de genre de vie ou de technique, du fait qu’on y met sa vie en jeu. Cela suppose donc un système de valeurs bien spécifique, offert traditionnellement dans nos pays par la culture classique antérieure, mais difficilement compatible avec le système de valeurs progressiste. Ce qui montre le chemin parcouru depuis la IIIe République, où un officier de gauche était plus naturel. Le système sape en fait cette sous-culture dont il a pourtant besoin. Parallèlement, la présence d’éléments d’origine étrangère en nombre important dans cette même armée, au niveau du rang, peut se révéler ambiguë : facteur d’assimilation voire de mobilisation de forces supplémentaires pour le pays, ou au contraire éventuellement à terme, facteur de renversement du pouvoir.
Dans un tel contexte, au niveau collectif une tentation de solution minimaliste (et donc pas idéale) est ce que j’appellerais la voie ottomane : on organise consciemment la coexistence de communautés à autonomie relative. Cela dit, une telle solution supposait un pouvoir impérial et paraît malaisée en contexte démocratique. D’une part, elle est incohérente avec l’idéologie démocratique, dominée par des références progressistes et se voulant universelle. D’autre part, elle est difficilement compatible avec le mécanisme démocratique lui-même, qui comporte une lutte pour le pouvoir et la possible domination de la majorité.
Mais au niveau des intéressés, côté conservateur ou classique, c’est paradoxalement à une voie de ce genre que conduirait l’option de la contre-société appelée bénédictine par Rod Dreher ; c’est aussi un peu ce qu’on a pu vivre pendant une période sous la IIIe République avec ce qu’on appelait les deux jeunesses, la catholique et la républicaine. L’avantage en est un meilleur maintien des différences ; mais le risque collectif est celui d’une coupure encore plus radicale. La voie dite bénédictine a un certain sens en termes défensifs, notamment dans l’éducation, mais elle ne saurait pas constituer une solution, car elle signale un abandon de la lutte au niveau des institutions communes, et l’abandon de ce qui peut rester de dialogue ou de reconnaissance mutuelle, abandons qui ne sont ni nécessaires ni satisfaisants, surtout dans une société aussi contrôlée et dominée par l’État.
Ce serait d’autant plus risqué que la divergence évoquée ici, qui touche la population d’origine européenne, se compliquera de plus en plus à l’avenir de l’autre divergence, opposant cette même population dans ses cultures diverses à une population notamment musulmane de plus en plus nombreuse et de moins en moins assimilée. L’alliance actuelle entre la gauche et les migrants a des bases fragiles. L’instabilité de l’ensemble devrait s’accroître sensiblement.
De tout ceci résulte la confirmation de l’idée que l’existence de telles divergences n’est pas optimale et même dangereuse, pouvant conduire soit à une anarchie relative, soit à l’immobilisme, soit au règne de la force, pas nécessairement bien inspirée. Mais cela confirme aussi que la voie progressiste n’est pas viable sur la durée, car elle ne fonde pas une communauté, et en outre elle est instable. Seule offre une solution stable la voie de la pensée politique classique, avec des références communes reconnues comme fondatrices d’une vie de communauté civilisée, compatibles d’ailleurs avec une assez grande diversité, du moment que ces références sont mises au centre de la vie commune. Mais nous n’en sommes pas là.
Dans l’intervalle, il faut développer bon gré mal gré un art de vie en période malsaine, suffisamment protecteur pour éviter d’y être happé et broyé, mais suffisamment habité par le souci du bien commun et la participation à la vie commune pour éviter les dérives collectivement nuisibles. Du grand art…
Illustration : L’idéal républicain, paravent vertueux du communautarisme et de la défense des intérêts particuliers.