Tribunes

Que faire ?
Adieu, mon pays qu’on appelle encore la France. Adieu.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
On est certes en retard pour fêter la rentrée des classes, au moins si on se réfère au calendrier actuel ; mais fêtons-la en vieux croûton, à l’ancienne, en compagnie d’un chahuteur, Didier Desrimais, qui nous propose un pamphlet fortement épicé : Les Gobeurs ne se reposent jamais (éd. Ovadia). Avec son collègue et ami Jean-René Ksaafer (à prononcer à haute voix), il nous donne l’occasion de retourner sur les bancs de l’école afin de pratiquer différents exercices de ce qu’on appelait hier encore le cours de français.
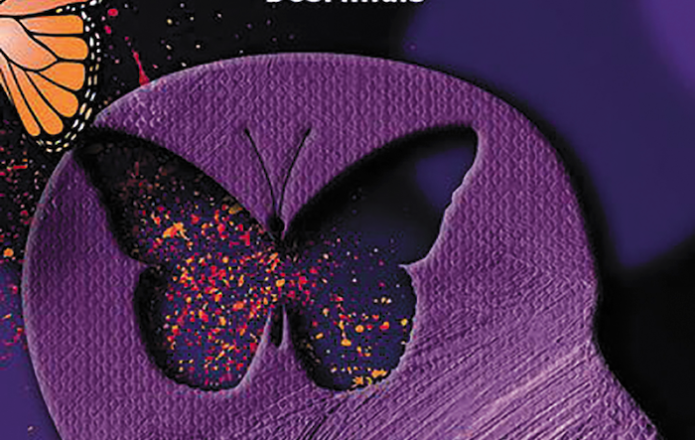
Et comme on le murmurait entre gamins, ça donne de sacrées poilades ! À commencer par l’étude du langage hidalgien, ce dialecte municipal lutécien que parlent quelques sybilles adeptes des fumigations de niaiserie par les voies basses. Mais où on atteint au sublime du commentaire de texte, c’est quand le professeur Ksaafer s’attaque à un monument de la littérature espatatratouillante, un texte de la célèbre Marie Darrieussecq, qu’il est inutile de présenter à des gavés de goberies malgré eux. C’est alors que Didier Desrimais devient philosophe, linguiste et dézingueur inénarrable de gobeurs en goberies, nous expliquant à quelle horde de branquignols nous devons de vivre chez les foldingues, cloportes et cafards des gravats de la civilisation.
Tout commence au refus d’apprendre à parler correctement, à la volonté vicieuse d’empêcher par tous les moyens que les enfants de France apprennent à parler correctement, à les empêcher d’acquérir le goût de la belle langue bien mâchée, bien huilée, bien savoureuse en la gueule comme dirait notre vieux Rabelais, lui aussi renvoyé à l’in-pace de son couvent à coups de triques merdeuses, je veux dire de ces phrases sans nerfs ni peau qui sortent en guirlandes molles de la bouche de ceux de nos concitoyens qui larvotent à la lueur d’une belle connerie, sans CO2 certes, mais terriblement imbibée d’une balourdise si hautement titrée que je préfère ne pas donner de chiffre.
Cependant, Didier Desrimais ne se contente pas de nous faire rire (souvent jaune), il porte le scalpel au fond de la plaie suppurante et nous montre la bactérie qui y travaille, insidieusement installée par les satrapes de l’Éducation citoyenne et nationale : « l’égalité égalitaire, l’égalité la plus bête qui soit, l’égalité par le bas, et même par le plus bas possible ». L’œuvre de cette sale bête consiste à rogner « toutes les matières indispensables à la liberté […] au bénéfice de toutes les matières nécessaires au dressage égalitaire », car le but est de détruire toute liberté, jusqu’à l’idée même de la liberté. Pour réussir plus sûrement, on fait appel aux parents d’élèves « réunis en syndicat du crime » avec l’administration, et on demande au professeur, « non pas de maîtriser sa discipline, mais de faire des claquettes ou cracher du feu, non pas doctement transmettre un savoir, mais bruyamment, joyeusement, politiquement, idéologiquement, euphoriquement, fabriquer des crétins. » On remarquera en cet endroit que l’auteur, saisi par l’enthousiasme de l’imprécateur, fait tournoyer la trique de son style. Rassurez-vous, bonnes gens : il n’use pas de son talent seulement quand il est en transes, mais tout au long de son travail de dénonciateur public des criminels qui ont pris le pouvoir à la manière des asticots, en envahissant les poubelles.
Son analyse le porte ensuite à dénoncer le triomphe calculé de l’oral sur l’écrit, d’un oral frelaté jusqu’à la puanteur de l’égout, les pédagogues pervers prenant le plus grand soin de faire ignorer aux élèves que ceux qui maîtrisent une parole puissante sont ceux qui lisent et écrivent, qui savent « que la langue française ne se conçoit pas sans être écrite ». Il arrive enfin au cœur de la question : « Bien sûr que l’objectif final de ses élucubrations délirantes n’est rien d’autre que cela, en finir au plus vite avec l’humanité, non pas seulement avec les « masculinités » ou le « capitalisme hétéro-centré », mais avec l’humaine condition [… ] d’en finir avec le tragique de la vie, d’en finir avec la vie. » Tout cela forme une nouvelle religion satanique, dont les « néo-curés » sont des savants, chercheurs et universitaires « intelligemment bêtes », qui sont atteints d’une maladie affreuse, le « biaisisme », mondialement répandue et si inquiétante que l’auteur se propose de lui consacrer un prochain volume en forme de masque. On l’attend avec impatience, tout en prenant bien soin de nous prémunir de la contagiOn par force lectures roboratives, joyeusetés spirituelles, et rires tonitruants.
Pour mieux patienter, on va se payer une autre rentrée, encore plus décalée que celle des classes, la rentrée judiciaire. Jean-Paul Honoré nous y invite dans un bouquin qui combine des airs de Choses vues hugoliennes et quelques cuillerées de Spleen de Paris baudelairien, Un lieu de justice (éd. Arléa). Profitant de l’inauguration du nouveau Palais de Justice de Paris (ça date, pardon pour le retard), l’auteur s’y introduit en flâneur, le carnet à la main. Son fil d’Ariane est une affaire criminelle de haute volée : le Président d’une firme du CAC40 doit s’expliquer sur une épidémie de suicides, déclenchée par de jolies restructurations perfusées en continu. Mais nous n’aurons pas droit à un documentaire sur cette sombre histoire, l’auteur est plus finaud que cela. Il parsème des bribes d’audience au fil de sa flânerie, si bien choisies et racontées qu’on est très vite au fait de tout sans avoir été jamais assommé d’informations boursouflées.
Tout en se promenant, il nous explique l’architecture des lieux, fort « signifiante » comme disent les zozos : « De part et d’autre de l’atrium, deux galeries se déploient […] jalonnées de surfaces vitrées, de portes […], de départs d’escaliers, de vestibules annexes prolongés par des couloirs que recoupent d’autres couloirs… » ; on se croirait dans une des Prisons imaginaires de Piranèse, gravures étranges dont Marguerite Yourcenar disait (en 1959, déjà !) qu’elles évoquaient par leur univers sinistre et mégalomane « celui où l’humanité moderne s’enferme chaque jour davantage. » Il ne manque pas de nous décrire ceux qu’il croise, gens de robe ou suspects, employés de tous rangs ou simples curieux. Et ce sont des esquisses, des scènes, des tableaux, toujours percutants, passionnants, éclairants, car l’auteur a un coup d’œil de franc-tireur, servi par une plume vive, poétique, épatante.
Il nous fait voir aussi, car il pousse les portes, s’installe ici et là au banc du public, savourant les audiences les plus minables, il nous fait entrevoir une humanité bariolée, souvent pitoyable, mais qui sait aussi se montrer roublarde et pétillante. On se glisse parmi la foule de nos semblables si dissemblables, entre eux et avec nous, qui les observons comme des animaux mis en cage pour un spectacle organisé par des gens dégourdis, portant des robes noires, et dont les métiers sont déroutants. Ces meneurs appartiennent à un autre monde, divin si on le rapporte à la menuaille qu’ils impressionnent et manipulent avec des outils de langage sophistiqués.
Car un Palais de justice est un univers rhétorique. Tout y repose sur les mots d’une langue archaïque, impénétrable au commun des justiciables, qui leur sont cependant appliqués selon des codes rigoureux, à la manière dont le chirurgien applique à ses patients des gestes et des processus mystérieux et pointus. Et même quand le contrevenant ne comprend rien à ce qu’on lui dit, quand le juge ne comprend pas grand-chose à la langue pauvre ou étrangère du malheureux qu’il traite, il sort de ces échanges, menés selon les règles, des décisions dites « de justice », lesquelles servent à maintenir en place une société d’apparence organisée, mais où personne ne sait clairement ce qu’il fait, ni ce qui se passe.
La construction de ce livre, qui semble désordonnée, est en vérité infiniment savante ; elle nous permet d’entrer peu à peu dans ce monde artificiel, qui se révèle être la résurrection de Babel. Les langues s’y sont brouillées, les interprètes prolifèrent, plus personne ne comprend personne, mais on se parle et on bâtit des dossiers, des situations, des instructions qui n’instruisent personne, au point que les prévenus eux-mêmes ne savent plus ce qu’ils ont déclaré, pourquoi ils l’ont dit avec ces mots, dont ils prennent conscience que ce n’étaient pas ceux qui convenaient. L’auteur passe, attentif et absent, curieux de traverser les miroirs par des moyens divers, dont les plus efficaces sont ceux de la charge des mots. Ainsi remarque-t-il que « le mot parvis résonne comme un bruit de pas sur les dalles. Il réveille un souvenir de basilique qui se prolonge au-delà de l’entrée, quand vous pénétrez au cœur du bâtiment. Vous découvrez alors une salle vaste comme une nef. » La suite est comme une liturgie, un charme qui ondule, fait lever des jupes… Vous la trouvez page 53. Et puis lisez Magny (Les regrets de du Bellay, sonnet 12), enchantez-vous, c’est un charme que je vous dis !