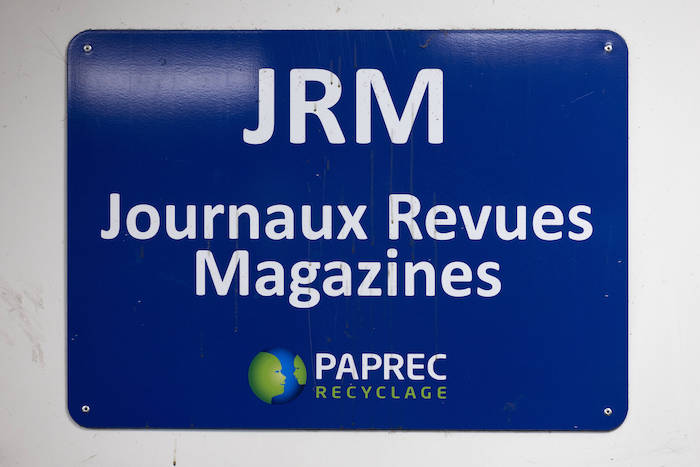Un jour de 2021, le directeur d’une école catholique sous contrat et un élève se sont retrouvés dans le bureau du premier. Le jeune garçon de quatorze ans était convoqué pour évoquer son comportement et ses résultats scolaires ; c’était un élève turbulent, semble-t-il, qui ne devait pas rester au collège ou passer au lycée l’année suivante. Le monsieur de soixante-dix ans exerçait son métier de directeur en effectuant un rappel à l’ordre et en voulant s’enquérir des causes de ce mauvais comportement.
Comme dans les paraboles philosophiques, comme dans les romans policiers à l’ancienne, comme dans beaucoup d’affaires de mœurs également, il y a ici, après un huis-clos, deux versions qui s’affrontent en tous points. Le jeune garçon affirme que le directeur, après lui avoir posé des questions sur sa sexualité, lui aurait pris la main, l’aurait posé sur sa braguette, et aurait posé sa propre main sur la braguette du jeune garçon. C’est ce que ce dernier déclare en larmes le soir même à ses parents, déclarant qu’il avait tout fait pour ne pas être renvoyé ; ses parents portent plainte. Le monsieur d’un certain âge affirme que l’élève, à ses questions sur son comportement associé à ses pratiques sexuelles juvéniles, aurait plaisanté avec insolence sur la santé sexuelle de l’adulte vieillissant, et qu’il lui aurait montré son sexe en l’invitant à une fellation. L’homicide laisse au moins un cadavre, généralement. Le crime de mœurs ne laisse pas forcément de trace réelle, d’autant qu’il ne s’agit que d’une agression sexuelle.
À toutes les étapes de la procédure, et jusqu’au jugement du tribunal, les autorités policières et judiciaires doivent se décider, adhérer à la version de l’un plutôt qu’à la version de l’autre, et en peser les conséquences. Cela demande du tact, et beaucoup : accepter l’accusation de l’un, c’est salir l’autre, presque irrémédiablement ; refuser l’accusation, c’est ajouter à la souffrance de la victime et risquer que le crime ne soit pas puni, et au contraire renouvelé. L’un est-il plus grave que l’autre ? Les accusateurs peuvent mentir et prétendre être victimes. Les accusés peuvent tout autant mentir, et être coupables autant qu’innocents. Les enfants peuvent mentir, plus souvent sans doute que les adultes ; mais ils sont plus souvent victimes, en général et en la matière, que les adultes. Les adultes peuvent mentir ; et s’il n’y a pas de traces matérielles, et si l’aveu seul les rend non seulement coupables mais aussi monstrueux à l’humanité et à eux-mêmes, choisiront-ils la vérité ?
Et la justice peine à se déjuger. C’est une machine administrative et intellectuelle qui, une fois lancée, a du mal à changer d’erre. Une fois son sentiment forgé, l’individu peine à changer d’opinion ; c’est d’autant plus difficile qu’elle est devenue l’opinion de ses pairs, et de la presse derrière. Il faut reconnaître s’être trompé et dire aux autres qu’ils se sont trompés…
Et il y a aussi un pesant air du temps. L’enfant a toujours incarné l’innocence ; vis à vis de la chair, quand tout est devenu permis, il représente le dernier tabou, et comme une manière de sacré. Au contraire, le prêtre, ou le directeur d’école catholique, qui a souvent été un prêtre, est devenu d’un personnage sacré une figure ambivalente, et même de danger : il peut être un homme de bien, il peut être tout autant un visage du mal, du désir contraint, perverti, abusif, et convoitant les corps de ceux dont il a les âmes en charge. La vague des scandales a commencé à Boston, au début du siècle. Soudain l’Église catholique tout entière est devenue responsable, coupable et même comptable des crimes commis par l’un des siens, clerc ou laïc investi dans une école ou un mouvement de jeunesse. Le prêtre suborneur n’est plus un pécheur qui désobéit à la morale de l’Église, c’est l’agent d’une organisation intrinsèquement perverse et criminelle. Les protestants en pays protestants, les anticléricaux en pays catholiques, les progressistes partout dans l’Église, le considèrent ainsi. Et le péché et le crime d’un prêtre cinquante ans plus tôt fait un scandale toujours neuf, même si l’accusé est mort, et la victime grand-père, comme c’est le cas pour Bétharram. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église n’a-t-elle pas estimé – avec une certaine fantaisie – les victimes du cléricalisme à 216 000, ou 330 000, en France ? Il y avait jusqu’à présent des crimes réels et des crimes imaginaires, il y a aussi désormais des crimes statistiques, dont la réalité est plutôt affaire d’opinion politique.
Le direceteur représente l’Église d’hier qui ne veut pas disparaître
Reprenons le fil du récit. L’enfant rentre chez lui. Il raconte, bouleversé, l’entretien à ses parents. Ses parents le croient, portent plainte, et leur plainte s’appuie de toute leur position sociale, une famille de hauts magistrats et d’un garde des Sceaux. Il y a interpellation, perquisition, interrogatoire. Le directeur nie et raconte sa version contraire. L’affaire est évoquée dans la presse, avec ses détails. Le directeur démissionne de ses fonctions.
Quatre ans plus tard, le procès en correctionnelle se tient. Malgré la publicité faite à l’affaire, aucun autre ancien élève ne s’est plaint d’une agression semblable, au cours des cinquante années de carrière du directeur. Mais l’homme n’est pas sympathique. Longtemps directeur de la plus prestigieuse école catholique parisienne, attaquée dans plusieurs affaires récentes, il est accusé d’y avoir introduit des comportements militants, rigoristes et traditionalistes, et d’y avoir dirigé par la crainte. Il représente l’Église d’hier qui ne veut pas disparaître, au contraire, et qui ressurgit. Il s’est pris longtemps pour un confesseur, posant des questions intrusives aux jeunes garçons convoqués pour leur mauvais comportement ou leurs faibles résultats dans son bureau, voulant savoir si leurs pratiques solitaires et leur consommation d’images interdites étaient en cause. On trouve sur ses ordinateurs des images pornographiques de jeunes gens, ce qui est certainement un péché, et en contradiction avec ses propres prescriptions morales, à défaut d’être un délit. On reproche au directeur de s’être d’abord tu, à la sortie de l’enfant du bureau. L’adolescent, devenu jeune adulte, n’est pas présent au procès, pour le protéger, expliquent ses parents et leurs avocats.
L’homme est condamné à cinq années de prison, avec sursis. La présidente justifie ainsi la sentence du tribunal correctionnel : « Je vous le dis tout de suite, Monsieur, le tribunal a considéré que la version donnée par Vincent était plus vraisemblable que la vôtre. Quelque chose s’est passé, nous n’étions pas là, mais dans la mesure où nous avons deux versions radicalement opposées, le tribunal a fait sienne les explications de Vincent ». On aurait pu imaginer, faute de faits établis, l’acquittement. Peut-être quelques années plus tôt aurait-ce été le jugement. Mais en juin 2025, le directeur de l’école privée catholique a été condamné, au bénéfice du doute.
Illustration : Une expérience de physique amusante : le doute pèse plus lourd que le vide.
Politique Magazine existe uniquement car il est payé intégralement par ses lecteurs, sans aucun financement public. Dans la situation financière de la France, alors que tous les prix explosent, face à la concurrence des titres subventionnés par l’État républicain (des millions et des millions à des titres comme Libération, Le Monde, Télérama…), Politique Magazine, comme tous les médias dissidents, ne peut continuer à publier que grâce aux abonnements et aux dons de ses lecteurs, si modestes soient-ils. La rédaction vous remercie par avance.