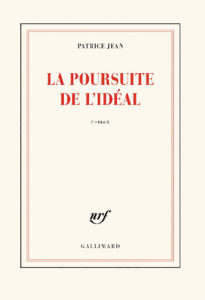Tribunes

Que faire ?
Adieu, mon pays qu’on appelle encore la France. Adieu.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Le roman prend toute la place sur les présentoirs et dans les colonnes des journaux. La critique se détourne des recueils de poésie, du théâtre, des aphorismes. Les lecteurs aussi. Alors pourquoi ajouter un roman de plus à ce flux continu ? Bientôt votre roman tombera des étals, et, dans le meilleur des cas, trouvera refuge dans les rayons ; plus certainement, il disparaîtra dans une remise, ou sera livré au pilon. Tant d’heures, de semaines, de mois consacrés à l’écriture d’un roman, et si peu de visibilité, de lecteurs, d’articles. Rien n’est moins rentable qu’un roman. Et je ne parle pas des sarcasmes qui accompagnent parfois la publication de votre livre : dans la presse, sur les rézosocios, de la part de pseudo-amis. Non, rien ne justifie le roman à une époque où triomphent les écrans : vous avez passé deux cents heures à écrire un texte qui n’aura peut-être que mille lecteurs ; un Youtubeur crée une vidéo en quelques heures, laquelle obtiendra des centaines de milliers de vues. Et pourtant… Le roman reste, pour moi, le grand art littéraire, en ce sens qu’il met en scène la collusion entre la vie intérieure et la vie collective. Par sa plasticité, le roman se retourne contre lui-même, puis éclaire les conditions de son apparition. Je ne conçois pas un roman qui ne parlerait pas de la littérature et de la place qu’on lui réserve dans ce que Régis Debray appelle la « vidéosphère ». Les romanciers qui, sûrs d’eux, n’évoquent jamais le sort de la littérature me font l’effet d’être au mieux de doux rêveurs et au pire de vrais crétins. Ils ont entre les mains un art qui depuis Rabelais et Cervantès s’interroge sur lui-même tout en se déployant et cependant ils font « comme si » nous étions encore dans une société littéraire. Mon projet (plus ou moins conscient) est de décrire notre époque antilittéraire (le règne de la culture est antilittéraire) dans des farces romanesques : dire ce qu’est l’existence humaine en notre temps à la fois passionnant et tragique, idiot et indécis.
Flaubert, paraît-il, ne cessait de répéter, accablé, « la haine de la littérature ! » Toutes les époques ont peut-être, au fond, détesté la littérature. Édouard Louis, récemment, a déclaré la détester, lui préférant la vérité des témoignages (si j’ai bien compris). Pensons aux connotations péjoratives d’une expression comme « c’est de la littérature », ou l’assimilation de la fable et du roman au mensonge (termes synonymes). Les gens sérieux lisent des essais historiques, des traités de philosophie ou d’économie, ils ne perdent pas leur temps avec des romans. William Marx a écrit un livre à ce sujet. Mais notre époque ajoute à ce rejet déclaré une indifférence à peine consciente : les grands romans occupent de moins en moins les conversations, on préfère, en soirée, parler d’une série, voire d’un film qui vient de sortir sur les écrans, ou même d’une « expo », d’une « destination ». Quel écrivain pourrait, dans un festival, attirer plus de gens qu’un Mbappé, une Beyoncé ? Regardez les nécrologies médiatiques : les écrivains, sauf s’ils passent souvent à la télévision, n’auront droit qu’à quelques lignes. Quant aux ventes, si l’on excepte une centaine d’écrivains qui en vivent correctement, elles obligent la plupart à vivre grâce à une profession plus « sérieuse » (en général, ils sont journalistes, professeurs ou travaillent dans l’édition). Certains éditeurs, du reste, pour reprendre une formule d’Alice Ferney, publient des livres comme on achète un billet de loterie : plus on a de billets, plus on augmente ses chances de gagner le gros lot. Cette inflation éditoriale témoigne, paradoxalement, d’un certain mépris de la littérature et je ne parle pas des yeux doux que les gens du métier auront pour des auteurs sans talent mais qui vendent beaucoup alors qu’ils prendront de haut ceux, parfois plus talentueux, qui ne vendent pas. N’importe quel tâcheron qui a des connaissances en informatique, en gestion ou en mathématique gagne mieux sa vie qu’un écrivain de talent. Je pourrais continuer longtemps à répertorier tous les signes du caractère antilittéraire de l’époque. Je m’arrête là, je fais confiance au lecteur pour en trouver d’autres. Je ne sais pas si la farce romanesque peut s’opposer efficacement à l’époque, sans doute pas. En revanche, elle s’en amuse, elle le révèle, elle tire à vue ; et, ce faisant, le roman ne disparaît pas.
Le personnage de Cyrille Bertrand écrit des poèmes, de nombreux poèmes. Il connaît des périodes de stérilité, des périodes de création. Le roman ne décrit pas cette activité créatrice, ou très peu, c’est ce qui donne sans doute l’impression qu’il n’écrit rien. En note, on trouve l’un de ses poèmes, mais j’ai peut-être eu tort d’en donner cet exemple. Il m’importait surtout de montrer en quoi un jeune homme passionné de poésie ne pouvait qu’être en contradiction avec ce monde antilittéraire dont je parle plus haut. En ce sens, Cyrille est, sur ce point, très éloigné des personnages des grands romans du XIXe avec lesquels on pourrait le comparer (toutes proportions gardées) : Julien Sorel ni Frédéric Moreau ne s’intéressent à la poésie ; Lucien de Rubempré choisit le succès plus que la littérature. Cyrille Bertrand est un personnage d’aujourd’hui, lesté d’un ethos (comme disent les sociologues) en décalage avec son temps. Il incarne l’incompatibilité entre les rêves littéraires et l’état actuel de notre société livrée aux écrans, à la technologie, au divertissement.
Les mots de la littérature s’adressent à une personne, une sensibilité, ce qu’on pourrait appeler « une âme » ; ils ne s’élèvent pas au-dessus des foules militantes. Ils n’agissent – et c’est leur grandeur – que dans le silence de la lecture, dans le repos et la concentration de l’esprit. La force de la littérature est invisible. Les tribuns flattent le gros animal, les slogans rythment les manifestations, les clichés empoisonnent la pensée. La vraie littérature échappe à la démagogie et au militantisme.
Je pense que nous vivons une période sinon faste du moins passionnante en littérature. J’ose à peine citer des noms, car j’en oublie toujours. La qualité littéraire ne dépend pas du chiffre de ventes. Un auteur que j’admire, et que personne ne connaît (Jean-Pierre Georges), ne doit pas outrepasser, pour chacun de ses livres, les cinq cents exemplaires vendus. Comme je l’ai dit, il existe une littérature qui aime flatter les attentes du lectorat, et une littérature qui poursuit un autre but, et même qui, elle, se plaira, au contraire, à choquer, à bousculer, à flirter avec l’innommable. Un écrivain qui n’a pas d’ennemis devrait se poser des questions : ses livres ne dérangent personne, on l’acclame partout ? On ne dit pas de lui qu’il est « réac », « élitiste », « sexiste », « misogyne », « facho », « dégénéré », « obscène », « trop littéraire », etc. ? Pour ce qui me concerne, je n’aurai pas envie de le lire. Certains critiques et certains lecteurs se plaisent à cracher sur la production littéraire de l’époque, ainsi ménagent-ils leur amour-propre, leur insuccès, leur anonymat. Mais le passionné de littérature se doit d’être curieux, et savoir repérer les écrivains qui valent le coup : s’il ne fait pas cet effort, qu’il s’abstienne, au moins, de dire que tout est nul.
Je ne connais pas vraiment les genres que vous citez. Ou plutôt mes connaissances sont datées : Tintin, Sherlock Holmes, Bradbury. Des amis essaient, parfois, de me « rééduquer », mais c’est peine perdue.
Ces thèmes s’imposent à moi, soit avant l’écriture (dans le projet romanesque), soit au cours de l’écriture, comme s’ils s’invitaient par une porte dérobée. Peut-être avons-nous à notre disposition un répertoire limité de thèmes, chaque écrivain les pressurant jusqu’à l’ultime goutte. Les derniers essais de Clément Rosset, par exemple, me donnent l’impression d’exploiter les ultimes conséquences de son idée principale (à savoir : le réel n’a pas de double) en de minuscules traités.
Tout ce qui existe est lié à la vie intérieure. L’intérêt du roman, à mon sens, est de mettre en scène ce que ressentent et pensent des personnages au contact de la société, de la vie, des embûches et des réussites. La vie intérieure, ce n’est pas le repli sur soi, sur une sphère narcissique, au sein d’une subjectivité confortable, non, c’est le genre de mélodie qui naît de la rencontre entre l’individu et le monde. Sartre écrit très bien que « si, par impossible, vous entriez dans une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au dehors, près de l’arbre, en pleine poussière, car la conscience n’a pas de dedans, elle n’est rien que le dehors d’elle-même » (Situations, I). Un roman peut très bien décrire la vie intérieure d’un type qui s’ennuie, ne fait rien, classe des papiers dans un bureau. On dira peut-être « Que m’importe ? » C’est oublier que l’art n’est pas dans l’objet, mais dans le regard sur l’objet : une nature morte comme La Raie de Chardin, avec ses poissons morts, ses couverts, nous fascine bien plus que des scènes épiques et grandiloquentes. Certes, nous sommes faits de l’étoffe de nos rêves mais aussi de la banalité des jours.