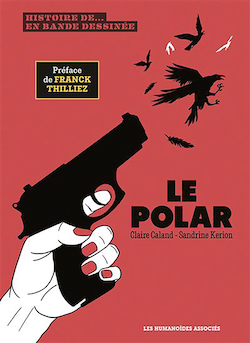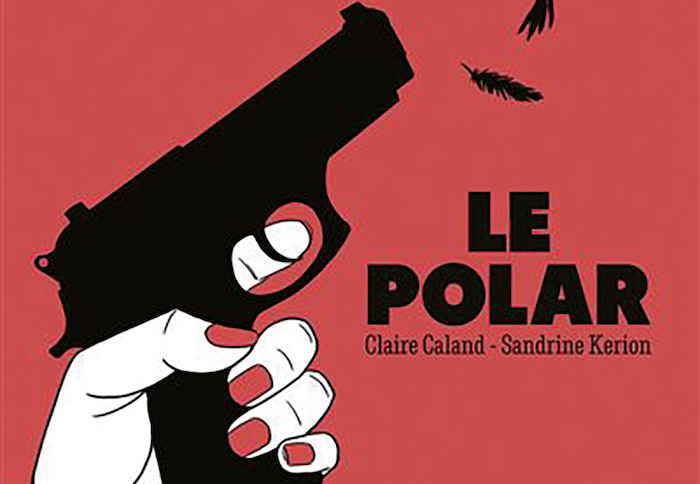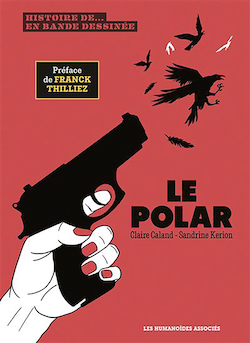Les Humanoïdes Associés poursuivent leur entreprise de vulgarisation de la littérature de genre, avec ce lourd volume consacré à l’histoire du polar en bande dessinée.
Le dessin de Sandrine Kerion, d’abord, retient l’attention : héritier d’une ligne claire réaliste, élégante, il serait parfait pour donner vie, sous forme de roman graphique, à l’un des récits policiers qui sont précisément évoqués dans le livre. C’est donc un excellent choix de l’éditeur pour illustrer l’histoire du roman policier écrit par la spécialiste Claire Caland.
Le polar (ou du moins sa forme première) naîtrait avec le mythe d’Œdipe. Après des siècles consacrés au roman pur, c’est au XIXe siècle que le roman policier émerge, et il trouve très vite son public. Le roman policier puise alors son inspiration dans des faits divers habilement mis en scène, et émerge avec la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe en 1841. Mais bien des auteurs ont flirté avec le genre entretemps. En France notamment, où des personnages dignes des romans policiers historiques d’aujourd’hui ont été introduits dans des romans de facture classique. Attention cependant à ne pas confondre polar et roman policier : concrètement, le roman policier raconte une enquête policière, généralement du point de vue d’un policier ou d’un détective. L’enquête en elle-même est le cœur du roman. En ce qui concerne le polar, il y a bien une enquête au cours de l’histoire, mais elle est au second plan.
Les ouvrages fondateurs, mythiques, essentiels, de la littérature policière
Mais la bande dessinée en question n’est pas qu’une simple leçon d’histoire. Les pays et leurs genres propres sont évoqués longuement. Chaque chapitre décrit, avec précision aussi bien graphique que littéraire, les ouvrages fondateurs, mythiques, essentiels, de chaque période majeure de la littérature policière, de chaque pays proposant une variation capitale du roman policier.
Simenon, bien sûr, a la part belle dans les recensions des auteurs les plus éminents du genre. On regrettera cependant que les auteurs aient fait l’impasse sur un événement majeur de l’histoire de la littérature policière : elles l’évoquent, mais sans parler de ses conséquences. En 1932, un écrivain nommé Claude Aveline (1901-1992), célèbre alors mais méconnu aujourd’hui, publia un roman policier chez un éditeur de romans classiques, Grasset. Il s’agissait de La double mort de Frédéric Belot. Le roman fut un succès mais surtout permit à la littérature policière d’obtenir les faveurs de la critique littéraire, ce qui n’était jamais arrivé auparavant (elle était le parent pauvre de la littérature de salon). À partir de 1932, les grands écrivains et les critiques durent composer avec ce mauvais genre, soudainement ennobli. Ce bouleversement majeur contribua à l’essor de la littérature policière. Ce qui fait qu’aujourd’hui cette dernière se déploie en différents sous-genres (par pays, type…). Du whodunit d’Agatha Christie et de ses épigones on est passé au cosy crimes, par exemple, et aux romans policiers humoristiques, tels ceux de Carl Hiaasen, journaliste américain devenu spécialiste du roman policier aux ressorts comiques indéniables mais ingénieusement construit. Les différents médias sont aussi analysés : livres, revues, télévision, cinéma, séries de plateformes… aucun n’échappe aux auteurs qui, on peut le dire, ont réussi leur pari avec cette épaisse bande dessinée : faire le portrait d’une littérature qui paraît avoir grandi et vieilli avec ses lecteurs, et ne cesse de se développer, pour le bonheur des aficionados.
Claire Caland & Sandrine Kerion, Histoire du polar. Les Humanoïdes Associés, 2025, 216 p., 24,95 €