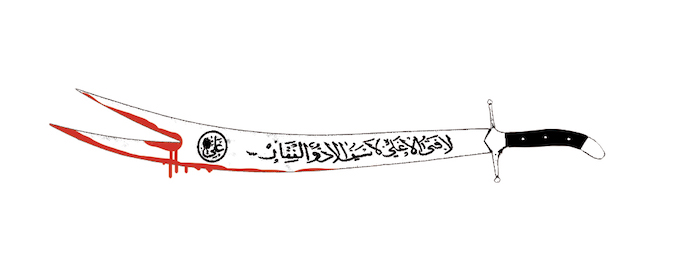La contextualisation est l’opération consistant à remettre des faits dans le cadre où ils ont eu lieu. Il ne s’agit pas, cependant, d’en décrire uniquement les circonstances proches mais d’avoir une vision la plus large possible et de prendre en compte un maximum d’informations circonstanciées ; mieux : « l’établissement, la vérification et la contextualisation des faits sont inséparables d’une démarche qui cherche à problématiser pour comprendre. » Problématiser est sans doute l’effort intellectuel pour étayer un dossier, asseoir un discours, légitimer une parole avertie. Qui procède à une contextualisation parle donc avec une certaine autorité ; il connaît, pour ainsi dire, les tenants et les aboutissants. Le travail s’apparente à une recherche généalogique : on remonte le temps, on ratisse l’espace, en cercle concentriques, pour rendre raison de ce qui a eu lieu. Cependant on déclare s’interdire d’expliquer quoi que ce soit selon l’enchaînement des causes et des effets ; seul un esprit grossier croit que la contextualisation met en évidence ce type de lien : « L’enquête ne se donne pas pour objectif d’expliquer des abus sexuels au sens où l’on pourrait déterminer des facteurs spécifiques produisant et repoduisant mécaniquement des comportements délictueux… » Toute l’ambiguïté de la démarche est là : on nie la causalité mais chemin faisant on insinue que la tournure prise est induite par tel ou tel élément. Cavalin déclare ainsi dans l’introduction : « L’enquête historique a pour visée de vérifier les faits disponibles, de les relier entre eux dans une quête de causalité. » Et c’est la contextualisation qui permet de mettre en lumière ce rapport puisqu’il ne faut pas « réduire la notion de contextualisation au simple rappel d’un cadre événementiel censé apporter, par sa mise en relation sauvage, du sens, voire de la vérité historique. » Dans ce méandre langagier, la contextualisation s’apparente à une invention – au sens ancien du mot – toujours couronnée de succès : on ne trouve que ce que l’on cherchait.
Chercher les preuves que l’on cherche
En contextualisant, on rencontre la socialisation : « Un des postulats de notre recherche est que ce travail de contextualisation conduit à nous interroger sur la socialisation, dans l’Ordre des dominicains, des caractéristiques pulsionnelles de Thomas et Marie-Dominique Philippe. » Le propos est ici plus intime, à la croisée du psychologique, ou du psychanalytique, et du social, ou sociologique. Là où le vulgaire dit « tel grandit dans telle famille », le “sachant” dit « tel s’est socialisé dans tel contexte familial ». Cette dernière formulation a le mérite de mettre le doigt sur un processus complexe induisant bien plus que la simple famille du vulgaire : « les phénomènes de socialisation opérant tout au long de la vie, de la prime enfance et avant même la naissance, à la mort et ensuite puisque, comme c’est le cas pour les deux frères, les événements leur ont réservé une encombrante vie posthume. » La socialisation vous colle aux semelles, à la peau. Pire, une famille est toujours pour le sachant le résultat d’une socialisation antérieure, aux rhizomes plus complexes encore que celui de l’individu et qu’il faudra, bien sûr, contextualiser de façon plus pointue encore. Un observateur candide, tel que moi, sort de tout cela comme un chat pris dans une pelote de laine.
On a compris la démarche : tenter d’offrir un cadre le plus large possible à la compréhension de l’Affaire. Cela s’entend mais ne va pas sans quelques difficultés : où commence et où s’arrête la contextualisation ? De quelle personnalité faut-il tenir compte dans les influences subies ? De quels événements ? Pour l’histoire familiale, pourquoi s’arrêter à la génération des grands-parents et ne pas remonter plus haut ? Quels plis cognitifs et de quel ressort (historique, sociologique, psychanalytique) président à cette contextualisation ? Et, plus radicalement, parler de « socialisation » n’est-il déjà pas une option ? On voit bien que ces opérations peuvent ne pas être purement objectives et qu’elles sont déterminées, en définitive, par ce que l’on sait et par ce que l’on cherche à montrer ou démontrer. On sait que le Père Philippe est un abuseur, on cherche donc à montrer comment il l’est devenu, cherchant dans l’histoire familiale comme dans les tiroirs d’une commode les preuves que l’on cherche : « Prendre au sérieux la dimension relationnelle de leur existence, de la petite enfance à la mort, en s’interrogeant sur les conditions de possibilité de ce qui advient à chaque étape, doit permettre de rendre compte de l’invraisemblable. » Le traitement de l’histoire de la province de France est entrepris avec une légère différence eu égard à la spécificité de ce lieu de socialisation d’une part, et, d’autre part, au lien qu’entretient l’auteur du rapport avec lui : n’oublions pas que la province de France est le commanditaire, détaché sans doute, mais commanditaire tout de même, dudit rapport.
Une dynastie dominicaine
Contextualisation à droite et socialisation à gauche, à partir de la page 183 et jusqu’à la page 438, Cavalin ouvre une large rétrospective sur l’histoire de Thomas Philippe avant qu’il ne fasse parler directement de lui dans les termes de ce qui sera l’affaire.
La famille est le premier et plus fondamental lieu de socialisation des frères Philippe : « Nous avons plus longuement étudié les premières étapes de leur vie en les inscrivant dans le projet familial politico-religieux de leur grand-père, Félix Dehau, et de leur oncle, Thomas Dehau, lui-même devenu dominicain. » Cavalin se propose ici de « peser la part de l’héritage familial dans leurs intinéraires après être entrés dans l’Ordre. » Une fois encore, l’auteur ne veut pas faire du déterminisme causal mais savoir jusqu’où les deux frères ont rompu avec leur milieu antérieur, familial, comme, paraît-il, le requèrait leur profession religieuse. Et quel est ce milieu avec lequel il aurait fallu rompre ? Il tourne autour de deux patriarches, deux figures tutélaires : l’une naturelle et l’autre mystique. Le premier est Félix Dehau, le grand-père, le second son fils, Pierre Dehau, en religion Thomas Dehau. Si le premier fonde une famille attachée à un lieu, Bouvines, dans une tradition politique et religieuse « à rebours », le second fonde « une dysnastie dominicaine », selon les mots du rapport. En effet, outre les deux frères, d’autres membres de la fratrie Philippe, ainsi que certains de leurs cousins, deviendront domicains.
En réalité, l’histoire de la famille Dehau ressemble banalement, en cette fin du XIXe siècle, à celle d’une grande famille bourgeoise nordiste, traditionnelle et patriote. Et Cavalin d’interroger cette banalité, « ce microcosme constitué par leur aïeul comme une utopie chrétienne enracinée dans un territoire », « genèse d’un modèle de relation sociale » que les deux frères n’auraient jamais cessé de reproduire. Et de voir des signes : « Bouvines, ce n’est pas seulement cet ancrage familial à forte charge émotionnelle mais récent, c’est aussi le souvenir d’une des plus célèbres batailles de l’histoire de France… » Et tout à l’avenant.
Finalement, entre les lignes, le premier reproche que l’on fait à Thomas Philippe, c’est de n’avoir pas su se démarquer d’une appartenance sociale : une famille « œuvrant à la restauration chrétienne », se prémunissant des « agressions de la modernité triomphante », bref « profondément réactionnaire par la volonté de reconstituer une société de paysans soudés par la religion autour de leur seigneur et bienfaiteur »… Presque une secte, pour ainsi dire. Ce ne sera pas seulement « des individus qui entrent dans l’Ordre dominicain avec les frères Philippe, mais toute une famille qui, de longue date, confond ses intérêts et sa vision du monde avec celle des ordres religieux dans lesquels elle envoie ses enfants. » On retient de tout ceci que Thomas Philippe est ce qu’il est par atavisme familial. D’autant plus que son frère Pierre, dominicain lui aussi, a su, lui, rompre avec ce cadre, avec la vie religieuse et le sacerdoce : « dans une attitude qui mette en cohérence ses inclinations pour le mariage, ses pulsions et sa conception de la vie chrétienne. Or vivre en dominicain ne le lui permet pas et il redoute d’attirer […] le scandale, les femmes susceptibles de le faire éclater étant au fils des rencontres et des séparations […] de plus en plus nombreuses. » Comme quoi, une famille n’est pas une fatalité !
Acquis à la tendance progressiste
La partie sur la « socialisation » dominicaine des Philippe porte un titre évocateur : « Un ordre dominicain subverti de l’intérieur », rien de moins ! Les débuts des Philippe chez les Dominicains, à la suite de leur oncle, sont exemplaires mais c’était sans compter sur une situation difficile. En effet, les années 1940 sont, pour la province de France, tendues : on cherche un souffle neuf, on expérimente. Intellectuellement, on revisite le thomisme, en le mettant en cause ou en lui appliquant une grille de lecture résolument moderne. Pour la prédication, on s’essaie à des lieux en rupture avec l’apostolat classique ; rien de tel que d’aller travailler en usine ! C’est l’identité dominicaine qui est remise en cause et qui n’est plus bien perceptible à certain. Des sensibilités campées se font alors face, elles s’opposent parfois avec une violence à peine dissimulée. La chose est telle que Rome doit intervenir à de multiples reprises aussi bien pour ce qui est de l’enseignement de la théologie que pour l’expérience des prêtres ouvriers.
Thomas Philippe, conservateur, tenant d’un thomisme traditionnel et mystique, d’un apostolat classique, ayant déjà occupé des postes importants au sein de sa province, exerce alors une mission romaine d’autorité. Évidemment, cela ne va pas sans susciter du ressentiment, d’autant que Thomas Philippe à partir des années 1945 développe sa propre « école », l’Eau vive, « une école de sagesse », présentée par Cavalin comme rivale du Saulchoir et sans doute perçue ainsi à l’époque par certains frères. Cette fondation de l’Eau vive satisfait le penchant à l’autonomie de Thomas Philippe, penchant qui d’ailleurs est assez coutumier chez les prêcheurs. Il est évident que Cavalin prend fait et cause pour la tendance plus progressiste de la Province d’alors insistant sur les aspects rébarbatifs du rôle romain de Thomas Philippe, sur son thomisme, paraît-il, sclérosé et exotique, sur sa conception de la vie dominicaine et sur ses rapports fuyants avec ses supérieurs. Peut-être y a-t-il du vrai dans tout cela mais, d’une part, ce genre de choses ne lui est pas propre : on trouverait d’autres dominicains offrant les mêmes plis, et, d’autre part, le contexte ecclésial tendu explique assez de choses sans qu’il faille supposer des dispositifs de camouflage destinés à couvrir les agissements moraux de Thomas Philippe. Ici aussi, on dirait que ce que l’on sait aujourd’hui du dominicain éclaire de façon forcée les faits de jadis, discréditant les tendances conservatrices au profit de ce qui fut condamné alors. De façon analogue, Marie-Dominique, à la fondation des Frères de Saint-Jean, dans les années 80, dans un contexte ecclésial tendu aussi, développera la même tendance à fuir une province qu’il ne comprend plus, et où il n’est pas compris, sans que cela ait nécessairement un rapport direct avec des abus ou des violences sexuelles. Pierre Philippe, évoqué plus haut, ne mène pas non plus une vie conventuelle exemplaire. Et le Père Gérard des Lauriers, qui dénonça au Saint-Office l’avortement du Carmel de Nogent, poussera la rupture avec sa province jusqu’à se faire ordonner évêque sans aucun mandat. Le rapport insinue doucement mais de façon persévérante, que le conservatisme des Philippe est l’un des composants du terreau sur lequel les fleurs du mal ont poussé et que leur indépendance d’esprit cachait quelque chose.
Les nombreuses pages consacrées à la famille Dehau et à l’insertion dominicaine des Philippe, malgré leur intérêt documentaire, sont loin d’avoir un rapport direct avec les faits qui leur sont reprochés. Il s’agit plutôt de portraits à charge, d’une famille traditionnelle et du conservatisme théologique, retroéclairés par l’Affaire, qui comme toute peinture procède de partis-pris, parfois hasardeux. Il nous restera à revenir, dans un troisième article, sur la portée proprement théologique de cette affaire et sur l’oubli qui l’a frappée jusqu’à son dévoilement récent.
Illustration : « En lisant [L’Affaire], j’ai été moi-même horrifié. Non pas par des complicités conscientes et délibérées qui n’ont pas existé au sein de la province dominicaine de France. Mais par de cruelles défaillances dans l’information ou l’évaluation, ou la décision, ou la rétorsion qui sont d’autant plus accablantes qu’elles ont pu confiner à l’indifférence ou à la négligence. » Frère Nicolas Texier, prieur provincial de la Province de France