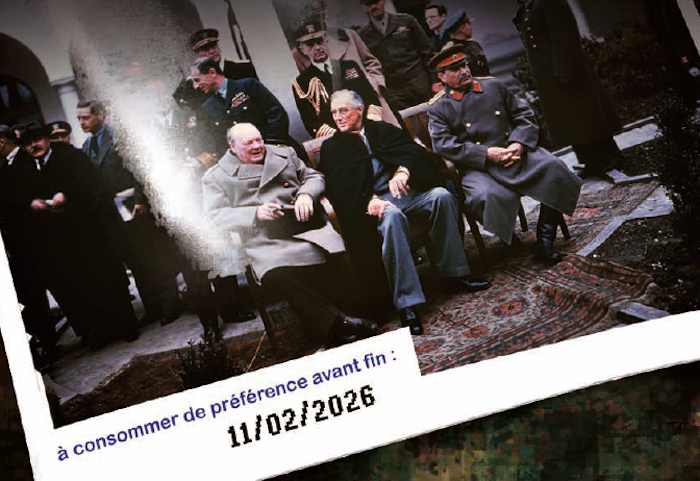Certains sujets politiques sont semblables à des champs de mines. Celui qui veut les traverser sans être pulvérisé doit faire preuve de la plus extrême habileté et de la plus grande circonspection, choses d’autant plus difficiles qu’il devra effectuer cette traversée sous le feu de l’ennemi. Comment, dans ces circonstances, éviter de faire un pas hors de l’étroit sentier qui pourrait vous conduire en sûreté de l’autre côté ? Et alors, boum ! Ces difficultés presque insurmontables étant bien connues, seuls les plus téméraires se risquent à tenter l’exploit. Mais les plus téméraires étant rarement les plus réfléchis et les plus habiles, il arrivera presque inévitablement qu’ils courront se faire sauter sur la première mine venue. Ce qui aura pour effet de tétaniser encore plus les candidats à la traversée. C’est ce qui est arrivé à Julie Graziani.
Mais, maintenant que la fumée de l’explosion s’est dissipée et que les débris du corps de l’ex-chroniqueuse de L’Incorrect ont fini de retomber, il nous importe de réfléchir aux raisons de son échec. Car le champ de mines de l’État-providence doit être traversé et l’idole du « modèle social » devra être abattue. Nous n’avons pas le choix, nous qui aimons notre patrie, ou ce qui en reste, et qui n’avons pas renoncé à lutter pour elle, même sans espoir de succès.
Il nous importe de réfléchir aux raisons intellectuelles de son échec. Les raisons qui peuvent être liées à ses éventuels défauts de caractère ne nous intéressent pas ici. Ce qui sous-tendait le propos de Julie Graziani était la notion de responsabilité individuelle et ce qui lui a valu d’être ventilée façon puzzle est sa suggestion que nous n’avons pas à aider ceux dont les difficultés matérielles sont la conséquence de leurs choix individuels. Pourquoi même des gens censés être « de droite » se sont-ils cabrés contre cette suggestion ?
Encourager les oisifs ?
Deux raisons principales peuvent, me semble-t-il, être déduites des réactions outragées qui ont suivi. D’une part, certains ont estimé que les remarques de Julie Graziani étaient motivées essentiellement par des considérations économiques, pour ne pas dire tout simplement par l’égoïsme : « Pourquoi, moi qui ai matériellement réussi, devrais-je payer pour ceux qui n’ont pas aussi bien réussi que moi ? Ils n’avaient qu’à faire plus d’efforts ou bien être plus malins » Voilà, en somme, la position qui lui a été attribuée – à tort ou à raison, cela n’importe pas.
Par ailleurs, certains ont entendu dans cet appel à la responsabilité individuelle un appel à « punir » les pauvres insuffisamment méritants et qui, par conséquent, « volent » l’argent public.
Ces deux raisons sont fortes. Elles sont même, me semble-t-il, insurmontables. Si l’État-providence doit être remis en cause dans son principe même, cela ne peut pas être parce qu’il coûte trop cher et cela ne peut pas être non plus parce qu’il faudrait châtier ceux qui volent l’argent du contribuable en se faisant aider sans nécessité – même si, en effet, l’État-providence coûte extrêmement cher et qu’il engendre beaucoup de situations injustes.
Pourquoi les considérations financières ne parviendront-elles pas à emporter la conviction dans ce domaine ? Parce que, comme je l’ai dit, elles semblent bassement égoïstes, motivées par la pingrerie de gens qui nagent dans l’opulence et qui refusent de se séparer d’une partie de leur superflu pour aider leur prochain. Et aussi parce que l’argent public est par ailleurs déjà gaspillé dans une foule d’actions inutiles, nocives ou injustes, de sorte que l’on vous objectera toujours qu’il y a bien d’autres priorités en matière d’économies que de s’en prendre aux aides destinées aux pauvres. Seules des finances publiques parfaitement en ordre et exemptes de dépenses inutiles autoriseraient que l’on s’en prenne à ces aides. Ce qui bien sûr n’arrivera jamais. « There’s a great deal of ruin in a nation » faisait sagement remarquer Adam Smith, à une époque où l’État-providence n’avait pas encore été inventé. Quant au fait de châtier ceux qui abusent de la générosité publique, le problème est que cela revient immanquablement à châtier aussi un grand nombre d’innocents, ce qui n’est pas acceptable.
La « charité légale » nuit puissamment à ceux qu’elle est censée aider.
Tocqueville, dans son Mémoire sur le paupérisme, en 1835, avait déjà parfaitement perçu le problème : « Il n’y a rien de si difficile à distinguer que les nuances qui séparent un malheur immérité d’une infortune que le vice a produite. Combien de misères sont tout à la fois le résultat de ces deux causes ! Quelle connaissance approfondie du caractère de chaque homme et des circonstances dans lesquelles il a vécu suppose le jugement d’un pareil point ; que de lumières, quel discernement sûr, quelle raison froide et inexorable ! Où trouver le magistrat qui aura la conscience, le temps, le talent, les moyens de se livrer à un pareil examen ? Qui osera laisser mourir de faim le pauvre parce que celui-ci meurt par sa faute ? Qui entendra ses cris et raisonnera sur ses vices ? A l’aspect des misères de nos semblables, l’intérêt personnel lui-même se tait ; l’intérêt du trésor public en serait-il plus puissant ? »
La réponse, bien évidemment est : non. D’où sa conclusion sans appel : « Toute mesure qui fonde la charité légale sur une base permanente et qui lui donne une forme administrative crée donc une classe oisive et paresseuse, vivant aux dépends de la classe industrielle et travaillante ». Ce que, de nos jours, n’importe qui ayant des yeux pour voir peut constater autour de lui, même s’il est passablement risqué de le dire publiquement.
Il faut le dire et le redire : l’État-providence mérite d’être attaqué dans son principe même et la notion de mérite individuel doit être défendue bec et ongles, non pas principalement pour des raisons d’économies ou pour des raisons de justice, mais parce que la « charité légale » telle qu’elle existe aujourd’hui nuit puissamment à ceux qu’elle est censée aider.
Essayons d’expliquer pourquoi aussi succinctement que possible – c’est-à-dire, inévitablement, pas très succinctement. Il faut nécessairement prendre du temps lorsqu’on veut argumenter – étant entendu que ce qui suit ne s’adresse pas à ceux qui estiment que l’État-providence est le sommet de la civilisation (je doute d’ailleurs qu’il y en ait beaucoup qui me lisent) mais plutôt à ceux qui sont mal à l’aise avec notre « charité légale » sans parvenir à savoir comment aborder le problème.
Mérites et charité
Pendant des siècles et jusqu’à une époque somme toute récente la charité, aussi bien publique que privée, reposait sur l’idée qu’il existe deux types de pauvres : les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Les pauvres qui, temporairement ou de manière permanente, ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins pour des raisons essentiellement indépendantes de leur volonté et qui donc méritent d’être aidés, et les pauvres dont le dénuement est principalement le résultat de leur comportement vicieux, désordonné, et de leurs mauvais choix. Ces pauvres-là ne méritent pas d’être aidés, même si parfois la simple compassion peut pousser à le faire.
Plus précisément, l’aide aux pauvres était organisée en fonction des principes suivants :
- La plupart des gens ne sont pas spontanément moraux ou travailleurs. Si l’occasion leur en est donnée ils éviteront de travailler et se conduiront mal. Autrement dit, la moralité a besoin d’être soutenue par la loi.
- Les gens réagissent aux récompenses et aux punitions. La carotte et le bâton sont efficaces.
- Pour qu’une société fonctionne correctement il est nécessaire que les individus soient – sauf exception – tenus pour responsables de leurs actes, et ce quand bien même cette supposition ne se révèlerait pas toujours rigoureusement exacte.
Il résultait de ces principes que la charité publique devait être limitée au strict minimum, car elle tendait inévitablement à toucher aussi bien les pauvres non méritants que les pauvres méritants et donc à encourager « les vices et l’indolence ». Il en résultait aussi que la charité privée est préférable à la charité publique. De manière schématique : la charité privée est distribuée par des gens qui, en général, connaissent bien la situation personnelle de ceux qui sont secourus. La charité publique est distribuée par une administration qui n’a que très peu de contacts directs avec ceux à qui elle porte secours. La charité privée repose sur le jugement individuel de ceux qui la distribuent : elle peut être facilement modifiée ou retirée lorsque la situation d’un pauvre change ou lorsqu’il s’avère être un « tricheur ». La charité publique repose sur une base légale, qui ne peut pas prendre en compte toutes les situations individuelles, et elle doit obligatoirement être distribuée à tous ceux qui rentrent dans les catégories définies par la loi, même si l’on a de bonnes raisons de penser que certains sont des « tricheurs ».
Mais petit à petit, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, des principes contraires furent adoptés. Parmi les élites la nouvelle sagesse devint ceci :
- La charité publique ne crée pas d’incitation à rester oisif, et quand bien même cela serait le cas il n’est pas vrai que l’oisiveté soit la mère de tous les vices.
- La répression ne fonctionne pas.
- Il est immoral de tenir les individus pour responsables de leurs actes, tout au moins lorsqu’il s’agit des catégories défavorisées de la population.
Pour paraphraser Bernanos, on ne comprend absolument rien à la société contemporaine si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de responsabilité personnelle.
La conséquence est que les pauvres furent, du point de vue moral, homogénéisés. Plus de distinction entre pauvres méritants et pauvres non méritants. Entre ceux qui agissent de manière responsable et ceux qui agissent de manière irresponsable : les pauvres sont tous, d’abord et avant tout, des victimes.
Les agents de l’État-providence se mirent donc en devoir d’apprendre aux pauvres que ceux qui sont sans ressources ne sont pas responsables de leur situation, que l’aide sociale est un droit, et qu’il ne faut pas avoir honte de réclamer ses droits.
Retirer la satisfaction de la fierté
Mais si être aidé cesse d’être embarrassant, une sorte d’aveu d’échec et de faiblesse, alors s’en sortir par soi-même cesse d’être honorable. Si ceux qui vivent des aides sociales ne doivent jamais être considérés comme responsables de leur situation, alors ceux qui parviennent à se suffire à eux-mêmes ne peuvent pas non plus retirer de fierté du fait d’être indépendants. Autrement dit, l’État-providence a peu à peu ôté aux pauvres honnêtes et travailleurs la principale récompense de leur honnêteté et de leur labeur.
Outre le salaire, la satisfaction morale qui s’attache au fait de subvenir par soi-même à ses besoins et à ceux de sa famille est, en effet, la plupart du temps, la seule satisfaction que peuvent procurer les emplois situés en bas de l’échelle salariale. Des emplois qui, en plus d’être mal payés, sont aussi, le plus souvent, répétitifs, salissants, pénibles, voire dangereux.
Cette satisfaction, cette fierté légitime de ne pas dépendre d’autrui pour sa subsistance a beau être immatérielle, elle n’en est pas moins très réelle et elle était traditionnellement renforcée par les louanges accordées par la communauté à ceux qui se conduisaient de manière responsable – revers de la désapprobation publique qui attendait ceux qui se conduisaient de manière irresponsable. Un homme qui occupait un emploi très subalterne et qui, grâce à cela, subvenait aux besoins de son épouse et de ses enfants, pouvait avoir l’impression justifiée qu’il accomplissait quelque chose de réellement important. Qu’il était quelqu’un qui comptait, si bas que puisse être son statut social.
Mais, dans la nouvelle configuration morale dessinée par la culture de l’excuse, le message implicite est que celui qui persiste à exercer un emploi au bas de l’échelle plutôt que d’accepter des aides sociales est réellement un naïf ou un idiot, une dupe du « système ». Non seulement il est désormais effectivement possible de vivre sans travailler, mais en plus vivre sans travailler alors qu’on en est capable a cessé d’être déshonorant.
Allons plus loin. L’État-providence est en général envisagé en termes purement économiques. Il ne s’agit, pensons-nous, de rien d’autre que de demander aux uns une portion de leur superflu pour accorder aux autres le nécessaire. Envisagé en ces termes il est effectivement difficile de lui opposer des objections sérieuses. Pour quels justes motifs refuserions-nous d’aider nos frères dans le besoin alors que nous sommes dans l’abondance ? Nous pouvons discuter du montant du chèque, mais guère de son principe.
Transferts économiques contre transferts sociaux
Cependant, cette manière de concevoir l’État-providence est largement trompeuse. Les transferts opérés par l’État-providence sont, certes, en partie des transferts monétaires des catégories plus aisées de la population (en pratique essentiellement les classes moyennes) vers les catégories moins aisées. Mais les transferts sont également non monétaires, et ils ont lieu à l’intérieur des catégories défavorisées. Les catégories les plus favorisées ordonnent ces transferts, mais ce sont les pauvres qui doivent en payer le prix.
Prenons le cas de l’école. Personne n’ignore que les règles de vie à l’école ont été considérablement modifiées depuis les années 1960. Ces modifications, qui rendent beaucoup plus difficile de punir et d’expulser les élèves perturbateurs, étaient motivées officiellement par le désir d’aider ces élèves perturbateurs, qui étaient considérés avant tout comme des victimes. Leur comportement s’expliquait, disait-on, par la situation socialement défavorisée qui était la leur et les punir pour ce comportement revenait à les punir d’être pauvres. Les élèves indisciplinés devaient donc rester à l’intérieur de l’école. La conséquence évidente est que la discipline à l’intérieur des salles de classe accueillant ces élèves « issus de milieu défavorisé » s’est beaucoup dégradée, pour ne pas dire que, dans trop de cas, elle a purement et simplement disparu et qu’il y est devenu impossible d’enseigner et d’apprendre.
Cette modification des règles ne coûte, a priori, pas d’argent à la collectivité, et cependant un transfert a bien été effectué. Pour améliorer la situation des élèves perturbateurs, nous dégradons la situation des élèves travailleurs et disciplinés. Nous opérons un transfert immatériel des bons élèves vers les mauvais élèves. Les mauvais élèves restent à l’école, mais les bons élèves ont plus de difficulté à apprendre puisque l’ambiance de la classe s’est dégradée.
En pratique ce transfert a presque toujours lieu des enfants issus des catégories défavorisées vers d’autres enfants des catégories défavorisées, en tout cas certainement pas des catégories supérieures vers les catégories inférieures. Le fils de pauvre qui est disposé à écouter ses professeurs, à travailler et à apprendre, doit abandonner l’opportunité de s’instruire et de s’élever par l’école pour que le fils de pauvre qui n’est pas disposé à travailler et à apprendre puisse rester dans la même école que lui. Il ne saurait en effet être question de bâtir des filières différentes pour ces deux types d’élèves : les mêmes principes qui ont conduit à modifier les règles de la discipline scolaire conduisent aussi à refuser toute « ségrégation » scolaire, c’est à dire à séparer les bons élèves des mauvais.
Ces transferts des pauvres vers les pauvres sont la conséquence directe et inévitable de l’abandon de la distinction entre pauvre méritant et pauvre non méritant.
Lorsque des délinquants « issus de milieu défavorisés », selon l’expression consacrée, sont laissés en liberté sous prétexte qu’ils sont avant tout des victimes du « système », les risques d’être victime de la criminalité augmentent avant tout pour les gens pauvres qui vivent dans les mêmes quartiers que ces délinquants. Ce sont eux, et non pas les catégories favorisées de la population, qui doivent abandonner une large part du bien que l’on nomme « sécurité » afin que les jeunes délinquants n’aient pas à être punis. Lorsque les programmes de formation professionnelle sont conçus en fonction des capacités des plus médiocres, ce sont les pauvres les plus capables qui doivent abandonner l’opportunité de développer leur potentiel professionnel. Lorsque les politiques sociales instillent l’idée que certains emplois sont trop dégradants pour être occupés, ce sont les pauvres qui préfèrent occuper ces emplois plutôt que de dépendre de la charité publique qui doivent abandonner une partie de ce qui faisait leur dignité personnelle.
D’une manière générale, l’État-providence a effectué des transferts considérables entre les pauvres : des pauvres les plus capables vers les pauvres les moins capables, des pauvres les plus honnêtes vers les pauvres les moins honnêtes, des pauvres les plus responsables vers les pauvres les moins responsables. En retour, l’État-providence a uniquement donné à ces pauvres que l’on appelait traditionnellement méritants la seule chose qu’ils n’auraient jamais demandée : un accès plus facile à la charité publique.
Perversité morale d’un système sans responsabilité
Un système de protection sociale qui ne porte aucun jugement moral en allouant ses subsides peut sembler très compatissant, mais il est en réalité profondément pervers et immoral. Parce qu’il démoralise, à tous les sens du terme, ceux qu’il prétend aider. Parce qu’il les prive peu à peu du respect de soi qui est la condition nécessaire pour s’améliorer soi-même. Parce que, comme l’écrit Theodore Dalrymple, il enferme un grand nombre de ses bénéficiaires dans « des sortes de limbes dans lesquelles ils n’ont rien à espérer et rien à craindre, rien à gagner et rien à perdre. Une vie vidée de son sens. »
Nous nous plaignons souvent que « l’ascenseur social » soit « en panne » et nous estimons que cela justifie l’existence d’un tel système très étendu de protection sociale, à titre de compensation. Mais l’une des raisons essentielles pour lesquelles « l’ascenseur » est cassé, c’est précisément notre « modèle social » soi-disant si généreux et qui en réalité coûte si cher à ses bénéficiaires. Il n’a jamais existé « d’ascenseur social », à savoir un mécanisme qui élèverait automatiquement et sans effort ceux qui montent dedans. Il peut exister tout au plus une échelle ou un escalier social, grâce auxquels certains de ceux qui sont en bas parviennent à s’élever au prix d’efforts plus ou moins grands. La notion même « d’ascenseur social » est typique d’une société démoralisée par l’État-providence, et elle est de ces notions qui contribuent puissamment à décourager les pauvres d’essayer d’emprunter l’escalier. Nous ne pouvons sans doute pas rendre de pire service aux moins favorisés d’entre nous qu’en leur apprenant, implicitement ou explicitement, qu’ils sont impuissants à améliorer leur vie par leurs propres efforts et qu’ils ont besoin qu’un État tutélaire leur tienne constamment la main.
En guise de conclusion, de toutes les considérations qui précèdent, on ne saurait déduire une réforme précise, clef en main, de notre « modèle social ». Une telle réforme sera nécessairement très complexe dans ses modalités pratiques. Beaucoup d’éléments contradictoires devront être pris en compte, beaucoup de compromis devront être passés. Il faudra naviguer dans une mer déchaînée et éviter de nombreux écueils. Mais nous n’arriverons jamais à bon port si nous n’avons pas, dès le départ, le bon compas moral pour nous guider.
Par Aristide Renou
Illustration : Julie Graziani, sur LCI, le 5 novembre : « Qu’est-ce qu’elle a fait pour se retrouver au Smic ? Est-ce qu’elle a bien travaillé à l’école ? Est-ce qu’elle a suivi des études ? Puis si on est au Smic, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là… »

« Ils se rendent compte, ces gens [les députés], du désarroi, de la détresse ? On ne demande pas de sous. On ne veut pas être aidés, on veut vivre décemment avec le salaire qu’on nous donne ». Mathieu Thomas, éducateur sportif à Perpignan, Gilet jaune, Franceinfo, 3 décembre 2018.
L’Insee et la pauvreté
Selon l’Insee, le taux de pauvreté en France serait passé de 14,1 % à 14,7 % de la population, soit 400 000 personnes en plus par rapport à 2017 (c’est un indice provisoire, l’indice définitif sera connu fin 2020 : « Afin de s’approcher le plus possible des indicateurs de pauvreté et d’inégalités définitifs pour 2018 qui seront publiés en septembre 2020…», dit l’Insee). On dépasse largement les neuf millions.
Le taux de pauvreté est calculé par rapport au niveau de vie médian, c’est-à-dire le niveau de vie qui partage en deux la population. On voit que ce niveau de vie peut augmenter du seul fait que les plus riches voient leurs revenus augmenter (c’est le cas, continuellement, depuis plus de dix ans). On est monétairement pauvre quand on gagne moins de 60 % de ce revenu médian. Un célibataire est donc réputé pauvre avec moins de 1041 euros par mois (soit 60 % de 1735 €), un couple avec deux enfants de moins de quatorze ans est pauvre avec moins de 2 186 €, etc.
Il faut néanmoins prendre les chiffres avec les pincettes de rigueur puisque, par exemple, « le chèque énergie mis en place en 2018 ne rentre pas, quant à lui, dans le contour du revenu disponible, car c’est une prestation affectée. La hausse des taxes sur les produits pétroliers et sur le tabac affecte les prix à la consommation des ménages mais n’a pas d’incidence directe sur la mesure de leur revenu disponible. » Tout est question de périmètre à défaut de bon sens. Dans la dernière hausse du taux de pauvreté, c’est la baisse des allocations logement qui a le plus compté selon l’Insee – qui n’intègre pas dans ses calculs « la réduction de loyer de solidarité destinée à la compenser, qui n’entre pas, par définition, dans la mesure des niveaux de vie » puisque « les loyers ne sont pas pris en compte dans la mesure des inégalités de niveau de vie, car celle-ci concerne les revenus des ménages et n’intègre pas l’effet d’une baisse des dépenses. »
Au-delà de la réalité des chiffres, on admirera à quel point un citoyen irréel est supposé servir de base à la définition de politiques solidaires nationales.