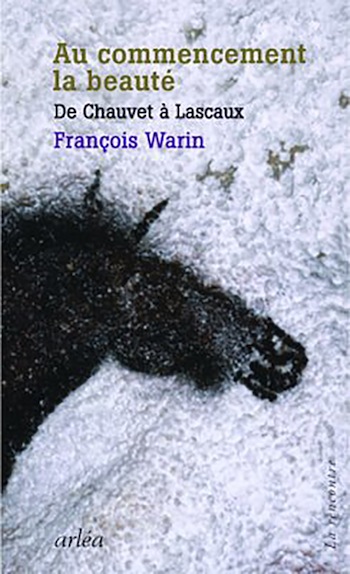Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
L’empire, fondé sur la force brutale, instrumentalise l’art, donc défigure la beauté en la faisant passer pour une créature soumise à sa puissance.
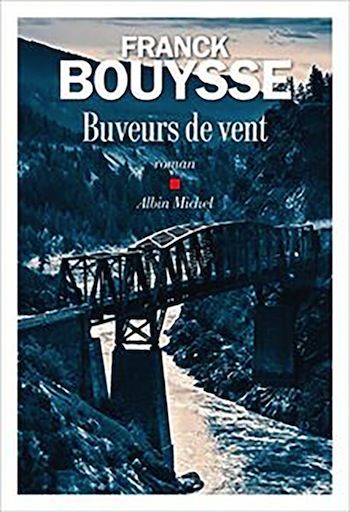
Franck Bouysse illustre ce fait dans un roman puissant, Buveurs de vent (éd. Albin Michel), qui s’élève sans efforts à la grandeur du mythe, tant il semble naturel à l’auteur de respirer dans les hauts sommets où se forment les fables aussi bien que s’engendrent les tempêtes.
Cette fresque, d’un réalisme sans fausse honte, qui amène à ne pas la mettre entre de trop jeunes mains, se passe dans une vallée de légende, perdue dans ses montagnes isolées, le Gour Noir. Les habitants sont des gens frustes, comme tous ceux qui vivent dans les endroits reculés ; cependant, l’auteur installe en chacun de ses personnages importants un mystère qui l’alourdit, le transforme en héros fabuleux. Ce petit peuple est soumis à un singe du Prince de ce monde, Joyce. Joyce a créé cette vallée en la façonnant, il y a construit un barrage, une centrale électrique, et il y exploite des carrières ; il a ainsi apporté le travail et la vie à ces gens, qu’il a du même mouvement abrutis sous son autorité. Chaque rue de sa ville porte son nom, et un simple numéro pour la particulariser ; il y vit dans un immeuble écrasant, protégé par des vigiles. Il semble ne s’occuper de rien, mais tout lui est rapporté, il décide de tout au moyen de ses envoyés, entre autres une sorte de shérif, Lynch, et deux brutes disparates, le nain Snake et le géant Double. Un lieu central, trouble, à la fois café, restaurant et maison de passe : « L’Amiral » (comme l’auberge de L’île au trésor). Une famille : les Volny ; la mère est folle de religion, le père est une brute par impuissance ; les quatre enfants forme une fratrie soudée ; Marc est un lecteur compulsif, Matthieu un courageux, Luc un ravi qui vit dans l’univers de L’île au trésor, évidemment ! Jean une jolie fille qui se veut libre et qu’on appelle Mabel ; le grand-père, Élie, unijambiste, est un sage plein de tendresse pour ses petits-enfants. Ces quatre-là ne se trahiront que par erreur (la jalousie du ravi le conduit à commettre une fois cette faute sans comprendre ce qu’il fait). Ce sont eux, les « buveurs de vent », épris de grand large et de sensations fortes, qui jouent à se jeter dans le vide au bout d’une corde du haut du viaduc qui enjambe la vallée, et qui trouvent dans ce défi vertigineux « toujours plus d’air, mais pas le même air qu’en bas ». La scène qui les montre se jouant ainsi en ouverture du livre est d’une puissance étrange, qui stupéfie.
Franck Bouysse est un Hercule de l’imaginaire. Il a dans la tête une puissance d’invention colossale, qu’il traduit avec un art consommé dans des scènes qui font trembler, si violemment qu’après certaines d’entre elles, le lecteur le plus aguerri s’arrête, referme le livre, le repose pour quelques heures, avant d’y revenir, hanté par cette énergie qu’on ne rencontre que chez les auteurs les plus inspirés, les mieux bâtis en colosse. Je ne sais pas si Franck Bouysse a un physique de bûcheron, mais il tient la plume comme on manie une cognée, avec cette force précise, ordonnée, qui subjugue. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir la délicatesse des tendres à l’occasion. Sa force fait penser à Giono, quand il est grand, quand il crée par souffle, avec la vigueur de ces moulins posés sur les crêtes pour attraper le vent, et ne le lâcher que lorsqu’il a fait l’ouvrage qu’on attend de lui.
Deux filles ont reçu la beauté en héritage, Mabel, puis une Isobel, que Joyce épousera par despotisme tendre, travaillé par le désir d’avoir un fils (la scène de demande en mariage est grandiose) ; Mabel à l’opposé ne se laissera épouser par personne, mais se donnera comme elle l’entend, pour son plaisir, dont elle est affamée. Ces deux belles résistent à leur façon à l’empire de la brute despotique, l’une en l’ignorant, l’autre en lui faisant un fils contre lui, un fils à lui opposer. Les hommes convoitent la beauté, la violentent, ne savent qu’en faire en fin de compte. Mais la beauté se dresse devant eux et les renvoie à leur néant. Luc, le ravi, ne connaît que la beauté de la rivière et de ses rêves, sortis de la lecture de Stevenson, tellement hanté qu’il croit que son grand-père est le John Silver du roman, venu lui apprendre à retrouver le trésor. Il y a un autre marin déchu, Gobbo, à qui la beauté qu’il aimait a été enlevée, autrefois, dans une autre île au trésor. Il se lie avec Martin, finit par s’imposer pour prendre la tête de la révolte contre Joyce. Puis la mécanique se met en place, infernale, cataclysmique – salvatrice cependant pour les rares élus.
L’histoire est passionnante, mais plus encore, elle vibre d’un sens qui l’élève à la dimension des textes fondateurs, puisant dans tous les sédiments de l’imaginaire, particulièrement dans l’univers prophétique de la Bible. On cite quelques vers d’un psaume, mais surtout, Joyce se souvient enfin, quand vient la fin, d’un morceau de l’Apocalypse, lequel signe son destin d’aveugle qui se croit obstinément puissant, même en s’abîmant.
L’auteur construit son œuvre avec les précisions d’un metteur en scène olympien, il place aux endroits cruciaux des scènes qui crispent les entrailles tout en élevant le cœur, il écrit une langue nerveuse, musclée, qui frappe, puis se fait fluide comme une eau. Sa présentation de la tempête qui s’engouffre dans la vallée est un poème homérique, grandiose, avec de ces éclats que Victor Hugo a dispersé dans Les travailleurs de la mer. Le prologue est écrit comme une Genèse, et l’aventure se clôt avec le visionnaire de Patmos. On sort de ce bouquin immense ébranlé, habité, bouleversé. Il demande des lecteurs solides, à qui il ouvre des brèches vers l’insondable, l’indicible de ce qui est, car « il faudrait peindre le silence avec des mots, même si les mots ne suffiront jamais à traduire une réalité, et ce n’est pas nécessaire », nous a prévenu l’auteur dès les premières pages. À la toute dernière s’accomplit la promesse : « la voix s’éteignit », et ne reste à voir « qu’un parfait océan » – inverse de celui des origines.
Après ce livre montagne, je vous propose un bijou ; après le brasier, une brassée d’étincelles. Mais des étincelles qui mettent le feu aux feuilles mortes de nos mauvaises habitudes de penser comme des veaux. François Warin, qui est philosophe, intitule son petit livre Au commencement la beauté (éd. Arléa), parce qu’il s’agit encore de nous offrir une Genèse, et de nous y montrer la beauté toute neuve. François Warin nous dit d’envoyer promener les Lumières et leur croyance enfantine au progrès, et de le suivre dans les grottes historiées des anciens hommes, « de Chauvet à Lascaux » pour nous émerveiller de cet art pariétal que des sots disent primitif. L’art des cavernes est immédiatement accompli, comme l’ont reconnu des Picasso, des Miro, tant d’autres qui savent ce qu’est la beauté des œuvres. Il n’y a pas de progrès en art. Il y a la perfection de l’œuvre réussie, qui par cette perfection est hors du temps, définitivement.
Dans ces grottes gît un mystère, qui est le mystère même de l’humanité : ce sont ces mains apposées sur les parois, non comme des signatures ou des signes chamaniques, mais comme son être même. Car la main de l’homme est l’homme même ; elle montre l’homme, signale sa présence. « La vraie condition de l’homme est d’avoir la main heureuse, de penser avec ses mains. » Car « c’est la main qui sait, et ‘‘faire’’ c’est déjà, essentiellement, ‘‘penser’’. » François Warin se range ainsi à la suite de Montaigne, et de Ronsard plus encore – bien qu’il ne le cite pas – qui écrivait, dans un poème au roi Charles IX qui est un éloge paradoxal de la main : « Les mains font l’homme, et le font de la bête/ Être vainqueur, non les pieds, ni la tête./ Car peu vaudrait l’entendement humain, /Bien que divin, sans l’aide de la main. » Dans le Gour Noir de Franck Bouisse, c’est ainsi que la main s’illustre, vous en jugerez par vous-même.
François Warin voit encore dans ces mains apposées sur les parois ténébreuses une révélation politique. Dans une analyse d’une remarquable profondeur il fait paraître, derrière ces mains multiples et les peintures mouvantes qui les accompagnent, un cinéma fabuleux, fait pour appuyer l’autorité d’une aristocratie, laquelle créait des mythes afin de justifier son pouvoir, de le faire accepter. Il conclut : « Ici se met en place le dispositif de la servitude volontaire, que des manipulateurs, faiseurs d’illusion et de prestige, sophistes en Grèce antique ou politiciens de tout poil, porteront à l’achèvement. » On voit l’intérêt de méditer ce petit livre d’une formidable densité. Certes, la pensée y est si serrée, l’écriture si ferme et robuste qu’il faut s’accrocher au texte comme on s’accroche à la paroi qu’on veut gravir. Mais quelle récompense ! celle que chantait Valéry : « Ô récompense, après une pensée, / Qu’un long regard sur le calme des dieux. »
Ainsi, de la caverne où elle est soumise, la beauté est appelée à sortir pour se vêtir de lumière, dans la splendeur aérienne des cathédrales, dans le palais du roi, qui est un soleil, selon les admirables pensées de Synésius de Cyrène, un père de l’Église grecque du IVe siècle.