Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
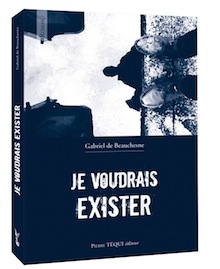
Le premier roman de Gabriel de Beauchesne, Je voudrais exister (éditions Pierre Téqui), par son sujet comme par sa construction, est attachant. En racontant l’histoire de Brenden, dont les hautes aspirations, étouffées dans son âme en friche, ont été ranimées, puis subverties par un recruteur islamiste, l’auteur cherche à comprendre une facette du terrorisme.
Sans vraie famille, déscolarisé, enragé contre une société qui l’ignore, Brenden se trouvait dans un état propice à accueillir l’idée folle qu’on transfigure sa vie en la sacrifiant dans un carnage d’Occidentaux décadents. Quand commence le roman, il s’apprête à se faire sauter dans un RER, en même temps que d’autres fanatiques doivent le faire dans plusieurs capitales européennes.
Mais si tous actionnent leur ceinture d’explosifs, lui y renonce in extremis, bouleversé par la rencontre d’Artus, un gamin de 12 ans, dont le regard, et surtout les propos, ont désengourdi son cœur. Artus lui a répété ce que son grand-père lui avait expliqué de la liberté, qui se conquiert ; pour Brenden, il s’agit d’une révélation, qui remplace et inverse le signe divin qu’on lui avait promis comme authentification de son martyr : il voit soudain clair comme le jour que cette liberté héroïque vaut infiniment mieux que la soumission à laquelle il s’était abandonné.
Une scène initiale aussi extraordinaire surprend, inquiète même quelque peu. Cependant, son symbolisme transparent, sa mise en place plutôt habile, font qu’on l’accepte, curieux de voir ce qui en adviendra. Hélas ! la suite aggrave par trop l’invraisemblance, d’autant que la langue se relâche, devient ici et là niaise, encombrée ailleurs de prêchi-prêcha. Qu’on en juge.
La fille d’un sous-directeur de la lutte anti-terroriste, Marie, va croiser le chemin de Brenden, désormais traqué, tant par la police que par son « mentor » et ses sbires. Pour lui que la fièvre d’apprendre vient de saisir inopinément, cette étudiante va devenir un maître de vie. Le plus surprenant est qu’elle lui conseille très vite la lecture d’un livre de Kant ; l’auteur ne nous dit pas lequel, mais quand on sait la difficulté des textes de ce philosophe, on ne peut admettre sans sourire que Brenden lise aussitôt ce livre, le comprenne, en dévore quelques autres, le tout en « quatre semaines ». Ce sont là des merveilles dignes de la Légende dorée ! Car si on nous affirme que Brenden est un « esprit exceptionnel », c’est quand même un jeune délinquant qui vit dans des squats, si parfaitement niais qu’il croit que l’université est un monde féerique peuplé d’érudits ! On veut bien que le romancier prête à son héroïne étudiante une dévotion pour le kantisme, mais de là à la transmettre quasi par illumination à un jeune voyou inculte, il y a de la marge.
Cela dit, Marie est crânement présentée, sa naïveté combative est touchante, son goût de l’art est habilement utilisé pour éclairer sa vie intérieure. Car la beauté – Kant oblige ! – joue un rôle fondamental dans cette aventure merveilleuse : la découverte d’un certain tableau pour Marie, de la beauté de Paris, puis de paysages provinciaux pour Brenden, autant de passages mieux venus que leurs échanges fumeux sur les « Lumières » et tutti quanti.
Le grand-père d’Artus, qui n’est ni « marin » ni « tonton flingueur » pourtant, a lui aussi tendance à faire des phrases ; concédons qu’elles sont plus brèves, mieux inscrites dans la situation. On peut songer à certains personnages des romans champêtres du premier Giono, sans la vigueur lyrique toutefois, ni l’enthousiasme épique.
De l’épopée, on trouve des vestiges dans les passages où la police intervient, ce qui donne quelques scènes fortes et rythmées. Le plus souvent néanmoins, l’auteur nous montre ses chefs gênés par les ordres tombés des bureaux, où l’on n’est occupé que de magouilles politiciennes et de manipulation de l’opinion, à qui on veut faire croire qu’on a su déjouer l’attentat parisien, alors qu’on ne l’avait pas vu venir. Ces parties-là sont bien enlevées ; porté par le plaisir de démasquer de telles vilenies, l’auteur y use d’une langue nerveuse et juste. Quant au lecteur, ragaillardi par ces bons passages, le voilà enclin à minimiser son agacement devant tant de discours recopiés de ceux des Tabarin du cirque médiatique.
Et puis, Marie et Brenden vont découvrir qu’ils s’aiment. Cette idylle, dont les premiers moments sont d’une invention curieuse, apporte une fraîcheur discrète.
Selon la quatrième de couverture, ce livre serait à la fois un roman philosophique et un thriller. Passe pour le thriller, assez réussi, et qui, étant à la mode, permet d’atteindre un public plus large. Par contre, l’ambition philosophique est plus contestable, étant à l’origine du bavardage et des invraisemblances, fautes qui rappellent les vieilleries que furent les romans à thèse. Dommage que l’auteur n’ait pas choisi l’option du conte philosophique, en s’inspirant, par exemple, de l’excellent Nouvel ingénu de Pierre Gaxotte.
Le lecteur n’en est pas moins amené à s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle réforme intellectuelle et morale, plus urgente encore qu’elle ne l’était au temps d’Ernest Renan – et sans doute aussi bien plus gravement compromise, au moins à vue humaine. On peut donc louer l’éditeur d’avoir publié ce livre ambitieux, tout en lui reprochant de n’avoir pas parfaitement rempli son rôle de conseiller, de n’avoir pas fait corriger trop de phrases convenues, tarabiscotées, parfois fautives, tant de propos qui sonnent faux, d’envolées naïves, défauts qui tiennent d’abord au manque de savoir-faire dans l’art de manier les mots.
Mallarmé a dit pour les vers ce qui est vrai de toute écriture : ce n’est pas avec des idées qu’on fait de la littérature, mais avec des mots, c’est pourquoi écrire un livre est un travail d’artisan, et que de bons maîtres sont nécessaires à l’apprenti. L’art romanesque, quand on pense s’en servir pour défendre des idées, veut qu’on les incarne dans des personnages pétris de chair, embarqués dans une histoire que le lecteur croit possible sans se forcer, et non de fausser la nature en les faisant discourir en porte-étendards placés dans des situations qui sentent le carton-pâte. Les grands auteurs métaphysiques que sont Dostoïevski, et, dans le domaine français, Georges Bernanos et Julien Green, avaient eux aussi l’extraordinaire pour sujet ; mais ils lui donnaient un poids de réalité vécue, une saveur de vérité capables de subjuguer le lecteur, cela par la justesse de situations profondément humaines, et, plus essentiellement, par la puissance d’une langue à cent lieues du bavardage de leurs contemporains. Ces auteurs se sont livrés dans leur style, parce que « le style est de l’homme même ». Entrant à leur façon dans le mystère de l’Incarnation, ils ont rendu sensible leur part de divin en une musique personnelle inimitable, jamais dans la soumission au langage dégradé des discoureurs de carrefours. En écrivant de manière unique, le bon artisan des mots, sans blesser la langue, l’enrichit de sa voix, qu’on écoutera « longtemps, longtemps après » qu’il aura disparu…