Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
L’art a pris en chrétienté un essor incomparable ; on pense aux cathédrales, mais c’est bien plus que cela. Puisqu’il prolonge et imite l’œuvre du Créateur, l’art chrétien est partout, au point que nos paysages sont aussi des œuvres d’art. Et qu’importe les déviances, les égarements, les trahisons, en particulier dans ce dépotoir qu’on appelle l’art contemporain : ce ne sont que grimaces de fagotins. L’artiste est un gardien de la beauté du monde sous peine de n’être rien.

Des imagiers continuent l’œuvre des tailleurs de pierre du moyen-âge, ainsi le sculpteur que nous présente un petit livre précieux que le père Pierre Descouvemont vient de consacrer à un trappiste, Le père Marie-Bernard, sculpteur de Thérèse (éd. Beauchesne). Ce moine est l’auteur des statues de la sainte que l’on voit au Carmel de Lisieux, devant la basilique, dans sa crypte, mais aussi un peu partout dans le monde, puisqu’elles furent reproduites, photographiées, coloriées, en particulier la célèbre statue de la sainte qui tient sur sa poitrine un crucifix qu’elle couvre de roses, et qui fut reproduite à 300 000 exemplaires, sans parler des innombrables images pieuses qui la représentent. L’auteur nous raconte sa vie, il nous décrit son œuvre (le livre est agrémenté de quelques illustrations), mais surtout, il nous fait pénétrer dans l’âme toute thérésienne de celui qui se voyait en « pauvre vieux professeur de joie. » Il affirmait tranquillement au médecin qui le soignait (il était de santé précaire et souvent malade) : « Je suis né en riant, et je mourrai en riant. »
Ce créateur de sourires était aussi un poète délicat, l’auteur de textes savoureux ; le père Descouvemont nous fait cadeau de quelques extraits, qui mettent l’eau à la bouche.

Pierre Lemaitre.
N’est-il pas notable que l’écriture, l’art du verbe, nous donne toujours de belles réussites ? Nous avons la chance d’avoir des écrivains qui se soucient de bien faire, quoique leurs préoccupations soient apparemment très éloignées de la piété ancienne. Mais les talents déposés en certains s’épanouissent ainsi que fleurs des champs, qui sont mieux vêtues que Salomon dans sa gloire.
Au risque de l’étonner, je dirais que Pierre Lemaître est de ceux-là. Prix Goncourt en 2014 pour Au revoir là-haut, il nous donne le deuxième volet de sa trilogie, Couleurs de l’incendie (éd. Albin Michel). C’est de la belle ouvrage, un livre de vengeance racontée par un artisan, qui nous précise avoir pour modèle Alexandre Dumas. Certes, il ne suffit pas d’avoir un bon maître, il faut encore savoir épanouir son propre talent ; soyez rassurés : Pierre Lemaître y réussit admirablement.
Le sujet est simple et net : Madeleine Péricourt, fille du banquier que connaissent ceux qui ont lu le premier volume, se voit dépouillée par une crapule ; elle décide de se venger. Le récit est monté avec la méticulosité d’un horloger de la haute tradition. Nous sommes à Paris après la Grande Guerre, dans le monde féroce des financiers, qui habitent dans des demeures toutes en décors d’hypocrisie. Heureusement qu’il y a le petit Paul, le fils de Madeleine, enfant infirme, délicieux et génial ; puis Solange Gallinato – ah ! ce nom ! quelle invention savoureuse ! –, une cantatrice invraisemblable et précieuse, qui appelle Paul son petit Pinocchio, si précieuse qu’on voudrait pouvoir la garder longuement embrassée ; et encore Vladi, une gouvernante polonaise bouleversante de générosité, création étonnante et géniale : et puis enfin, un monsieur Dupré, ouvrier et vengeur, éducateur d’amour, enquêteur aussi finaud que maître Renart, notre goupil national. En fin de compte, l’humanité que nous peint Pierre Lemaître est diablement sympathique.
Bien sûr, il y a des salauds, mais ces salauds ne sont pas si méchants après tout, pas assez en tout cas pour qu’on se mette à les détester. Et puis ils sont tellement bien peints, rendus tellement vivants et vrais, qu’on ne saurait les haïr tout de bon. N’est-ce pas là le grand secret de l’art littéraire ? Nous faire trouver dans les crapules assez d’humanité douloureuse pour que nous soyons touchés par leur misère, et que, lecteurs samaritains, nous soyons charitablement émus par ce qu’ils portent de blessures.
Voilà un gros livre que vous lirez avec enthousiasme et bonheur, une fresque qui ressemble à ces choses légères qui plaisent et repaissent, comme la bonne pâtisserie qui se mange avec gourmandise, et sans charger l’estomac. Quand on a fini, on se trouve joyeux, ragaillardi, prêt à affronter le monde et ses embûches.
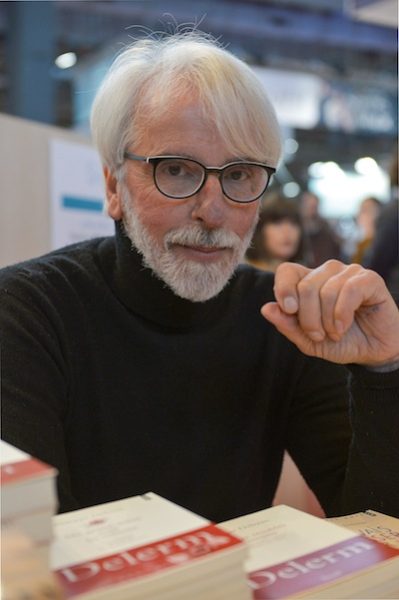
Philippe Delerm.
Et pour d’autres jolies subtilités, voici un moraliste comme on en faisait au Grand Siècle : Philippe Delerm nous a mitonné un recueil gouteux : Et vous avez eu beau temps ? (éd. du Seuil). Le principe est simple : prendre les formules toutes faites dont on se sert presque chaque jour, et en décortiquer les mystères afin de nous faire comprendre que nous sommes autrement compliqués qu’il n’y paraît. Compliqués en roueries, finasseries et basses méchancetés, certes, mais tout aussi bien compliqués en tendresses, en délicatesses, en générosités. Il y a de tout dans ces miniatures doucement ouvragées, avec un goût des mots qui enchante.
Voici le « fiel des compassions gourmandes » de celui qui vous demande, alors que vous venez d’être plaqué par une femme cruelle : « Et tu n’as rien senti venir ? » ; question apparemment aimable, qui n’est qu’une « pincée de sel sur la blessure toute fraîche ». Il y en a quelques autres, de ces perfidies démasquées. Mais le plus grand nombre de textes parlent plutôt de la tendresse, des nuances de la douleur, de la souffrance ordinaire, qui fait qu’il y a plus d’héroïsme à vivre petitement qu’à se jeter sur des retranchements bardés de mitrailleuses, que « c’est plus fort que l’ascèse des moniales et des moines, cet héroïsme quotidien : garder pour soi l’anxiété, donner la liberté à ceux qu’on aime. » Cela noté à l’occasion d’une pénétrante analyse d’un texte de Colette sur sa mère Sido, Colette qui, enfant, « emporte au bord de ses étangs, comme un supplément de joie perverse et délicieuse, la certitude qu’en son absence sa maman se meurt d’inquiétude. Pour elle, la tendresse viendra plus tard, dans ce toujours un peu trop tard qu’on appelle l’écriture »
Notation subtile d’un gourmet de la langue, qui ne cache pas son goût pour « une corporation amoureuse du langage : celle des marchands de vin ». À cette occasion, il atteint un sommet de l’art du miniaturiste en révélant le fumet de ces trois monosyllabes : « là, on est… ». Vous choisirez avec plus de bonheur votre prochaine bouteille quand vous aurez lu ces pages 45 à 47.
Concluons en Normand avec le remarquable « c’est y vot’temps ? », dans lequel Philippe Delerm se révèle sociologue, poète et philosophe. Il faut admirer la prouesse qui consiste à réunir ces trois caractères en un seul homme, un seul texte, un seul plaisir.
Un conseil pour finir : il faut lire Lemaître quand on veut remplir le temps et le transformer en grand fleuve qui roule ; il faut prendre Delerm quand on a décidé de « laisser tomber le temps », d’aimer l’instant avec une lassitude heureuse et comblée. Et puis après, s’agenouiller en confiance aux pieds d’une sainte, afin d’accompagner sa prière en beauté.