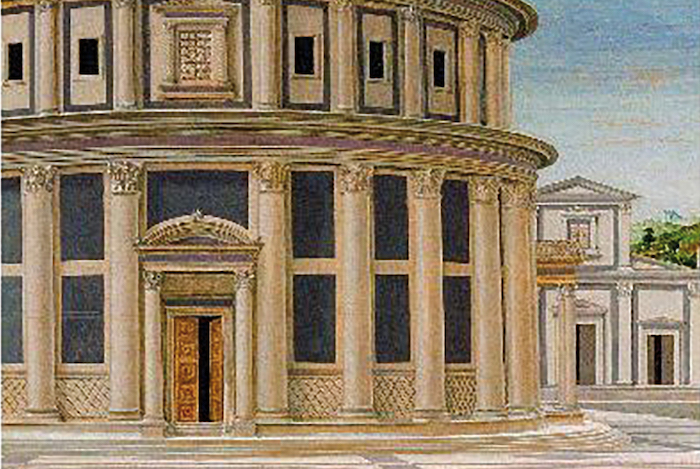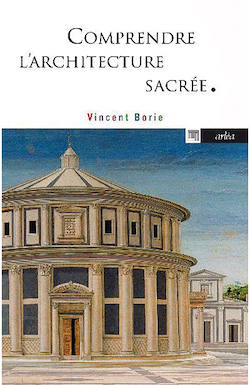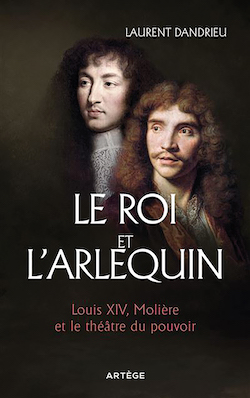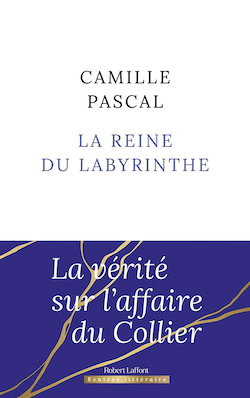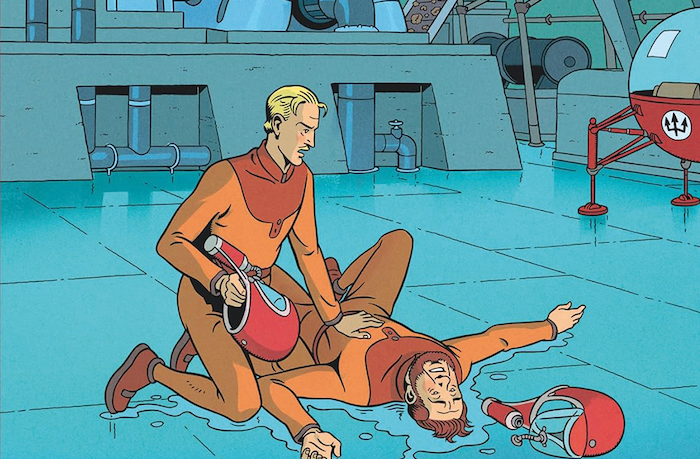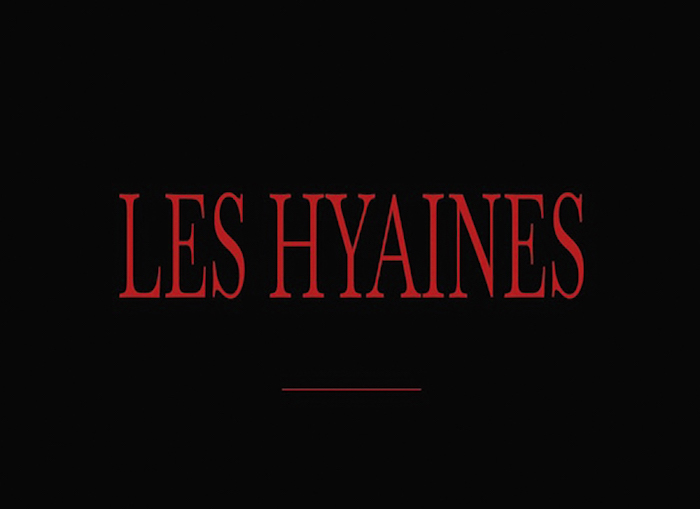Les récits historiques écrits par des romanciers ont des rapports ambigus avec les ouvrages savants des historiens. Le grand public, lui, ne fait pas dans la dentelle : il estime les premiers passionnants, et décrète les autres ennuyeux. Pourtant, certains savants parviennent à agrémenter leur science, tandis que des écrivains habiles se laissent néanmoins piéger par leur documentation, et lassent les lecteurs.
Les trois mousquetaires, où la science historique est fort maltraitée, sont un succès qui ne fléchit pas ; Les dieux ont soif, avec plus de sérieux scientifique, n’a pas obtenu une telle notoriété ; la récente biographie de Marie-Antoinette de Charles-Éloi Vial, quoique passionnante, a sûrement agacé certains lecteurs, attirés par le bruit journalistique, mais gênés par la méticulosité du savant historien.
Le dernier Camille Pascal, La reine du labyrinthe (éd. Robert Laffont), est de ces ouvrages difficiles à situer ; il s’agit d’un texte solidement informé, écrit avec un souci littéraire que manifestent ses techniques narratives et son écriture ; on regrettera cependant que l’auteur s’y laisse déborder par sa passion documentaire, et gâte ses scènes et ses dialogues par la démangeaison de les surcharger de détails, qui peignent l’époque, certes, mais affadissent le mouvement, font boiter le rythme, et fatiguent le lecteur soucieux d’avancer dans l’intrigue. Une fois de plus d’ailleurs, la réclame a enfumé le public potentiel en faisant croire à des révélations, alors que la nouveauté y est en peau de chagrin. Ajoutons que les découvertes éventuelles peuvent appâter les curieux, sans pour autant garantir la qualité littéraire ou historique.
Quelque chose de balzacien
Cependant, pour ceux qui aiment les précisions curieuses sur la vie de nos aïeux de la fin du XVIIIe siècle, Camille Pascal est une mine. Il rend les choses vues comme s’il y était ; il met en valeur les personnalités originales, rend finement leurs façons de parler. Comme il a par ailleurs un sens aiguisé de la psychologie des êtres vils, il nous peint habilement les mouvements intérieurs de la comtesse de la Motte-Valois, et encore mieux ceux du cardinal de Rohan, soulignant ainsi combien la bassesse est indifférente aux titres. Il montre aussi une vive curiosité pour la bêtise, qu’il nous fait sentir aussi clairement qu’il fait briller l’intelligence intrigante. Il est d’autant plus dommage qu’à force de surcharger ses portraits de détails curieux, il transforme trop facilement ses héros en présentoirs de bazar.
L’auteur nous offre néanmoins un agréable moment de lecture, quelque chose de balzacien par son goût des intrigues fondées sur la passion de l’argent ; de ce fait, il a recours à la police, car les intrigues à base de finances attirent immanquablement les policiers. Et puisque Balzac a inventé le roman policier avec Une ténébreuse affaire, il n’est pas surprenant que son livre s’apparente à un roman de ce style, alangui cependant par l’attention scrupuleuse aux curiosités – mais cela aussi est balzacien. Ajoutons qu’il est écrit dans un français élégant, à telle enseigne que les demi-habiles imaginent qu’il s’agit d’une tentative pour imiter la langue du XVIIIe siècle.
Laurent Dandrieu joue dans la même catégorie avec son récit Le roi et l’arlequin (éd. Artège), qui se penche sur les relations entre Louis XIV et Molière. Il apprendra beaucoup de choses aux honnêtes gens, mais rien aux bons connaisseurs du comique. Cependant, comme il manie la plume agréablement, et donne l’impression de s’amuser en racontant son histoire, on se sent bien en sa compagnie, séduit aussi par tout ce qu’il débite sur le ton bienveillant de l’homme de bonne compagnie. Il intéresse aussi en mêlant à sa narration des réflexions politiques suggestives. Restons cependant circonspects afin d’éviter quelques confusions menaçantes entre la théâtralité de la vie de cour, et les conduites politiques effectives.
L’arrestation de Fouquet n’est pas une scène de théâtre : elle est faite sans public, par des gens d’armes qui ne jouent pas. La guerre de Hollande ne se déroule pas sur les planches, et ne se conclut pas par des applaudissements. Les menées diplomatiques sont faites dans le secret des cabinets sans chercher l’approbation d’un parterre enthousiaste. Dès la première représentation que l’Illustre théâtre donne devant le roi, tout est clairement mis en place : Molière joue Nicomède parce qu’il pense que le roi aimera cette pièce politique ; remarquant sa mine morne, il comprend qu’il s’est fourvoyé, que le roi ne lui demande pas de se mêler de réfléchir, mais de le divertir ; il propose alors de le faire en lui présentant une farce, qui obtient un franc succès. Observateur pénétrant, vif et inspiré, Molière a su au débotté découvrir dans le roi un prince intelligent, qui aime rire, mais ne confond jamais amuseurs et conseillers.
Cependant, le théâtre est bien une donnée historique, à certains égards cruciale. On sait qu’il le fut dès la Grèce antique, où l’invention du théâtre mêle souci politique et liturgie sacrée. Son rôle au moyen-âge semble faiblir ; mais à l’époque classique, il joua de nouveau un vrai rôle. Rien qui le fasse mieux saisir que Vincent Borie dans son ouvrage Comprendre l’architecture sacrée (éd. Arléa), quand, évoquant l’architecture et la liturgie baroques de la contre-réforme conduite par les jésuites, il écrit : « Ce moment de l’histoire, qui conjugue architecture, art théâtral, création d’un nouvel ordre religieux, nouvelle liturgie catholique, sur fond de réforme protestante, est inouï. […] Le culte catholique devient alors une dramaturgie à laquelle assistent des spectateurs immobiles, les fidèles, assis sur leurs bancs ». Cette phrase étonnamment dense a été préparée par toute une série d’analyses remarquables, menées avec méthode.
Ce petit volume d’une grande richesse est agrémenté d’illustrations bien choisies, éclairant un texte puissant, conduit avec la rigueur et la pénétration convenables à mettre en pleine lumière l’histoire des bâtiments dédiés aux cultes. Le goût cartésien pour la méthode éclate dans le découpage annoncé clairement : sept catégories organiseront la réflexion. La sacralité « î » la notion et « sa transcription dans l’architecture ». « La sainteté est une réflexion sur le sens ». La communauté permet d’apprécier « le charme des plans centrés » et « quelques expérimentations contemporaines ». La théâtralité mène à Rome et aux églises jésuites. La corporéité « interroge […] le rôle du corps, tant dans la conception des édifices que dans la façon de vivre le rituel ». La sensibilité explore « le rôle des cinq sens dans l’expérience de l’espace ecclésial ». La spiritualité « ouvrira d’autres perspectives ». Ce programme ainsi exposé paraît sec, mais patience : dans le déploiement, il se met à vivre de manière prodigieuse ; cela tient à ce que l’histoire y est mise en usage, non à titre de curiosité ou d’ornement, mais comme instrument d’intelligence.
L’espace sacré du temple est en figure un corps
Un exemple emprunté au premier point le fera saisir. On sait que les églises étaient des espaces sacrés, dans lesquels tout criminel trouvait un asile inviolable. Il en allait de même dans le temple de Jérusalem. Vincent Borie pense qu’il s’agit là du premier caractère du sacré : il crée un espace inviolable. Le coup de génie, c’est la suite : l’auteur remarque que cela vient de ce que « le premier espace auquel nous avons accès est celui de notre corps », et qu’il s’agit d’un espace inviolable; aussi le viol est-il « un crime qui porte atteinte à l’intégrité physique de la personne et entraîne des conséquences symboliques considérables. Il souille la dignité, et bouleverse les équilibres tant psychiques que corporels ». L’espace sacré du temple est en figure un corps « censé maintenir la violence à l’extérieur ». Or, la violence est en nous par les pulsions brutales qui nous habitent et nous meuvent : il s’agit donc de les contenir sous notre autorité, ce que figure l’histoire de Thésée qui doit, en se rendant maître du labyrinthe, tuer le Minotaure, monstre symbolique, pour parvenir « à dominer ses pulsions ». Ainsi toute l’histoire est parcourue pour revenir à ce sacré primitif, notre corps. Saint Paul n’enseigne-t-il pas aux Corinthiens, dans un avis fulgurant : « votre corps est un temple de l’Esprit », respectez-le ?
À chaque étape, la même richesse de correspondances, de mises en relation permet de retrouver la fraîcheur du sentiment religieux, de retrouver aussi sa puissance, qui nous met « en relation directe avec l’au-delà ». On remarquera pour conclure que, si la dignité de la tragédie classique préserva souvent le caractère sacré du théâtre, Molière par ses comédies le fit revenir à la plus commune humanité, en mettant cependant en scène d’une manière renouvelée l’antique tension entre le profane et le sacré, en vivant fortement aussi celle qui peut s’établir entre le farceur et son roi, qu’il amuse.
- La reine du labyrinthe, Camille Pascal, Robert Laffont, 2024, 432 p., 22,50 €
- Le Roi et l’Arlequin, Laurent Dandrieu, Artège, 2024, 208 p., 17,90 €
- Comprendre l’architecture sacrée, Vincent Borie, Arléa, 2024, 176 p., 16 €