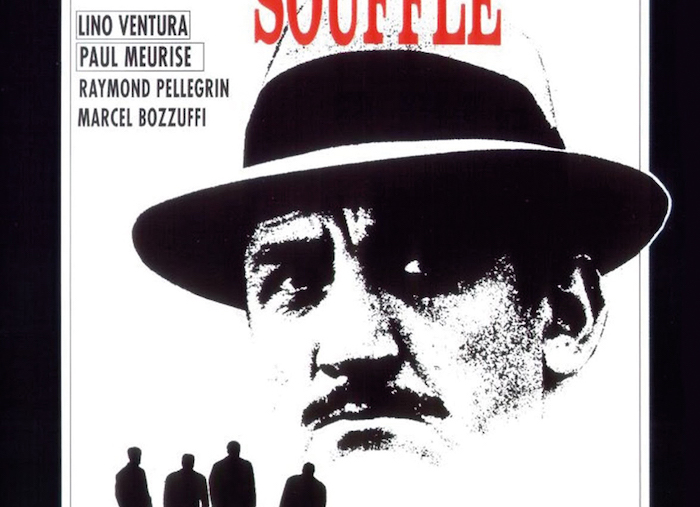Remarquable film de guerre par sa cruauté sans faux-semblants, son réalisme cru et son radicalisme inattendu.
Dans ce film de 1977, Sam Peckinpah continue de livrer sa vision résolument pessimiste – mais ô combien réaliste ! – du genre humain. De La Horde sauvage (1969), en passant par Les Chiens de paille (1971) jusqu’à Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974), c’est toujours la même antienne. D’ailleurs, si l’on n’ira pas jusqu’à affirmer que Peckinpah a réalisé le même film, il ne serait pas exagéré de comparer La Horde sauvage et Croix de fer, en remarquant des thématiques communes, à commencer par le plus petit commun dénominateur niché dans cette indomptable violence si caractéristique de notre incoercible animalité. Les artifices policés de la civilisation ne sont que des remparts de papier face aux assauts furieux des Érinyes de nos passions mortelles. Le message est d’autant plus clair dans Les Chiens de paille où le cinéaste invite le spectateur à une exploration introspective – c’est ce qui rend le film si dérangeant, ce d’autant plus que le protagoniste principal, joué admirablement par Dustin Hoffman, apparaît, dès le début du film, comme un personnage éloigné de toute pulsion meurtrière – de notre agressivité constitutionnelle.
L’ultra-violence comme genre transversal
Avec Croix de fer, si le héros s’y montre d’une violence aux confins de l’inhumanité, c’est parce que l’époque a, elle aussi, basculé dans le chaudron infernal. Les années soixante-dix apparaissent comme une période charnière dans l’évolution des mentalités. Sur les campus américains, ce, dès la fin des années cinquante, la libération sexuelle s’accompagne du désir nihiliste de s’affranchir de toute norme considérée, par essence, comme facteur d’oppression sociale, sinon « fasciste ». Le grand écran est alors inondé de films, notamment des polars marqués par une violence d’autant plus assumée qu’elle n’était, in fine, que le reflet d’une société de consommation hédoniste, pacifiste (nous sommes en pleine guerre du Vietnam), qui n’avait pas encore été frappée par le SIDA mais s’abîmait volontiers dans les frissons artificiels du LSD et de la cocaïne. En 1971, Clint Eastwood et Don Siegel ouvrent le bal avec L’Inspecteur Harry, flic expéditif ne s’encombrant pas des nouvelles politiques pénales laxistes en vogue. En 1974, Michael Winner fait naître la figure vengeresse du Justicier incarné par un Charles Bronson adepte de l’autodéfense radicale. Stanley Kubrick avec Orange mécanique (1971) – dans lequel le réalisateur ne se contente pas de décrire la violence du seul Alex, mais dénonce également l’inanité de la violence institutionnelle d’État – et John Boorman avec Délivrance (1972), imposent l’ultra-violence comme genre transversal – que des cinéastes, notamment en Italie, tels Mario Bava ou Dario Argento instilleront dans le Giallo, sans oublier les westerners comme Sergio Corbucci, Duccio Tessari ou Alberto Cardone dont Les Colts de la violence (1968) s’avèrent particulièrement sanglants –, voire à part entière.
Ni pires ni meilleurs que leurs ennemis
Dans Croix de fer, sans manichéisme aucun et avec un sens remarqué du détail (notamment dans l’emploi relativement fidèle du matériel militaire), Peckinpah explore moins la guerre en ses horreurs – ce qui serait d’une ennuyeuse banalité, la réussite indéniable du film résidant précisément dans cet écueil évité – que le soldat, l’homme en ses bassesses et ses grandeurs. Les combattants du Reich millénaire ne sont ni pires ni meilleurs que leurs ennemis et, lorsqu’ils ne courent pas après des hochets et des citations, se bornent à vouloir survivre. Parfois, ce n’est déjà pas si mal. En ces temps pesants de reviviscence de guerre civile européenne de funeste mémoire, un tel film ne peut servir qu’à mithridatiser contre toute propension au manichéisme, forme la plus bassement paresseuse de l’hémiplégie intellectuelle dont semble atteinte la plus grande partie de nos contemporains. Mais, surtout, l’œuvre de Peckinpah – ce qui la rendrait certainement incompréhensible aujourd’hui et ferait passer ses films pour d’archaïques navets réactionnaires –, bien loin d’être élégiaque, voyeuriste ou complaisante, pose, certes, sans doute, de manière sombre et bien peu enjouée, l’homme et l’hommerie.
À cette aune, ses films sont tout autant cathartiques que rédempteurs dans la mesure où ils contraignent à une anamnèse qui ne serait pas sans aller jusqu’à revenir aux sources originelles du meurtre d’Abel par Caïn.