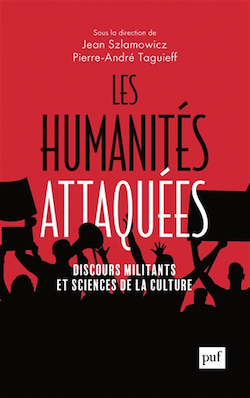Tribunes
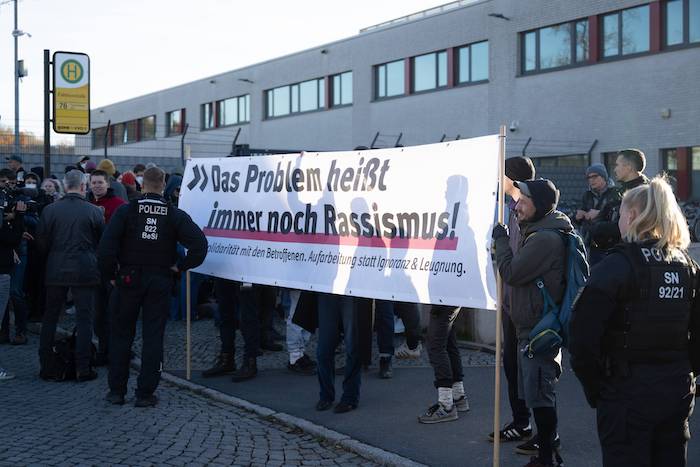
Le racisme comme impasse anthropologique et rhétorique de la modernité
La piste heideggérienne…
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Dix-huit articles, autant d’intervenants, mais une démarche cohérente, centrée sur le constat d’une évolution de la recherche scientifique vers un militantisme qui devrait pourtant lui rester étranger.
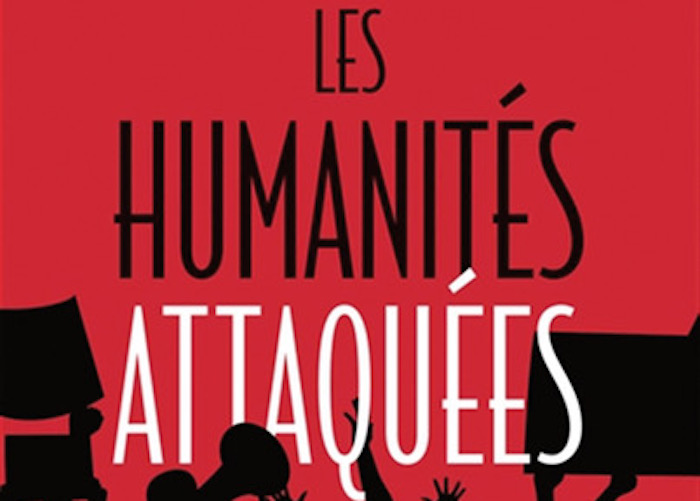
L’ouvrage, dénonçant une dérive, ressortit au genre du pamphlet ; mais aussi, s’étayant d’informations puisées dans le vivier universitaire, il permet de se faire une idée plus claire de quelques notions, débats, clichés animant et malmenant les sciences sociales d’aujourd’hui.
Nombre de concepts prennent l’aspect d’axiomes, dont le bien-fondé se trouve surtout dans des particularités (de genre, d’ethnie, de mœurs, de langue) revendiquées par l’énonciateur (p.61). La science se laisse ainsi contaminer par des valeurs personnelles ou communautaires avec, à la clef, dénonciation de l’objectivité, réputée n’être que pure domination de classe (p.20). Entre la croyance et la vérité, la différence s’estompe.
Ces concepts qui contreviennent aux critères fondamentaux de la science ont en commun de faire résulter le savoir non d’une méthode (celle de la validation d’observations ou d’expériences sur la base de leur réfutabilité, c’est-à-dire pour autant qu’elles s’exposent à la contradiction, cf. Karl Popper) mais d’une perspective (impérialiste, féministe, décoloniale, inclusive, à moins que ce ne soit l’intersectionnalité ou la théorie du genre).
Comment ne pas partager le malaise des auteurs devant la perversion de la relation du sujet et de l’objet ? L’un et l’autre tendent désormais à se superposer tandis qu’autrefois on veillait soigneusement à les tenir distincts (p.61) ; c’est le cas dans des thèses de recherche dont le sujet est leur auteur même, au prétexte d’auto-ethnographie,
Dans le portrait du chercheur en habit « d’académo-militant », Nathalie Heinich, dénonce un usage pernicieux du flou, entre opinion et savoir, valeur et fait, objectivité et point de vue situé. Pernicieux, car permettant toutes les esquives, toutes les emprises, au prix d’instabilités notionnelles, ainsi du concept républicain, qui oscille entre usage descriptif et normatif (Isabelle Mecquenem, p.169). L’approximation peut être utilisée délibérément pour dévaluer les raisons de l’adversaire, que l’on traite comme de simples affects (Guy Groux et Charles Robert, p.183).
Devant le lecteur éberlué surgissent tantôt des syllogismes : par exemple, l’aliénation coloniale ayant été ce qu’elle a été, il faut aussi « décoloniser la laïcité » (p.26) ; tantôt des assertions qui se suffisent à elles-mêmes, sûres de pouvoir toujours trouver dans la réalité des preuves à leur convenance : ainsi il n’est pas à démontrer que l’islamisme radical n’a d’autre cause que l’impérialisme occidental (p.27) ; tantôt des métaphores que l’on utilise comme si c’étaient des notions aptes à structurer la pensée : telles ces métaphores clefs de l’idéologie éveilliste, la « construction » (il n’y a pas de nature des choses mais seulement des faits socialement construits) et la « déconstruction » (ces mêmes faits, moralement répréhensibles, nécessitent rectification urgente, étant exclu qu’il puisse y avoir derrière des traits permanents de la vie).
L’éveillisme oublie que ces métaphores sont impuissantes à créer de la légitimité ; elles aident tout au plus à faire voir ce qu’on pense (p.37-38). Du reste, si on les déconstruisait, on y apercevrait des présupposés relevant non de l’observation, mais du jugement, non de l’esprit de méthode, mais de la tabula rasa (p.75). Ils arrivent tout droit de l’idéologie, bien ensanglantée pourtant, de l’homme nouveau à bâtir sur la suppression de l’homme ancien, tout cela étant affaire d’homme bien sûr, lequel a remplacé définitivement Dieu comme créateur de Tout.
Mais justement comme c’est la socialité qui fonde l’être, il n’y a que la justice sociale à pouvoir donner du sens à ce qui est. Le restant, c’est-à-dire au bas mot notre Histoire, relève, n’est-ce pas, d’un complot « masculin-blanc-occidental, la source de tous les maux » (p.67).
Les réponses face à cette idéologie dominante dans et hors l’université ? Le recours aux faits, tel que Thomas Sowell, de Stanford, s’en est fait une méthode (p.141) ? J’y ajouterais une extrême vigilance à l’égard des mots, en toutes circonstances. Outre leur sens, il faut s’assurer de leur intention.