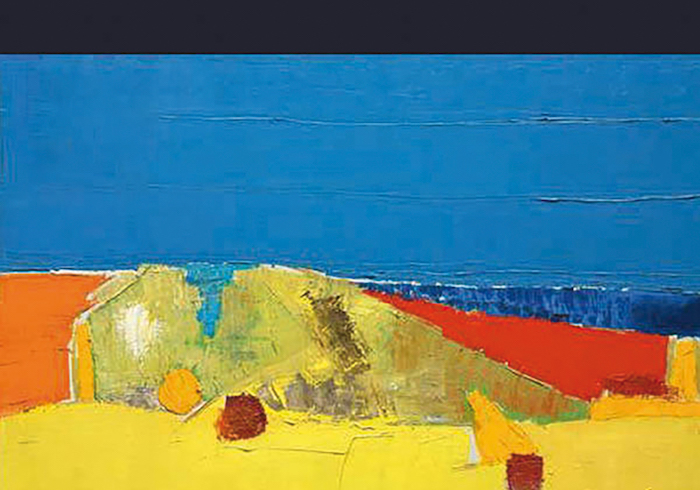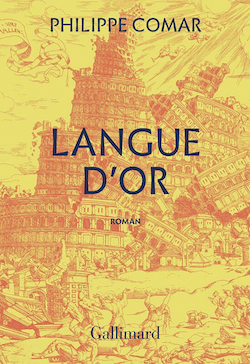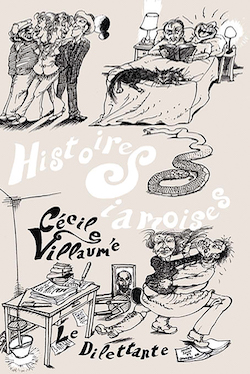Dans un roman d’une profonde originalité, Langue d’or (éd. Gallimard), il explore les arcanes de notre élévation, tout en peignant notre chute dans une immonde barbarie. Son récit fait penser à la quête du graal, mais qui se déroulerait dans un monde dévasté, ruiné il y a « peut-être mille ans » par la plus abominable des guerres, la « Guerre des genres ». Cet intitulé suggère que nous vivons aujourd’hui l’amorce du cataclysme, et nous met en garde. Ce n’est pas tant le feu nucléaire, ou une monstrueuse épidémie, qu’il faut craindre, mais plutôt la confusion et l’effondrement des langues dans cette Babel d’un genre inédit que l’auteur nous fait visiter. Non seulement les hommes qui y ont survécu ne se comprennent plus, mais ils en sont venus à se haïr à cause de la quasi-disparition du langage articulé, disparition qui entraîne une évolution devenue folle, laquelle, au lieu de les adapter à leur milieu, fait dégénérer les vivants, les condamne à la monstruosité d’une déchéance répugnante.
Le héros, Fifi, vit au sein d’une bande qui obéit à un certain Mentor, lequel « n’existe peut-être pas » ; Fifi a connu un vieux sage, qui dévorait les livres au sens propre, Domino, lequel lui a donné le goût de la langue et des pages animées par l’écriture – car l’écriture est bien l’âme de la page. Il s’est constitué un antre secret dans lequel il entrepose les livres qu’il ramène de la Grande bibliothèque (rappelons-nous que c’est aussi le sens du mot bible) ; il y séquestre une petite sauvageonne, Lalie (abréviation d’Eulalie, celle qui parle d’or), à qui il s’est mis en tête de transmettre ce qu’il sait de français. Avec elle, qui est supérieurement douée, il va découvrir les richesses de cette langue perdue, mais aussi le plaisir de vivre avec un autre être, non plus détesté, mais respecté, considéré peu à peu amicalement, à la manière dont le bœuf s’attache à son compagnon d’attelage, ce qui est le commencement d’une relation à qui il ne manque que la langue pour devenir une connaissance, une « co-naissance », si on s’exprime comme Paul Claudel.
Ainsi se créent des poches d’humanisation
Mais la langue n’est pas le seul moyen de sortir du chaos. En ramassant des débris et les classant selon divers critères, même stupides, on crée un ordre, une organisation qui anticipe une vie organique, organisée en société ; en affinant le choix des critères, on s’ouvre à l’intelligence du magasin, qui est l’antichambre de la science. En traçant des lignes droites à partir d’un point fixe, on transforme le fouillis des ruines en carte ; en mesurant ces lignes, en y plaçant des bornes rudimentaires, on recommence la lente montée vers la civilisation des voies. Lalie ira plus loin en réinventant, à partir des visages hideux des derniers humains, les masques du théâtre antique, elle partira représenter les combats des mots avec une petite troupe ambulante de comédiens grossiers. Ainsi se créent des poches d’humanisation.
Hélas ! la nature est plus dévastatrice que les hommes dégénérés, qui n’exercent plus pourtant que le seul « droit de nuire ». Des tremblements de terre apocalyptiques chahutent ce qui reste, entassant les ruines sur les ruines. Une horde de brutes saccage le repaire de Fifi, qui se réfugie un temps dans les arbres, où Pendeloque lui apprend à survivre. La nuit est permanente, opaque, puante, moite. Pourquoi cherche-t-on à survivre dans un tel monde ? Rien que l’obstination à continuer de marcher vers la mort, car le dernier abri du héros sera une tombe. Mais dans cette tombe, où il se nourrira de rats écrasés à coup de pierres, il se souviendra de l’écriture, il tracera sur les murs l’histoire de Lalie, celle qui est partie en emportant la langue d’or pour la faire entendre sur les scènes de la grande dévastation, pour l’animer obstinément dans des combats grammaticaux.
Ce mythe archéologique est écrit dans un style vigoureux, noir comme du Lautréamont, héroïque comme du Hugo quand il se dresse, fascinant comme du Baudelaire, celui des écrits intimes, du cœur mis à nu, du spleen qui gémit dans les âmes, lesquelles craquent à la façon des vieux meubles gorgés de souvenirs vermiformes. Avec ce livre, la littérature retrouve sa force fondatrice, son pouvoir mythologique, sa vigueur civilisatrice. Il faut lire Langue d’or, lire et s’enrichir de cette méditation poétique, qu’on dirait hantée, habitée par le début de l’évangile johannique : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. »
Et si le propre du chaos était une gémellité monstrueuse ? C’est peut-être cette idée qui a poussé Cécile Villaumé à écrire ses Histoires siamoises (éd. Le dilettante). Ne vous laissez pas dégoûter par la couverture, qu’il faut prendre sous l’angle de la sinistre hilarité du dessin de Louis Forton pour les Pieds nickelés ; souvenez-vous aussi des silènes du prologue de Gargantua, et nourrissez-vous de la haute graisse de ce recueil de nouvelles. Des nouvelles qui, au fil des pages, se libèrent des techniques anciennes, comme Cendrars et tant d’autres se mirent à écrire des vers libérés. Cécile Villaumé n’aime pas le monde nouveau qu’on nous impose ; cependant, elle prend plaisir à renouveler l’art, ce qui n’est pas paradoxal, puisque c’est la nouveauté tapageuse de la rue, qui oblige l’artiste à faire du neuf dans son in-pace.
Cécile Villaumé commence par Landru ; le mystère de son pouvoir séducteur l’irrite, mais au lieu de le scruter à la loupe, elle va le regarder de bien plus loin. C’est sa technique : partir de si loin qu’on ne s’attend pas à se trouver là où elle nous amène. Elle produit ainsi ce que les littérateurs appellent des chutes – si vertigineuses, si époustouflantes qu’elles invitent l’intelligence à remonter le fil des effets et des causes. L’auteur fait en quelque sorte un croc-en-jambe au lecteur, mais après une préparation subtile ; d’autre part, au lieu de le laisser chuter et se faire mal, elle le retient au dernier moment, et provoque ainsi son éclat de rire, qui soulage quand on a évité la blessure. Landru est historique, bien sûr. Partir de la dignité historique pour lui farcir le croupion de bonnes inventions soigneusement ciselées (comme on cisèle les herbes aromatiques), ça c’est un bon truc de cuisine, qui donne des résultats gastronomiques – on peut aussi supprimer le « g ». Je me demande si l’auteur ne descendrait pas de Custine ou d’Escoffier. C’est troublant, parce qu’il y a aussi en elle comme des relents de journalisme passé au gril. Elle adore saisir l’actualité, l’entrelarder de savoureux dialogues, qui fonctionnent selon la règle numéro un de notre nouvelle et délicieuse république : On doit discuter de tout à condition de ne pas savoir de quoi il s’agit. Dans ce domaine, elle a le génie de l’enregistrement : à lire les propos de ses bienyvres (qui, hypocrites par endoctrinement, croient n’avoir rien bu), on est convaincu d’entendre nos charmants contemporains exprimer leurs âmes de carton mâché, si joliment agrémentées d’opinions de mollusques.
Des mots dévastateurs comme une bombe à mèche lente
Et puis, elle a la sensibilité du grand reporter qui couvre – je n’ai pas dit qui couve – les épisodes les plus sanglants de nos aventures picrocholines. Paradoxalement, elle s’aventure plus loin que Philippe Comar, mais sans bruit, sans inventions difficiles, simplement en effaçant peu à peu tout ce qui reste, par des mots qui sont ceux qu’on adresse aux mourants en leur tenant la main, ces mourants que l’on fait mieux qu’aider à partir, puisqu’on les tue, qu’on leur enlève toute chance d’être secourus, et qu’on assaisonne leur désespoir par des mots gentils, des mots menteurs qui dégoulinent, des mots dévastateurs comme une bombe à mèche lente, ces mots dont nous abreuvent nos hommes politiques, nos dirigeants, nos médicastres politiquement neutres, à la façon de cette phase neutre qui ne sert à rien, si ce n’est à aider à disjoncter, à faire le noir.
J’ai rarement lu textes aussi déchirants que cette dissection progressive de notre folie qui bouge encore – sauf peut-être chez Ionesco, ou Beckett – déchirant, et hilarant. Car lorsqu’on vit chez les fous en sachant bien qu’il n’y a remède à la folie ravageuse dont ils s’enivrent, on en vient à s’amuser, à rigoler comme une mauvaise porte grince, en se disant que ce n’est pas possible, tout en sachant bien que c’est non seulement possible, mais que c’est arrivé, et que même ce n’est pas si nouveau, mais seulement qu’on est obligé de le voir enfin, de le confesser, qu’aujourd’hui il n’y a plus d’autre solution que de rire à gorge déployée, à en pleurer, et à accompagner ce rire d’histoires cyniques et désopilantes. Car il n’y a plus qu’à faire l’éloge de la folie, à refaire avec le premier humaniste la description de la folie de l’homme, folie originelle, naturelle, si absolue qu’il a fallu la mort ignominieuse d’un Dieu fait homme pour en venir à bout, à donner l’Espérance qu’Il en est venu à bout.
Langue d’or, Philippe Comar, Collection Hors série Littérature, Gallimard, 2024, 256 p., 21 €
Histoires siamoises, Cécile Villaumé, Le Dilettante, 2024, 192 p., 18 €