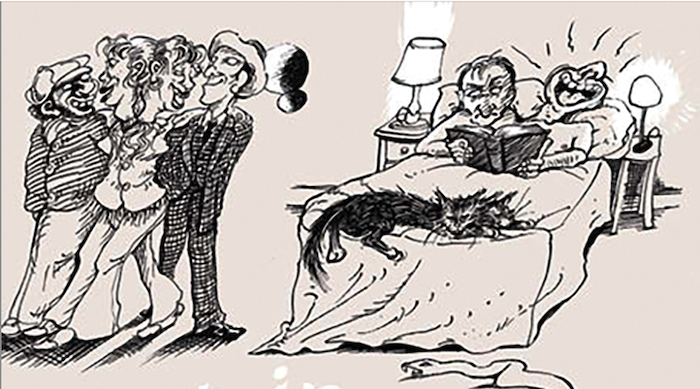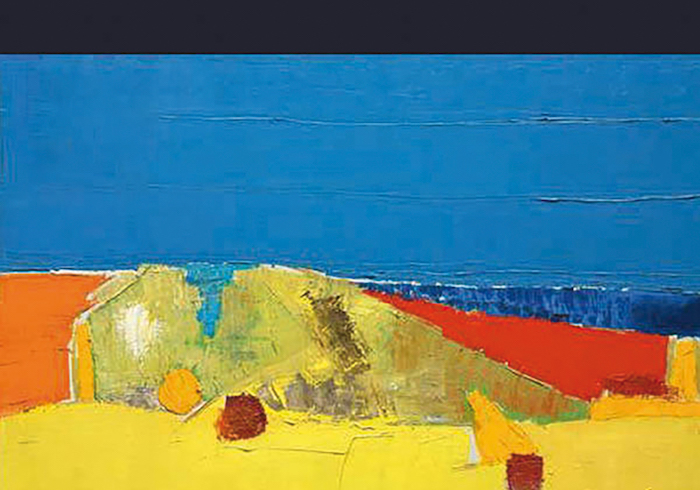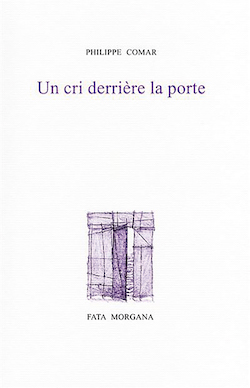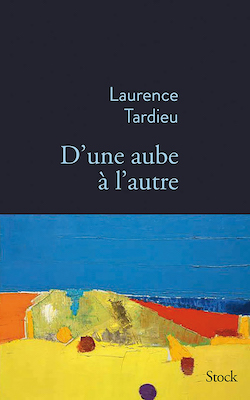Quelques écrivains audacieux nous proposent néanmoins de jeter un œil dans l’entrebâillement ; ils nous disent que ça n’a rien d’inquiétant, que c’est de refuser de voir qui est dangereux. Laurence Tardieu précise que tenter de fuir, si c’était possible, vouloir rester aveugles à ces ouvertures soudaines, cela nous priverait de la joie, d’une joie existentielle, la joie d’être vivant. C’est le sujet de son récit Vers la joie (éd. Robert Laffont). Elle y raconte sa sortie de l’angoisse, quand son fils de 4 ans et demi a pu quitter l’hôpital, arraché à une leucémie brutale. Il est vrai qu’il s’agit là d’un événement exceptionnel. C’est pourquoi je vous parlerai d’abord d’un petit livre de Philippe Comar, Un cri derrière la porte (éd. Fata Morgana).
Philippe Comar nous raconte un souvenir d’enfance qui a joué dans sa vie un rôle fondateur. Il avait cinq ou six ans, habitait avec ses parents au quatrième étage d’un immeuble de famille, dont le deuxième étage était occupé par son grand-père, « qui se prenait pour Dieu le Père et n’admettait pas qu’on en doutât », dont le troisième « était occupé par des étrangers : une mère et son fils déjà adulte », lequel « hurlait sans cesse avec une voix de stentor », qui terrorisait l’auteur enfant. On le disait fou, un mot étrange, qui désignait pour le gamin un état « insaisissable. Un état qui s’opposait à la permanence des choses, à leur rassurante stabilité. » Ce malheureux criait pour ouvrir des failles dans ce qui l’emmurait, et quand le jeune Comar passait devant sa porte, il « en pissait dans sa culotte ». Et puis, un peu à la fois, il a appris des choses qui l’ont apaisé ; mieux, qui l’ont éclairé.
Quand il sut que ce braillard était artiste peintre, il associa « folie et peinture », non pour les rejeter ensemble, bien au contraire, mais pour les entendre (souvenez-vous qu’entendre veut aussi dire comprendre, comme dans l’expression : j’entends bien). Il raconte : une fois seul dans l’appartement, « je me mettais à crier le plus fort possible, juste pour voir si j’avais quelque aptitude dans le métier d’artiste, car je rêvais de faire de la peinture. » Plus chanceux encore : ses parents lui offre l’ouvrage Mon premier livre d’art, où il découvre « le célèbre Cri peint par Edward Munch », ce qui lui confirme que la peinture et le cri sont mystérieusement liés.
La fonction même de nos souvenirs que d’assouplir l’inflexible flèche du temps
Un autre tableau de ce livre le fascine : Le bœuf écorché de Rembrandt, dans lequel il voit surtout l’ouverture du corps, tandis que dans le fond, « à demi cachée dans l’embrasure d’une porte », apparaît une tête d’enfant, qu’il prend pour la sienne, comme s’il était entré dans le tableau avant même de naître. Chose étonnante, il assistera bientôt à des opérations chirurgicales faite par son grand-père maternel à la clinique Sainte-Marthe. Loin d’être dégoûté, l’enfant est fasciné par l’ouverture de « la paroi du ventre », il contemple, dans une extase à la fois érotique et esthétique, le « trésor incomparable » des viscères, « un trésor aux couleurs de nacre, de corail, emperlé de gouttelettes rubis, qui valait pour moi tous les trésors des flibustiers. »
Autre événement capital, la mort de son frère, qui lui fut dérobée. Pourquoi ? Il rumine pendant des années cette question, et puis un jour, beaucoup plus tard, alors qu’il croit enfin avoir le courage de poser la question à sa mère, comprenant soudain que « la réponse n’avait aucune importance », il renonce. « Cette question […] était la porte qui s’était refermée sur la mort de mon frère. »
Les portes s’ouvrent et se ferment, tout se confond dans un temps qui « se retourne sur lui-même », c’est « la fonction même de nos souvenirs que d’assouplir l’inflexible flèche du temps. C’est également la fonction des œuvres d’art qui, elles, se déploient dans un continuel présent. » De ce fait, « les musées sont mes albums de famille », mais ne croyez pas pouvoir me suivre plus longtemps, nous confie enfin l’auteur, soudain inquiet : « les images s’effacent, les cris s’estompent », je n’ai plus « qu’une envie : fuir par une porte dérobée. » La puissance onirique de cette prose, lissée, luisante, est multipliée par les illustrations d’Edith Dufaux, qui l’inverse, comme un miroir. Vous y reviendrez souvent, tant elle donne envie d’ouvrir les portes fermées, et aussi de repousser celles qui se sont entrouvertes. Les repousser pour les fermer, ou pour les ouvrir en grand ? « C’est la question », à laquelle ces deux mots, cri et porte, pourraient sûrement répondre, en résonance.
Venons-en à l’autre livre – à l’autre rive. Donc, le fils de Laurence Tardieu a eu à 4 ans une leucémie, dont il a guéri. Cette terrible épreuve a appris à l’auteur que la vie est joie, non seulement quand l’angoisse prend fin, mais dans l’angoisse même, dans son intensité qui déchire. Difficile à croire, n’est-ce pas ? Pourtant, ceux qui ont traversé de grandes épreuves, ceux-là comprendront ce que l’auteur tente de nous dire. D’abord, « revenir aux faits, seulement aux faits », parce que dans les événements bouleversants, dont on sort sans plus très bien comprendre ce que c’est que vivre, il faut s’accrocher aux faits. Donc, l’auteur va prendre une trentaine de pages à revenir aux faits, à nous ramener à la banalité prodigieuse de ce qui s’est passé, pour bien nous enfoncer dans la tête – et dans la sienne – que cela a vraiment eu lieu : son fils Adam a failli mourir, elle s’est battu avec lui pour survivre, si violemment qu’il n’y avait plus rien que cette chambre d’hôpital où se livrait LE combat.
Là, elle a appris qu’il « y a le réel, visible, et la vie intérieure, invisible. » Que « parfois, le réel demeure […] si stupéfiant d’irréalité, que le sentiment de vie, le sentiment de vivre, n’appartient qu’à la vie intérieure. » Et ce sentiment nouveau rend étranger à sa vie, celle qui se déroule dans le monde, pour donner le sentiment de « vivre dans un présent atomisé » ; « la vie semble avoir repris », mais plus rien ne se lie, « tout demeure cisaillé. » Il faut inventer une nouvelle manière de vivre, donc faire des choses impensables dans la vie d’avant, comme acheter une petite chatte en ayant l’impression « d’avoir fait un truc dingue », et c’est ce « truc dingue » qui va réinventer le monde. Un monde où chaque instant prend une « intensité déchirante », sans liaison avec quoi que ce soit : « c’est violent, ça m’arrive d’un coup, au détour d’un instant. Et ça m’abandonne là, ça me jette dans l’instant suivant sans que je sache que faire de cette brûlure de joie. » Car vivre est devenu joie, non pas plaisir, joie. Une expérience neuve, qui bouleverse tout. Qui fait de la vie un fatras, qui éblouit. Et celle qui ne vivait que pour écrire, qui voudrait écrire ce qui la fracasse, n’y parvient plus, comme si « le combat se jouait désormais entre écriture et extinction, entre une possibilité de re-mise au monde par l’écriture, et l’implacable anéantissement des choses. » Des choses d’avant.
Nous vivons avec intensité avec ceux que nous aimons, qui nous ont aimé, qui reste en nous par le cœur quand ils sont partis
Pourtant elle tient son sujet : « la joie terrible, violente, de ce 24 août 2020, alors que, la main d’Adam serrée dans la mienne » nous quittons l’hôpital « dans une lenteur infinie […] comme si, avançant, nous n’avancions pas. » C’est quelque chose comme le fruit « d’une épopée terrifiante et insensée, aux confins de la vie, et celle d’un amour fou, celui d’un fils et d’une mère. » Et elle va nous le faire vivre par des procédés poétiques et narratifs entremêlés, qui chantent, retrouvant les secrets des poètes les plus délicats, de ceux qui nous font marcher dans les nuages comme si nous étions sur la grand route.
Souvenez-vous : « Je ne chante Magny, je pleure mes ennuis,/Ou pour le dire mieux, en pleurant je les chante… » Eh bien, l’expérience de Laurence Tardieu est bien plus radicale, en fait, totalement autre. Elle n’enchante rien, elle est enchantée, projetée dans un autre monde. Rien qui le dise mieux que cette scène prodigieuse : l’auteur marche dans des ruelles connues, et cela « se révélait soudain n’être qu’un décor qui venait de s’ouvrir, m’aspirant brutalement dans sa béance. […] Et soudainement celle qui marche dans ces ruelles désertes, n’est plus seulement moi, celle qui marche en cet instant, se hâtant en direction de la faculté de pharmacie dans l’air vivifiant de ce matin d’automne, est aussi ma mère », qui a fait ses études dans cette faculté. L’auteur accepte « de céder à l’impensable, je suis elle et je suis moi […] je suis celle que j’ai perdue il y a près de vingt-cinq ans et qui s’est tenue pendant tout le printemps 2020 des jours et des jours assise » dans la chambre d’hôpital où je luttais avec Adam.
Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une fumeuse expérimentation de connexion avec les esprits des morts. Il s’agit d’une expérience de vie : nous vivons avec intensité avec ceux que nous aimons, qui nous ont aimé, qui reste en nous par le cœur quand ils sont partis, qui nous soutiennent quand nous revivons les drames qu’ils ont vécus. C’est raconté avec la clairvoyance étonnée et la délicatesse lumineuse d’une âme féminine, avec des mots ranimés par l’amour envers sa mère d’une fille devenue mère à son tour. « Pour toujours je tiens la main de ma mère, pour toujours je tiens celle de mon fils. […] Tout est bien. »
Un cri derrière la porte, Philippe Comar, Fata Morgana, 2025, 48 p., 14 €
D’une aube à l’autre, Laurence Tardieu, Stock, 2022, 220 p., 19,50 €