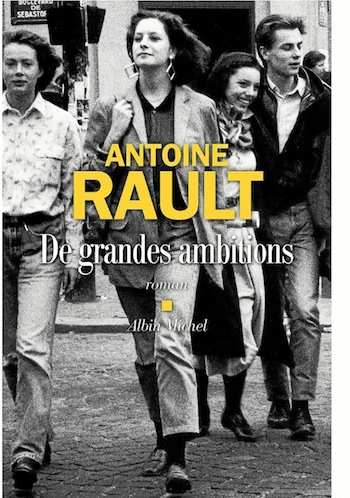La tragédie classique prend pour sujet une situation historique, ou supposée telle, et perce à jour les ressorts des caractères de ceux qui y figurent afin de rendre vraisemblables leurs actions. Elle choisit souvent des personnages antiques, mais il lui arrive de mettre en scène des contemporains, comme dans Bajazet. Antoine Rault va au bout de l’audace racinienne en se saisissant de personnages engagés dans notre actualité, et dont le destin reste, pour certains, suspendu. Dans De grandes ambitions (éd. Albin Michel), il utilise aussi l’antique machinerie des vies parallèles : ce roman pourrait se réduire aux vies parallèles de Frédéric Legrand et de Jeanne Dolman, personnages de fiction que le lecteur n’a aucune peine à identifier à notre président jupitérien, et à sa rivale obligée. Multipliant la figure, Antoine Rault place autour de ses têtes d’affiche des personnages caractéristiques de notre temps, et qui, eux aussi, vont par deux, unis par l’amitié, exigeante et fragile, liés par de faux amours ou de vraies passions, enchaînés par des intérêts qui s’épaulent et les déchirent. Les gens de finance occupent le premier plan de l’arrière-monde, puis ceux qui leur fournissent les moyens électroniques de la puissance, les spécialistes des machines dites intelligentes, des logiciels et des algorithmes, tout cela entremêlé avec les passions fondamentales de notre pitoyable espèce, dont le sexe, habillé de différents costumes plus ou moins carnavalesques : minitel rose, dévergondage, jalousie, générosité, mépris, gratitude, scandale… Bref, le cirque, pour ne pas employer un mot plus cru.
La guerre que se livrent les ambitieux d’aujourd’hui n’use point des violences archaïques. Il s’agit de faire le renard bien plus que le lion, le renard qui sait, quand il est pris la main dans le sac, employer les dénégations, ou se masquer de la naïveté de celui qui s’amuse. Car tout le monde se divertit, en vérité, même si les divertissements de ces gens-là sont bien souvent pitoyables, avec des conséquences malheureuses.
Ce qui mène Frédéric Legrand, c’est une certaine ingénuité qu’éclaire l’amour de sa femme plus âgée, donc bonne conseillère, rassurante comme une mère, tutélaire et tendre. Ce qui explique Jeanne Dolman, c’est une enfance mal fichue. Elle aurait aimé un père attentif, non un maître dur, distant, corrosif. On a besoin de chagrins, mais bien gradués, finement dosés, afin qu’ils nous fortifient sans occasionner des blessures qui ne cicatrisent pas, et rendent l’âme inquiète. Tout cela se déploie au fil des années, car c’est avec le temps que les vérités nouées se manifestent, et vous étranglent doucement, traîtreusement. Ainsi conduit, le tragique n’a rien de brutal. Antoine Rault se moque de la règle des trois unités dont il prend le contrepied : pas d’unité de temps, mais les fils encroisés de l’écheveau des années, comme dans ces grandes tapisseries moyenâgeuses dont le modèle est la telle de Bayeux ; pas d’unité d’action, mais la multiplicité des actes qui s’entremêlent pour fabriquer des destinées ; pas beaucoup plus d’unité de lieu, ni de milieu. Ce faisant, il nous fait découvrir le tragique de la vie ordinaire, qui est de s’acheminer vers l’échec ultime, même dans la réussite la plus brillante.
Ainsi Sonia, l’héroïne qui justifie le plus fortement l’allusion du titre à Dickens, jeune fille d’origine maghrébine, arrachée aux coutumes étouffantes par l’intervention de ses professeurs, qui va devenir une politique prestigieuse à force de ténacité intelligente et généreuse, même elle, si lumineuse, est habitée par les ombres du gouffre où la vie nous fait descendre, dans une solitude qui aigrit. Elle s’est laissée séduire par les ambitions aveuglantes, qui font accomplir des choses admirables, mais se soucient peu de polir le diamant de notre âme. Car c’est la pénible leçon qu’il faut ruminer : si tant de vie sont des échecs, c’est que peu savent ce que vivre veut dire. Nous croyons qu’il faut monter, grossir comme la grenouille de la fable, quitte à en crever. De grandes ambitions ne donnent pas la sagesse, qui est d’un autre ordre que l’effort pour conquérir une place glorieuse. Cependant, il est beau de s’efforcer. Que faire alors ? Voilà proprement le tragique de l’ambitieux : sa réussite le met dans la nécessité de choisir, alors que sa situation rend tout choix détestable. Il ne comprend pas que l’issue est hors de la situation qu’il a voulue, à laquelle il devrait s’arracher.
L’attentat du Bataclan, qui introduit le tragique de la violence, va ouvrir une brèche. Loin de décrire le carnage, l’auteur fait le choix heureux de montrer son héroïne Clara, la grande chirurgienne, opérant les victimes avec un dévouement passionné. Prisonnière de la bulle de son métier, elle le pratique comme une fuite, peut-être parce qu’elle prétend vivre comme une Médée généreuse, dont la devise serait : « moi seule, et c’est assez ». Cependant, la vie est parfois bienveillante pour ceux qui se veulent généreux si maladroitement, comme le lecteur le découvrira in fine.
L’auteur ne prend jamais la parole, laisse à ses personnages le soin d’exprimer les avis les plus opposés afin de rendre l’inutilité de nos pensées, la complexité douloureuse de nos émotions, la misère de nos choix, puis la grande pitié de nos échecs. Un peu de lumière éclaire les dernières pages, précaire, incertaine, sur quoi le romancier a choisi de nous laisser, peut-être mû par ce grand secret : le désespoir est une sottise.
Je proposerai de lire à la suite un essai traduit de l’américain. Parce que William Bonner, l’auteur de Gagner ou perdre (éd. Les Belles Lettres), est un homme qui a de la plume, de l’humour, de la finesse, et une des plus belles intelligences avec laquelle vous puissiez entrer dans cette conversation merveilleuse qu’est la lecture. Sans aucune prétention, il dit souvent qu’il ne sait pas, se mettant ainsi dans les pas de Montaigne, ce qui ne l’empêche pas, comme lui, d’avoir de solides convictions, et une belle collection de certitudes qui font plaisir à être lues. Bourrée d’anecdotes et d’aperçus originaux, racontée avec le talent du causeur brillant, son histoire est un régal sans points morts, sans digressions ennuyeuses.
Un beau projet le mène : nous proposer un schéma simple pour éclairer l’histoire des civilisations, mieux encore : pour distinguer la civilisation de la barbarie. Dieu sait si nous avons besoin de cela aujourd’hui !
Son idée est que la civilisation repose sur des marchés gagnant-gagnant, et la barbarie sur des marchés gagnant-perdant. Il y a toujours un mélange des deux dans les relations humaines, mais il faut que le premier type l’emporte sur le second pour que les hommes vivent à peu près satisfaits. Le marché gagnant-gagnant fondamental, c’est le mariage, le vrai bien sûr. Quant au gouvernement, quel qu’il soit, il ne fait que des marchés gagnant-perdant. Le meilleur gouvernement est celui qui propose le moins possible de marchés, et laisse les particuliers en faire le plus possible, parce que les particuliers font presque naturellement des marchés gagnant-gagnant, surtout quand ils ont pu grandir dans une famille dont le fondement est le mariage. Ce qui veut dire que le meilleur gouvernement ne se mêle que de ce qu’on appelle les fonctions régaliennes, et que le pire se mêle de tout. La pente de la démocratie, c’est évidemment, comme nous le constatons chaque jour, de se mêler de tout, et conséquemment de tout ruiner. Voilà pourquoi votre fille est muette !
Tout cela néanmoins n’est que l’os de ce livre charnu. Au lecteur d’en découvrir les chairs, d’en savourer les succulences. Quand il sortira de cette lecture, je gage qu’il se sentira saisi par la grande paix de l’intelligence, non celle qui dogmatise, mais celle qui donne de la lumière, et l’impression de pouvoir mieux regarder le monde touffu où nous sommes égarés, de le traverser avec moins d’inquiétude, parce qu’il est devenu explicable, compréhensible.
Avec Antoine Rault, nous pouvons, comme le démon des contes, soulever les toits pour observer les hommes et leurs secrets ; avec William Bonner, nous n’avons plus ces curiosités, mais nous sentons pour nos frères humains une grande mansuétude, parce que nous avons l’impression de savoir pourquoi ils sont malheureux. Et pouvoir expliquer les folies des hommes rend bienveillant.
- De grandes ambitions, Antoine Rault, Albin Michel, 582 p., 22,90 €
- Gagner ou perdre, William Bonner, Les Belles Lettres, 344 p., 23,90 €