Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Nous ne manquons pas de bons romanciers en France ; maîtres artisans indifférents aux modes exotiques, ils maintiennent la grande tradition de notre roman humaniste. Antoine Rault est de ceux-là.
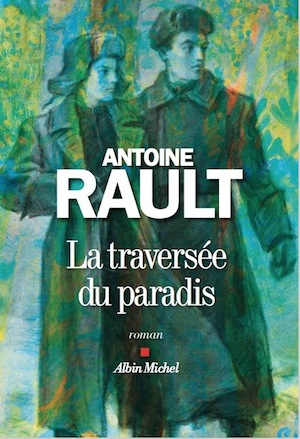
Le vrai sujet de son dernier livre, La traversée du paradis (éd. Albin Michel), c’est la continuation, au moyen de l’outil romanesque, de la méditation pascalienne sur « le cœur de l’homme, creux et plein d’ordures », ce qui permet d’aller au plus près de ce « monstre incompréhensible » que nous sommes, à nous-mêmes autant qu’à nos frères humains.
Le mot « paradis » est évidemment ironique, puisqu’il désigne l’enfer bolchevique, bricolé par Lénine et sa bande de délirants. L’auteur nous montre à l’œuvre ces nains hargneux, enfermés dans leurs bureaux fortifiés de paperasses contre la réalité du monde, et décidant de la mort de milliers d’hommes sans rien savoir de l’horreur de leurs actes, qu’accomplissent pour eux des petits salopards, des rats minables, des imbéciles béats, des idiotifiés d’idéal. Quelle peinture ! Pour qu’il arrive à rendre cela si vivant, on en vient à se demander si le romancier n’aurait pas vécu plusieurs autres vies dans la peau de ces habitants d’un monde englouti. Mais non, c’est bien par la seule puissance de l’imagination créatrice qu’il reconstitue ce qui a disparu, lui donne une présence hallucinante.
Une imagination qui se déploie dans l’art du portrait et des caractères (au sens de La Bruyère) – ceux des personnages inventés, autant que ceux des personnages historiques rendus à la vie – ; dans l’évocation d’une ville saisie par la mort – Saint-Pétersbourg, « la perle du Nord », deux millions d’habitants avant la révolution, devenue Petrograd, « une ville morte », n’abritant plus que 200 000 gueux crasseux, affamés, ramenés à l’animalité la plus répugnante par des fous, et dont tel passant entrevu paraît « sorti d’un tableau de Brueghel » – ; dans des ciels de peintres, « des nuages de feutre épais », des paysages éperdus de beauté, aussi bien que dans des scènes dantesques que Bosch ou Bouts auraient pu peindre dans leurs enfers de retables – ; dans des répliques si criantes de vérité, dans des dialogues si justes qu’on se croirait au théâtre quand la pièce est réussie – rien d’étonnant : Antoine Rault est aussi un dramaturge de qualité.
Et si tout cela ne suffisait pas, l’auteur nous offre en prime une étude historique sur ce déplorable XXe siècle, révélant un épisode négligé de la traîtrise de l’Allemagne, qui, dès 1920, entreprit de reconstituer secrètement son armée sur le territoire de la nouvelle Russie bolchevique en ruines. L’écrivain visionnaire nous fait pénétrer dans les cervelles qui conçurent ces plans d’une redoutable efficacité ; en découvrant ce cloaque, nous comprenons que la sottise des Alliés et la roublardise des Allemands ont conduit à la seconde guerre mondiale aussi sûrement qu’aurait fait un destin écrit par les dieux. Sans ces menteurs de tous bords, pas d’Hitler, pas de Staline.
Car les menteurs sont partout ! Et c’est là que nous revenons à Pascal et à ses amis jansénistes. Le père du mensonge, c’est Satan, bien sûr ; mais les menteurs, ce sont les hommes – tous sans exception, ainsi que l’affirme David (psaume 116,v.11) ! Comment pourrions-nous vivre sans mentir ? Aux autres, bien sûr, à ceux qu’on aime d’une passion folle comme à ceux qu’on hait, mais aussi à soi-même. Comment pourrions-nous supporter de regarder en face la vérité sur nous-mêmes ? Réinventé par le mensonge, on se trouve enfin fréquentable, tant notre être véritable nous est insupportable !
C’est ce qu’illustre le destin du héros, amnésique de guerre, dont les services secrets ont fait un Gustav Lerner afin de l’utiliser comme agent double. Le vrai Gustav Lerner est un soldat allemand disparu dans les combats de la Baltique, dont la mère continue d’attendre le retour. Or, et c’est une trouvaille géniale, voilà que le faux Gustav Lerner veut connaître la mère de celui dont il porte le nom. Elle sait que ce n’est pas son fils, mais elle va le prendre pour son fils, elle va l’aimer comme son fils revenu de la mort. Cette femme est merveilleuse d’amour donné, qui est aussi égoïsme, car c’est pour elle qu’elle joue cette comédie – qu’elle se donne cette chance d’avoir un fils quand même, pour ne plus être seule. Après Pascal, c’est à La Rochefoucauld que nous voilà renvoyés.
Le cheminement de cette femme est éclairé par celui qu’a suivi une autre mère, celle de Tamara. Engrossée à 16 ans, Tamara a laissé sa petite Sonia à sa mère, qui l’a élevée comme sa propre fille et refuse de la rendre, soutenant que la vraie mère n’est pas celle qui engendre, mais celle qui élève, nourrit, fait grandir. Tamara en vient à douter de ce qu’elle est. Qu’est-ce qu’une mère ?
Et les bourreaux sont-ils des bourreaux ? Tamara va retrouver le père de sa fille devenu tortionnaire à la Tcheka, elle va essayer de le reprendre, mais il lui explique qu’il est un monstre, qu’il s’en fiche d’être père. Cependant, c’est lui qui prendra des risques mortels pour rendre Sonia à sa mère et les faire passer en Finlande avec l’homme qui l’aime, ce Gustav Lerner qui est descendu en enfer pour cette femme déchue, croisée dans un bar. Parce que si le cœur des hommes est plein de boue, c’est qu’une eau y dort, qu’une source de générosité y attend pour jaillir qu’on la désire violemment. Quant à l’autre tchékiste, Boris, qui a aimé Tamara au premier regard mais refuse de l’admettre, c’est un tueur vertueux, qui pense faire advenir la cité du bonheur en massacrant ; cependant, Tamara lui répète obstinément qu’il est un brave type, et, résultat imprévu, il finit tellement terrorisé par les images de ses tueries qu’il se suicide.
Car si l’imagination rend le romancier capable de faire vivre un monde, elle peut aussi tuer ceux qu’elle obsède. Est-ce la volonté de bien faire son travail de tueur qui exprime la vérité de Boris ? Ou est-ce cette imagination blessée qui lui fait sentir de plus en plus tragiquement qu’il est un monstre ? Il ne le saura pas, puisqu’il fuit la révélation en se suicidant. Par contre, Gustav, apprenant enfin qui il était avant la guerre, choisira de vivre en restant l’homme qu’il s’est fait, parce que c’est ce Gustav fictif qui a été capable d’aimer Tamara et de partir à sa recherche en traversant le paradis bolchevique. Cet Orphée réussit à faire revenir son Eurydice à la vie, mais c’est parce qu’il n’est pas Orphée, qu’elle n’est pas Eurydice, qu’ils ne savent pas qui ils sont, mais qu’ils ont décidé d’inventer à deux les amants qu’ils seront.
Vivre, c’est s’inventer un destin, se modeler un caractère en traversant une histoire, s’arracher à la boue qu’on porte en soi, y vouloir une source vive, marcher vers elle dans l’épuisement, au-delà de la fatigue et de l’espérance, faire un pas, puis un autre, et encore un autre, en répétant que « ça va aller ». C’est tout cela que nous raconte Antoine Rault, dans une langue sans faille, d’une perfection aussi évidente qu’inexplicable.
Oui, un grand livre, qu’on lit avec bonheur, et qu’on a aussitôt envie de relire.
N.B. : il constitue la suite de La danse des vivants, mais se lit indépendamment sans problèmes.

Saint-Pétersbourg vaut mieux que Leningrad.