La vision prométhéenne dominante transcende l’homme mais oublie la nature. Revenir aux fondements de notre culture, c’est retrouver des références anthropologiques : une vision de l’homme comme être de relations équilibrées. L’écologie ne sera alors plus une idéologie, mais une éthique.
[groups_non_member group= »Abonné »]
[/groups_non_member]
[groups_member group= »Abonné »]
Au risque – assumé… – de passer pour un écolo-sceptique, ce que l’on voudrait suggérer, c’est qu’au-delà des dangers bien réels sur lesquels l’écologie veut à juste titre nous alerter, elle comporte en elle-même un risque et que donc se justifie, à son endroit également, la mise en œuvre du principe de précaution.
En précisant aussitôt, pour ne pas généraliser abusivement, que ce risque est plus spécifiquement français.
Pour le saisir, il faut repartir de ce que Marcel Gauchet a appelé « le mystère de l’idéologisation de la vie politique française », sachant qu’un mystère n’est pas quelque chose qu’il ne faut pas chercher à comprendre, mais au contraire quelque chose qu’on ne finit jamais d’explorer.
Dans cette perspective, l’une des sources les plus lumineuses de ce mystère (source « illuministe » pourrait-on même dire !) tient aux caractères fondamentaux du déploiement de notre modernité. L’axe en est, on le sait, la revendication d’une autonomie humaine absolue et d’une capacité sans limite d’autocréation. Prométhée, disait Marx, doit devenir le premier saint du calendrier moderne, rationaliste et laïque. Laïque : l’un des principaux vecteurs de cet anthropocentrisme moderne fut, précisément, la volonté d’éradiquer le noyau dur de transcendance religieuse qui était jusque là au cœur de notre société et fondait sa structure hiérarchique. Au sens étymologique de hiérarchie : le commandement du sacré.
Mais comme on ne détruit bien que ce qu’on remplace et que la nature – nous y voici… – a horreur du vide, il fallait bien remplacer ce noyau par quelque chose. Et ce fut alors l’invention, proprement française, de tous ces succédanés de transcendance qui ont prétendu redonner une âme à notre vie publique : la Révolution, le Progrès, la République… et aujourd’hui la Société, nouvel englobant-porteur. Bref, toutes les recompositions, y compris les plus dévastatrices, de l’humanisme athée.
Des idées du bien à la dérive
La question qu’on ne peut pas ne pas se poser est alors : l’écologie ne serait-elle pas un ultime avatar de ce vain processus de retranscendantalisation ? Un avatar bien ambigu qui ne serait que le revers de la Technoscience – autre idole moderne – et peut-être même une ruse de la raison scientifique lui ouvrant de nouvelles avancées. En tout cas, une nouvelle épiphanie de notre mystère d’idéologisation…
Car ce que nous avons vécu et vivons à l’extrême aujourd’hui, c’est l’échec cumulatif de tous ces mythes, de toutes ces idées du Bien. Au point même – c’est ce qui fait le tragique de notre époque – que nous en sommes arrivés, non seulement à refuser toutes les idées du Bien, toutes les visées globales d’un possible bonheur, mais même les idées tout court. Défaite intégrale de la pensée : quand il y a des idées, ce sont plutôt des idées du Mal et souvent des idées incertaines. Ne serait-ce pas un peu le cas avec l’écologie ? Quelle que soit la générosité de ses promoteurs, elle est bien d’abord une idée du Mal – une heuristique de la peur, disait Hans Jonas –, la « pollution » rejoignant le nazisme et le racisme au Panthéon de nos démons répulsifs… Naissance d’une nouvelle religion de substitution mais naissance problématique car la promesse est malformée.
Il y a un souci écologique mais il n’y a pas d’écologie comme visée politique globale. Sauf à céder au vertige de la pensée globalisante, ce qui est le propre de l’idéologie. Il n’empêche, beaucoup donnent l’impression de vouloir la faire advenir malgré tout, au forceps s’il le faut. Pourquoi ? Parce que le contexte politique français l’exige. Dépourvue de tout projet économique et social crédible et ayant expérimenté les risques d’aborder de front les questions sensibles – celles de la vie et de la mort – , la gauche trouve là le moyen de les envelopper dans un emballage plus soft et consensuel. Et la droite, qui n’est jamais en reste de suivisme idéologique – ne serait-ce que pour ne pas indisposer les médias – lui emboîte le pas.
Les églises, l’église aussi. Et elle prend un risque. Celui de la récupération. Sauf si, au nom du dépôt de transcendance dont elle est la gardienne, elle dégonfle la baudruche idéologique et la ramène sur le terrain qu’elle n’aurait jamais dû quitter, celui de la morale. De l’éthique, si on veut, pour faire moderne. Ce qui est le cœur – pas forcément aisément repérable, et c’est dommage – de l’encyclique du pape François.
Ethique
Car les problèmes, on l’a dit, sont réels. Mais avons-nous besoin – la question est d’ailleurs identique pour la laïcité – de construire des usines à gaz idéologiques pour les traiter ou re-traiter ? Constructions dont on voit bien qu’elles finissent par être plus des obstacles que des aides à leur solution.
N’avons-nous pas plutôt à réactiver les ressources de notre tradition philosophique et morale largement suffisantes pour éclairer les enjeux et orienter les décisions. Au-delà du climat, de l’environnement, la question de fond est bien en effet une question d’ordre éthique. Alain Finkielkraut l’avait par exemple remarquablement problématisée, voici longtemps déjà, dans son Nous autres modernes (Ellipses 2005). Cette question, c’est celle des limites, avec sa double entrée.
Première entrée : où passe désormais la limite entre l’homme, l’animal et l’objet ? Il y a-t-il encore quelque chose comme « une nature » au sens humain et au sens cosmique ? Il y a-t-il un donné ou seulement du construit… ?
Seconde entrée : jusqu’où ne pas aller trop loin dans la surpuissance s’agissant aussi bien de l’homme que du cosmos ?
La réponse à cette double question suppose de pouvoir s’appuyer sur une vision du monde et de l’homme différente de la vision prométhéenne dominante. Cette vision n’est pas à inventer, sauf au sens où l’on invente une source : elle est à retrouver dans les fondamentaux de notre tradition judéo-chrétienne. En lisant Laudato si’, on voit bien que là se trouvent intactes les références anthropologiques qui nous manquent : une vision de l’homme comme être de relations équilibrées avec Dieu, avec lui-même, avec les autres, avec le cosmos. Et sur ce dernier point, l’équilibre à trouver est celui entre l’homo faber et l’homo conservator : l’homme et la nature sont des dons issus du dessein d’amour de Dieu et quant à la nature, nous avons à la faire fructifier non seulement pour pouvoir la transmettre aux générations futures mais aussi pour la conduire à la réalisation de ses buts transcendants.
Sur ces fondements, l’écologie n’est plus une idéologie mais une éthique : une éthique personnelle, une éthique institutionnelle, une éthique économique. Une éthique intégrale de la responsabilité dans la subsidiarité. Observons simplement que ces fondements de la tradition judéo-chrétienne rejoignent, bien sûr, l’impératif kantien – ne rien instrumentaliser – mais le rejoignent en amont de sa laïcisation en lui donnant une assise intangible. Si on évacue l’idée de nature, il n’y a plus de limite au prométhéisme. Et notamment pas celles de la politique et du droit : il y a déjà eu des centaines de conférences, d’accords, de traités sur l’environnement.
Benoît XVI le disait déjà dans son discours devant le Bundestag en 2012 : « Quand, dans notre relation avec la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous devons tous réfléchir sur l’ensemble et nous sommes tous renvoyés à la question des fondements de notre culture… Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence, (mais) l’homme possède aussi une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté. L’homme n’est pas seulement une liberté qui se crée de soi… »
[/groups_member]
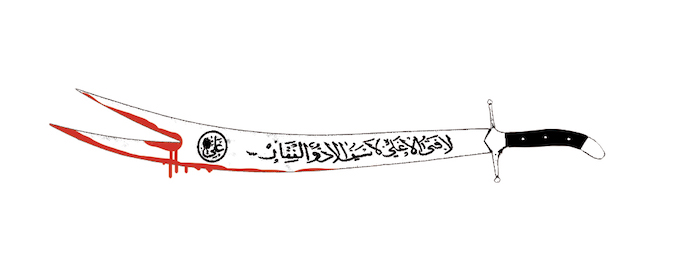

![Le risque écologique : idéologie ou éthique ? [PM]](https://politiquemagazine.fr/wp-content/uploads/2015/07/Chalvidan.jpg)



