Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
Voici que paraissent deux livres pour y regarder de plus près. Le premier, L’homme sans fil d’Alissa Wenz (éd. Denoël), nous raconte l’histoire d’un pirate informatique.
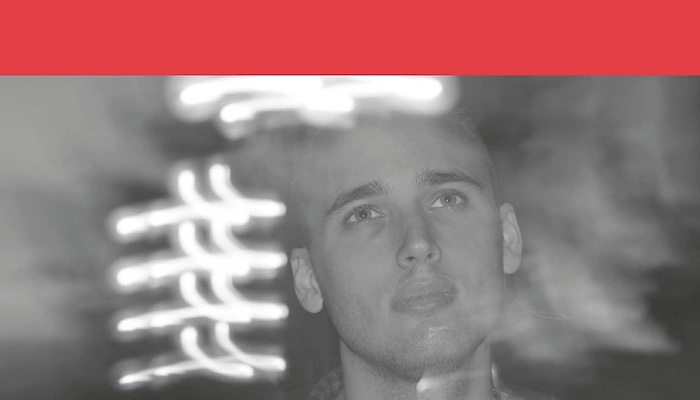
Alissa Wenz s’inspire de faits réels, rapportés par des articles de journaux, dont elle donne les références dans une bibliographie copieuse. À partir des événements de la vie de Lamo, un pirate informatique américain, elle tente de reconstituer son univers intérieur, d’éclairer ce qui peut conduire un jeune homme brillant à s’enfermer dans un piège destructeur. Ce pirate ne fracture les systèmes que pour en révéler les failles, en informer gracieusement les propriétaires, si tant est qu’on puisse encore se dire propriétaire d’un outil dont on maîtrise si peu les arcanes.
Lamo, qui a recherché la solitude en la jugeant nécessaire à l’exercice de ses talents, découvre peu à peu qu’elle est un bagne auquel il s’est condamné, qu’il s’en est constitué un destin tragique. Dans la tragédie classique en effet, le destin est un sort que nous nous suscitons, auquel nous nous livrons, croyant ainsi nous accomplir et nous distinguer, alors que sa fin véritable est de nous tuer. L’auteur le dit dans une formule terrible : Lamo « s’avance vers la maturité comme vers une guillotine. » Car dans l’effervescence de la jeunesse, on ne sait pas ce qu’on fait ; Lamo a cru sauver quelques prisonniers du clavier, il y est peut-être parvenu parfois, mais il ignorait son propre enfermement.
Alissa Wenz montre que l’intelligence très supérieure de Lamo ne le sauvera pas, car il s’agit d’une intelligence technique qui fonctionne comme une machine, qui fait de lui une mécanique que non seulement il ne maîtrise bientôt plus, mais qui le blesse, le ravage de l’intérieur. C’est ce que comprend une femme amoureuse, qui voit en lui cette « intelligence comme une plaie ouverte ». Car pour une intelligence si vive, qui va plus vite que nous ne pouvons sentir et avoir des émotions vraies, la vie ordinaire, la vie que chacun trouve normale, apparaît comme une « vaste escroquerie ». Très tôt, sa mère a compris qu’il ne saurait pas vivre, qu’il ne saurait pas s’aimer assez, parce que, s’il a « de l’amour à revendre, il n’arrive pas à y croire pleinement. » Alors, une fois arrêté, de la même manière qu’il ne reste auprès de sa mère « que sous la forme [d’un] récit », il tentera de se donner une vie en se racontant « devant les caméras », parce que « se raconter, c’est se faire exister. » Le récit vise à remplacer ce qui n’a pas été vécu ; hélas ! la vie évitée – comme on évite un obstacle – ne se retrouve jamais.
Très finement, l’auteur analyse ses relations amoureuses ou amicales comme des tentatives impossibles d’être vivant en étant présent à l’autre, et que l’autre soit totalement donné. De même que le pirate rêve de systèmes informatiques parfaits, sans failles, il rêve d’une « présence » totale à celle qu’il aimerait ; il ne s’agit pas d’un bel idéal, mais de la marque d’une ambition démesurée, qui a rompu tout contact avec la réalité. « Il aimerait avoir une prise, retenir quelque chose, quelqu’un. S’accrocher à un bout de bois, à une main, à l’espoir d’un rivage. S’accrocher à un corps. S’accrocher. Être présent au monde. Mais il n’y a pas de main. Pas de contact. Il dérive et il le sait. » Il en est tellement convaincu qu’il croit être comme tout le monde, qu’être « véritablement ami, personne ne sait ». Pourtant, il s’agit de son drame personnel, que « la petite musique des solitudes modernes », le crépitement des claviers, répand néanmoins comme une peste, bien plus terrible que les épidémies dont on s’alarme sottement. Plus personne bientôt ne saura comment être avec quelqu’un, réellement, en présentiel comme disent les malades de la langue, qui sont en réalité des amputés de l’âme.
Alissa Wenz construit son roman avec habileté ; elle écrit une langue variée, tantôt sèche, tantôt fluide et douce. Le lecteur peut être parfois dérouté, comme on est dérouté par ces ronds-points qui donnent le tournis, mais il retrouve vite son chemin et découvre des pays surprenants, qui lui sont familiers mais qu’il n’avait jamais bien regardés. L’auteur met de l’art dans des situations où il n’y a que des ombres ; ainsi, elle éclaire les ombres. À première vue, c’est peu différent de l’entreprise de Marie Sizun.
Marie Sizun s’est approchée de tableaux qu’on regardait d’un peu loin, elle y a vu Les petits personnages, qui font le titre énigmatique de son recueil de « fantaisies » (éd. Arléa). Le principe est simple : vous prenez un paysage, un décor peint, avec un personnage à peine esquissé, sans importance ; vous le regardez alors, ce petit, avec curiosité, avec une imagination bienveillante, vous vous laissez guider par l’atmosphère, et vous voyez en lui une fête, ou un drame, une histoire toujours, une âme qui vient donner un sens possible à la peinture.
Le tableau est reproduit en tête du texte ; Marie Sizun le décrit cependant, parce qu’en le décrivant justement, avec un sens aiguisé de l’observation, elle passe de la toile à la vie, elle anime la scène, la préparant ainsi à recevoir son hôte : le petit personnage. Elle nous le montre dans son coin, elle nous intéresse à lui, aux questions qu’il nous pose par sa présence énigmatique, elle entre dans cette esquisse, y découvre, y invente une âme, une vie, un monde. C’est quasi de l’art japonais, celui du haïku ou de l’estampe : quelques traits, et se lève un monde d’émotions. Ce pourrait être une nouvelle, mais c’est une fantaisie, parce que l’histoire imaginée nous est donnée sans garantie, avec l’envolée d’un soupir, le repos d’une main qui glisse sur une autre main, et tant de mystères suggérés, apposés comme les touches d’un aquarelliste, les traits d’un pinceau de calligraphe.
Chaque fantaisie est originale ; parfois, elle donne la clé du tableau, elle explique un peu le caractère du peintre ; le plus souvent, elle s’éloigne de ce qu’on voit, elle ouvre la scène comme un fruit et nous fait savourer quelque noyau mystérieux. Elle nous fait passer à travers la toile, prendre un chemin qui va au-delà de ce qu’on perçoit, inventer un rêve, mais un rêve accroché aux formes peintes, aux nuances des couleurs, comme le brouillard reste accroché aux arbres tout en s’élevant, finissant par se fondre dans le ciel. C’est pourquoi les finales sont magnifiques. Elles nous mettent au bord de l’extase, comme « les merveilleux nuages » dont parlait le poète, ce qui n’étonne pas, car Baudelaire est partout présent, Baudelaire ou quelqu’un de ses frères en poésie. Comme les poètes, Marie Sizun a le goût des enfants, des vies qui commencent, et aussi de celles qui n’en finissent pas de s’étirer. Elle aime les humbles, et les chiens, et tous les vivants que le chagrin humilie, que le malheur menace.
Pourtant, elle offre du bonheur, ce bonheur que donnent seuls les mots bien choisis, bien rangés, bien lustrés, car elle est une merveilleuse ménagère de la langue. Présentons quelques bijoux qu’elle a polis d’une main magicienne.
Par exemple, elle observe la démarche d’un homme, « sa façon de porter son corps, de s’y réfugier ». Quelle trouvaille que ce mot : se « réfugier » dans son corps ! il contient une histoire complète. Une petite fille boudeuse que sa mère ne comprend pas se réfugie, elle, dans son rêve, « la langue nouée de paroles non dites ». D’autres trouvent une oreille pour se raconter, bien vainement ; ainsi, une femme écoute les confidences d’une amie trompée « avec une sympathie factice, une sorte de gourmandise maligne, tandis qu’autour d’elles passe la foule. » Ces mots suent la solitude, et quelques-unes de ses causes : la méchanceté craintive, l’hypocrisie savourée, l’indifférence des agglutinés.
Quelques-uns des passages les plus réussis sont des descriptions de tableaux, déjà toutes frémissantes de la vie qu’on va nous y révéler. Ainsi de celle du Nuage blanc de James Ensor. « C’est le ciel en fait le maître d’œuvre, dans son immensité, ses caprices, sa folie, passant de l’azur édénique à une sombre fureur, avec pour tout signal de ce changement d’humeur ce fantastique, merveilleux et terrible nuage blanc, dressé comme une apparition. » On n’avait pas remarqué là-dessous ce que Marie Sizun nous fait voir : deux silhouettes féminines, « peut-être une vieille dame accompagnée de sa gouvernante », et le tableau s’anime : elles sont prises au dépourvu par « le brusque changement du temps », « elles veulent rentrer au plus vite, la plus âgée surtout, qui n’apprécie pas cette surprise, cette intervention de la force des choses, cet impérieux rappel à un ordre supérieur. » La lumière fantastique qui émane du nuage blanc scelle un destin, la toile en est vibrante.
Le talent de Marie Sizun ne s’est pas nourri des écrans. Une intelligence engourdie aux algorithmes ne peut que se mettre à suppurer, à délirer, avant de se déliter. Celle de Marie Sizun scintille.

