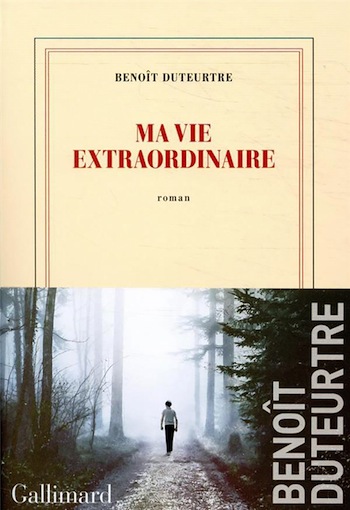Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr
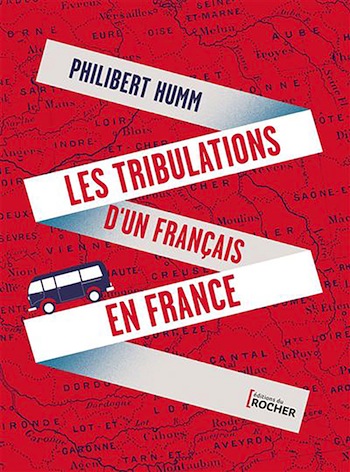
Pour se mettre en jambes, commençons par Les tribulations d’un Français en France de Philibert Humm (éd. du Rocher). Ce « média », pour parler comme les gens branchés, qui sont aussi jobards que le corbeau sur son « arbre perché », propose deux techniques de voyage sans grosses dépenses : un « tour du monde sans quitter la France », et l’auto-stop vers « n’importe où » pourvu que ce ne soit pas au-delà des frontières. Les deux procédés donnent de bons résultats.
Au moyen du premier, on découvre la Suisse à Clécy, l’Espagne à Coutances, la Toscane à Clisson, l’Amazonie à Queuille en Auvergne, Venise à Montargis, et quelques autres destinations exotiques que le regard et le style de l’auteur gardent très hexagonales. Quant à l’esprit qu’il faut avoir pour ces découvertes, une citation d’Alphonse Allais mise en épigraphe vous donne la potion magique : « Les voyages forment la jeunesse, mais ils déforment les chapeaux. » Certes, on ne porte plus guère de chapeaux comme ce fut la mode autrefois, mais c’est bien à la recherche d’une France oubliée que nous invite l’auteur, ce pourquoi il nous conseille de consacrer notre première visite au café, ce haut-lieu de la convivialité archaïque, pour la raison irréfutable, comme dirait Vialatte, qu’il croit « en la communion des comptoirs ». Puis, il engage la conversation avec la dame à sa fenêtre, parce qu’ « en France, où qu’on se trouve, il y a toujours une dame à sa fenêtre » ; on « tire le fil », et voilà qu’on découvre au bout « de petites histoires en dormance. Des romans que personne ne lira jamais. » On voit que ce qui intéresse Philibert Humm, ce sont les gens et leurs aventures, quitte à en inventer dont il serait lui-même le héros, afin d’amorcer la pompe à mensonges, en application du mystérieux principe qui fait que lorsque vous racontez des carabistouilles à des Français, vous produisez chez eux un besoin irrépressible de vous bourrer le crâne avec des craques, des légendes, des calembredaines, bref, des imaginations impératives.
Le même phénomène s’observe en faisant de l’auto-stop, mais avec des variantes qui obligent à se poser des questions existentielles. Parce que l’auto-stoppeur n’a le plus souvent rien à dire pour que son chauffeur serviable se mette à lui raconter des choses inouïes, dont il est impossible de savoir si elles sont véritables ou inventées, tant la vie de certains automobilistes ressemblent à s’y méprendre à des romans de ce genre américain que des demi-habiles appellent des road-movies, alors que chacun sait que les movies, ce sont des films ; bref, s’agit-il de balivernes calquées sur les romans picaresques, sur les romans d’initiation, sur les romans de pèlerinage, sur les légendes hollywoodiennes en carton-pâte, ou d’histoires véritables tellement extraordinaires qu’elles semblent tout droit sorties de l’imagination d’Alain-René Lesage, ou du fameux neveu de Rameau, dont Diderot fit le modèle inoubliable et définitif du parasite pour gens de lettres ? Nul ne saurait le dire.
Quoi qu’il en soit et dans tous les cas, l’auteur s’intéresse d’abord aux gens, et surtout à ceux qui, sortant de l’ordinaire, pourraient faire, presque sans fards ou déguisements, de véritables héros romanesques. Car ce que chante ce livre bourré de charmes, ce sont les pouvoirs de l’imagination, et la France qu’il nous propose de visiter, c’est un pays construit par les fantaisies de ses habitants, qui restent diverses en ayant toutes un air de famille. En effet, chaque petit coin a inventé sa légende, qui fonde ses traditions, et malgré une diversité étonnante, on est toujours en France, chez soi, et on finit son périple dans le bistrot où on l’a commencé, les conversations des habitués se poursuivant immuablement de telle sorte qu’on peut les reprendre au point où on les a laissées, même en revenant d’un petit tour de France « comme des bouchons de liège au fil de l’eau », qui reviennent toujours au rivage. C’est ça, voyager en France : rester chez soi, ou y revenir, sans voir de différence, à croire qu’on a attrapé la berlue.
Ce n’est pas tout-à-fait le point de vue de Benoît Duteurtre, mais on n’en est pas si loin dans son roman Ma vie extraordinaire (éd. Gallimard). Il commence par nous emmener dans les Vosges de son enfance, puis il nous promène au Havre, à Paris, et même à New-York, avant de nous ramener à ses Vosges qu’il ne reconnaît plus, tout en y retrouvant les traces évidentes de ses émois anciens. Car le sujet ici n’est plus exactement la balade, mais plutôt la mémoire des lieux, qui peut flancher elle aussi, ou plutôt jouer comme joue un vieux ferrement. D’ailleurs, Benoît Duteurtre nous confie qu’il aime encore plus les lieux que les gens, parce qu’il a un caractère de sauvage brouillé avec les chaussettes, un peu bizarre donc, ce qui ne l’empêche pas de nous conter ses amours et ses amitiés, et de nous dire enfin que les lieux ne sont donnés que par ceux que nous aimons y retrouver. D’où de magnifiques descriptions d’endroits qu’il aime, où le plus souvent il s’installe en parasite apprécié, parce qu’il est bon compagnon, gentil, cultivé, et qu’il a des tas de qualités qui le rendent de bonne compagnie. D’où « en même temps », comme dit Jupin le Petitounet, une galerie de portraits de personnages hauts en couleurs, ou simplement humains, qui lui ont donné de l’argent, dont il manquait souvent, des consolations, dont il a toujours été friand, des chances d’écriture ou de productions d’émissions, et donc des moyens de gagner de l’argent, ce pour quoi il reconnaît avoir gros appétit.
Tout cela ne l’empêche pas d’avouer qu’il y a en lui de la sottise, une forte dose d’incompétence pour les nécessités de la vie quotidienne – voir ses problèmes de chaussettes –, un goût immodéré des plaisirs de toutes sortes, et puis, plus profond, une sale bête qui ne supporte pas les autres, ceux qui viennent empiéter sur son territoire, ou simplement gêner la poursuite de ses plaisirs. Si bien que les gens qu’il aime, ce sont ceux en qui il devine la même bête insupportable, incivile, et cependant tellement intéressante d’être reconnaissable, de créer autour des gens une atmosphère séduisante, dans laquelle on rêve d’entrer, de se fondre, de vivre dans la même chaleur, la même extravagance, les mêmes passions.
Parce que ce qui compte dans les hommes, c’est leur folie, cette façon qu’ils ont de s’affirmer, insupportables et désirables, secrets et séduisants. Parce que les gens qui comptent le plus pour nous, ils nous sont donnés tels quels, ils s’imposent un jour, et souvent pour toujours, comme l’oncle Albert, comme Suzy Delair, comme tant d’autres essentiels, mais qu’il faut aussi savoir mettre à l’écart à l’occasion, alternant les visites et les fuites, établissant avec les plus proches des règles de distance qui les maintiennent aimables, comme une bonne cave écartée garde le vin savoureux, et même l’enrichit de puissances nouvelles.
Le regard de Duteurtre est le regard d’un curieux misanthrope qui ne peut se passer de ses semblables, au fond très proche de l’Alceste de Molière, qui vit dans les salons afin de pouvoir y déclamer sa haine des hommes, qui s’amourache d’une coquette pour mieux lui faire sentir combien elle perd à ne pas savoir le retenir. Et qui se retire au désert, ce qui signifie la campagne, pour mieux y apprécier combien les hommes lui manquent, exactement comme Duteurtre s’installe au Valtin pour mieux sentir ce qu’il a perdu de son enfance.
Car le fond de tout, c’est le chagrin de voir filer les choses, de tenter de les prendre au filet de l’écriture, et de constater que, de toute manière, elles y vieilliront jusqu’à devenir méconnaissables, avant d’y disparaître à jamais. C’est, je crois, le sens de cette nouvelle de science-fiction intitulée Le loup de Belbriette, éclatée en trois épisodes dispersés au fil du récit, dans laquelle le paysage est transformé, le temps est dispersé « façon puzzle », et où l’auteur laisse courir son désespoir, qui n’est supportable que de s’accompagner de la satire de notre monde et de ses folies les plus destructrices. On devine que l’écrivain a pris un plaisir malin – malicieux, et un peu mauvais – à inventer les effets pitoyables de ce qui travaille aujourd’hui nos sociétés, et plus encore d’en tirer un art de composer par fragments, acceptant joyeusement une « composition lacunaire », qui garde intacts les vides, les ignorances, plutôt que d’ajouter « de l’hypothétique au réel ».
Reste la beauté de la musique et du monde, le charme des êtres acceptés, des passions savourées, quand bien même elles seraient minoritaires et reconnues pour anormales, la mystérieuse séduction des lieux d’altitude, appartements au-dessus des gratte-ciels de New-York, ou surplombant l’entrée du port du Havre, maison des chaumes vosgiennes, ou « bistrot sur l’alpage », là où le temps s’arrête un moment, remonte jusqu’au passé qu’on entend soudain parler. Alors, « c’est comme si on planait au-dessus du monde en un lieu intemporel qui doit être le paradis. »