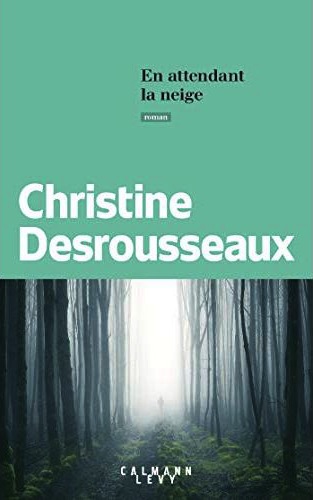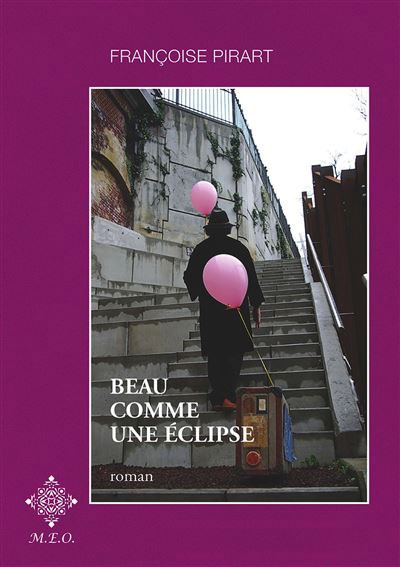Civilisation

Vauban pour toujours
1692, le duc de Savoie franchit le col de Vars, emporte Embrun, puis Gap. Louis XIV demande à Vauban de fortifier le Queyras.
Article consultable sur https://politiquemagazine.fr

Il y a des écrivains qui font des livres, et d’autres qui font de la littérature. Ceux qui font des livres ont des choses à dire, auxquelles ils tiennent ; ceux qui font de la littérature aiment dire, dire pour le plaisir, dire non pas n’importe quoi mais des choses qui sont quand même moins importantes que la manière de les dire – parce que pour eux la langue n’est pas un outil de communication, mais un matériau de création. Seuls ces derniers ont des chances d’immortalité, parce que seule la création est œuvre divine.

Pierre Jourde
Pierre Jourde a eu envie de nous raconter Le voyage du canapé-lit (éd. Gallimard), non pas parce qu’il s’agissait d’un événement essentiel, de quelque chose qu’il lui démangeait de faire partager au public, mais au contraire parce que ce voyage n’a pas vraiment d’importance, si ce n’est dans la vie de l’auteur, et encore. Mais cette anecdote, toute insignifiante qu’elle soit, peut servir d’occasion à produire un bel objet. Devant ce vieux meuble plutôt hideux, à l’évocation de son transport de Paris en Auvergne, l’auteur se frotte les mains à l’idée d’en faire une œuvre d’art. Il ne se pose pas la question de l’importance d’une telle entreprise, il se met à l’œuvre. Un artiste fait de l’art, en se moquant de ce que penseront les gens pratiques de son travail. Ce qui compte, c’est qu’il y ait un résultat, soit un objet achevé qu’on peut donner à contempler – ici, un livre à lire.
Mais comme l’artiste sait que la plupart des gens aptes à goûter son œuvre ont néanmoins rarement un accès facile à l’art, il va devoir leur faire croire qu’ils ont entre les mains une histoire intéressante, sur un objet remarquable, que l’auteur, un homme de grand talent et que les éditions Gallimard ont jugé bon de publier pour le prouver, va dévoiler sur sa vie des choses capitales. Bref, l’auteur doit faire croire qu’il est un journaliste de l’intime, qui informe le lecteur sur sa vie. Et en effet, Pierre Jourde nous apprend des tas de choses sur sa famille, ses ancêtres, ses phobies, ses rapports avec son frère, sa belle-sœur, son combat avec les objets… Bref, il fait semblant de se confier afin de nous permettre de savourer la manière dont il se confie.
Que le lecteur en effet ne se trompe pas : rien n’est intéressant dans ces confidences que la manière de les dire, de les placer, de les embrouiller au fil d’une narration, qui n’est pas décousue comme on pourrait croire, mais qui est merveilleusement tissée, brodée, ornée de cent façons. Embrouillée de façon si habile qu’elle en apparaît toute claire d’une lumière jamais vue. Ce n’est pas dans la camionnette de transport que se tiennent les conversations, c’est dans cette architecture de phrases qui s’élève au-dessus du vide qui sépare Paris de l’Auvergne, l’Auvergne de Vialatte et le Paris de Léon-Paul Fargue.
Un pont, un viaduc de fumées se construit sous nos yeux entre Paris et le village où le canapé doit se rendre, mais aussi entre le passé, les passés de l’auteur, les passés dont il se souvient, mais surtout ceux qu’il réinvente, ceux qu’il se remémore pour enfin les savourer autrement, comme on savoure une viande qui a été longuement préparée, qui a reposé, s’est alanguie à la chaleur du feu, s’est mêlée avec les aromates, le beurre, l’huile, le sel pour enfin se métamorphoser en cet objet inouï qui s’offre à la langue, aux dents, au palais afin de les enthousiasmer, puis de s’évanouir dans les profondeurs du corps qui se nourrit – je parle de viande pour honorer la mémoire des grands-parents de Pierre Jourde, qui étaient dans la boucherie.
Cependant, Pierre Jourde n’est ni boucher ni entrepreneur, il prétend poursuivre « la tradition familiale » de la récupération : « je passe dans les avenues de la littérature avec ma camionnette, ‘‘vieilles images, métaphores vermoulues, on prend tout, on ramasse tout.” Un coup de peinture, un peu de vernis, et hop, comme neuve, ne reste plus qu’à la revendre un bon prix. » C’est si bien fait qu’« on dirait du Bossuet. » Car l’autodérision permet de tout recycler, de s’amuser à faire le clown afin d’être plus discrètement profond, de finir avec une émotion bouleversante sur le « rendez-vous au cimetière », où finissent toutes nos routes.
Mais qu’importe que l’on devienne un « je ne sais quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue » si on peut laisser derrière soi une traînée d’étincelles qui enchantera les veilleurs de l’éternel été.
Grégoire Delacourt paraîtra d’abord plus sérieux. Ne traite-t-il pas d’un sujet d’actualité brûlant dans son dernier roman Mon Père (éd. Jean-Claude Lattès) ? La pédophilie dans l’Église, c’est un sujet grave, douloureux. Mais Grégoire Delacourt en véritable artiste évite tous les pièges du romantisme recyclé, comme dirait Pierre Jourde. Il saisit l’occasion de ce drame pour faire une œuvre d’art, et le drame en prend de la grandeur, de la dignité, de la hauteur, de l’humanité surélevée. Car l’art n’appauvrit pas, ne dégrade pas. Il agrandit, il sublime, et nous oblige à monter avec lui, au lieu de descendre sur la trace de nos passions basses.
Le coup de génie de l’artiste, c’est de raconter une pauvre histoire en la replaçant dans la perspective biblique, en la tissant avec l’histoire fondatrice du sacrifice d’Abraham. Vous vous souvenez ? Le père des croyants prend son fils Isaac, un fagot, un couteau et s’en va pour l’égorger en victime offerte à Dieu. À l’instant où le couteau va frapper, Dieu arrête la main du père et lui propose à la place de son fils un bélier. Grégoire Delacourt, bouleversé par ce récit, se demande comment un père peut faire ça à son fils, comment un fils, même épargné, surtout épargné, peut vivre avec ce souvenir-là, sans rien dire, sans rien réclamer. Dans le silence. Ce silence qui est si bien à sa place dans les églises, qui sont pourtant les lieux où la Parole doit être proclamée.
Alors il construit la scène tragique où le père d’un enfant abusé vient demander des comptes au prêtre dans son église. Un huis-clos violent, tendre, un huis-clos de paroles fracassées, de silences contournés, un huis-clos pour tenter d’approcher la grandeur de cette tragédie : l’homme peut faire le mal absolu à l’enfant qui lui est confié ; tandis que le père, bêtement confiant, ne voit rien, s’avère incapable de protéger son enfant. Alors, dégrisé par tant de cruauté, il hurle sa douleur, il demande qu’on lui parle enfin. Mais la parole est à la fois donnée et refusée, donnée parce qu’il y a confession, refusée parce que la confession est menteuse, non par vice, mais par un secret mystérieux, qui a peut-être à voir avec l’esprit de sacrifice. De même que pour vaincre la mort il a fallu que le fils de Dieu meure, pour vaincre le Père du mensonge il convient de le ficeler de paroles trompeuses, troubles, incertaines – que lui-même enfin se perde dans les labyrinthes de la parole faussée.
Tout cela, sans pathos, sans pleurnicheries, sans morale de ces patronages odieux, qu’ils soient tenus par des laïcards féroces ou par des curés sentimentaux dont les coulures larmées ne sauvent rien. Tout cela avec la puissance d’un verbe contrôlé, tenu à bout de plume, sans jamais faillir, sans jamais faiblir. Car si les hommes sont pécheurs, l’artiste doit être sans défaut. Il faut qu’il se tienne, et tienne son sujet. Grégoire Delacourt parvient à la prouesse, comme Julien Green ou comme Bernanos. Mieux peut-être de ce qu’il est plus sec, plus nerveux, plus tranchant – plus mystérieux. Car le secret de l’art, c’est le mystère qu’il rend sensible en le voilant parfaitement, qu’il place dans le temple de son chef-d’œuvre, derrière le voile que seule la lecture déchire – sans le déchirer.
La littérature n’a rien à dire d’actuel, elle nous élève sur la montagne où la parole se grave par le feu sur la pierre, où les mots prennent la pesanteur de la grâce.
Illustration : Grégoire Delacourt