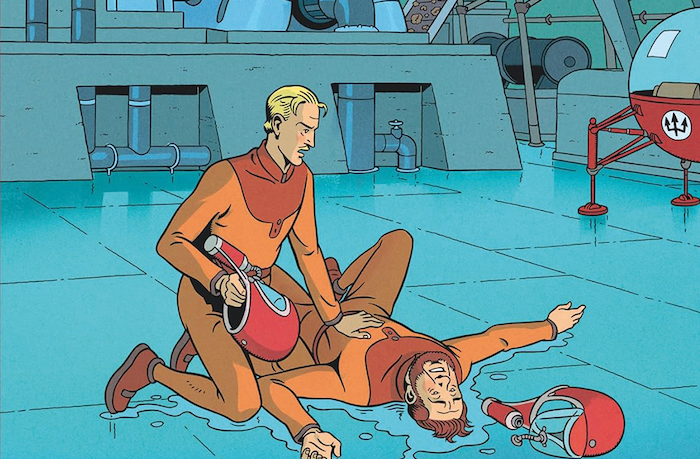Et foin des écrivaines, autrices et autres chimères lexicales. L’écrivain est un maître artisan capable de sertir son âme dans sa langue, et il n’y a pour ergoter sur son sexe que des byzantins étourdis par les miasmes de la barbarie montante. Je louerai donc deux plumes magistrales, Françoise Pirart et Christine Desrousseaux.
Françoise Pirart nous envoie de Belgique son nouveau roman, Beau comme une éclipse (éd. M.E.O., Bruxelles), un texte à savourer toutes affaires cessantes. On a rarement l’occasion de se plonger avec autant de plaisir dans un livre dont la langue est un festival d’inventions, de drôleries, de réussites en tous genres. Il nous offre un univers de mots créé avec une surprenante aisance : on y entre comme on se souvient d’avoir été un enfant ébloui. Cela tient à la maîtrise avec laquelle Françoise Pirart est entrée dans l’âme de son héros, Albien, un jeune homme que l’on croit lunaire, et qui s’avère un grand vivant autant qu’un inattendu maître de vie.

Françoise Pirart
Albien a une grand-mère bigote, une mère adorable et stupide, un oncle aussi délicieusement émouvant qu’un grand vin qu’on déguste à la fraîcheur noire de la cave vigneronne. Cet enfant a vite compris qu’il fallait être deux pour entrer dans la vie par la belle porte, non pas deux avec un autre, mais deux à soi tout seul, c’est-à-dire avoir un personnage pour la vie ordinaire, et garder l’autre, le génie qui enchante le cœur, pour les grands moments. Ce n’est pas toujours facile, tant les gens qui croient vous connaître ont vite fait de prétendre avoir entrevu ce que vous cachez, et de penser pouvoir conclure que vous êtes timbré. Qu’importe ! Albien garde son courage, son appétit de vivre, son goût de l’aventure, et il en est merveilleusement récompensé, parce que la vie est simple et généreuse, elle offre à profusion le bonheur à celui qui sait le prendre où il est, dans l’herbe, chez les insectes, dans les rêves et les élans du cœur.
Dès l’école, Albien tombe en amour : la petite Esther lui paraît la merveille la plus céleste qui puisse être. Mais les parents ignorent ce qui exalte leurs enfants ; Esther est emmenée au loin par ces ahuris ; les enfants s’écrivent ; la dernière lettre d’Esther est postée d’Écosse. Esther est désormais écossaise pour l’éternité.
L’autre rêve d’Albien, c’est de partir, d’entreprendre le grand voyage. Son oncle juge d’abord qu’il n’est pas prêt. Puis, quand il décidera qu’il est un homme, il l’enverra au fond d’une Afrique de légende faire commerce de vins d’Alsace. Entreprise titanesque qui ne rebute pas le prodigieux héros. Vous le suivrez dans un périple de poète dont je ne vous dirai rien : les livres sont faits pour être lus, et quand ils sont aussi réussis que celui-ci, tout lecteur qui passe à côté n’est qu’un malheureux – étymologiquement : celui qui vient à la male heure, la mauvaise heure, quand les astres sont défavorables. Car il faut que la cruauté du sort s’acharne sur un homme pour le faire échapper au bonheur de lire Françoise Pirart.
Albien a le don de croire à la vérité des choses comme elles sont. C’est bien sûr ce don qui déchaîne la sotte inventivité des imbéciles ordinaires, mais c’est ce don qui ouvre le cœur des êtres capables d’aimer la vie et leurs frères humains. Ainsi la merveilleuse Mevrouw Rita, propriétaire des Jasmins et gardienne immortelle des merveilles de l’enfance, qui chante si joliment le vent du nord qui emporte les souvenirs et les regrets dans « la nuit froide de l’oubli » qu’on « dirait une jeune fille surprise par son amoureux », et qui apprendra au vieux gamin qu’on peut prononcer « les mots interdits » sans que le monde s’écroule.
Mais ce qui m’enchante encore plus chez ce poète d’Albien, c’est la fréquentation assidue et familière qu’il a avec « Monsieur de La Bruyère » et qu’il s’interroge avec lui « sur le moyen de demeurer immobile où tout marche et de ne pas courir où les autres courent. » Ah ! Monsieur de La Bruyère ! qu’il fait bon vous rencontrer sur une plage belge, à quelques détours de la prose enchantée de Françoise Pirart, toute miroitante des reflets d’une âme enluminée !

Haut-Jura sous la neige.
Christine Desrousseaux, elle, nous invite à prendre le temps. En attendant la neige (éd. Calmann-Lévy) est une belle histoire d’ombres et de soleil. Véra, son héroïne, va mal. Elle s’est sortie bien amochée – esquintée comme dit si joliment le langage des humbles – d’un accident de voiture où sa mère a trouvé la mort. Sa sœur Mathilde s’en tire indemne, tandis que Véra, qui conduisait, boite et a de graves séquelles psychologiques, pour lesquelles elle doit prendre un traitement qui l’abrutit. Ce qui la ruine le plus, c’est qu’elle se juge coupable de la mort de sa mère, puisqu’elle conduisait et qu’elle a peut-être commis une imprudence : peut-être, puisqu’une amnésie partielle l’empêche de se souvenir des circonstances exactes de l’accident.
Elle pense qu’elle saurait si elle cessait de prendre les médicaments qui l’assomment, et afin de le faire sans que sa sœur l’en empêche, elle part se cacher dans un chalet perdu du Haut-Jura, au moment où la mauvaise saison approche, qui pourrait bien tout emmailloter de neige. La gardienne des clés du chalet, bougonne, taiseuse, ne rassure pas. L’unique chalet voisin est occupé par un curieux personnage, serviable mais distant. Au village où Véra descend se ravitailler, elle découvre un bar étrange, où le patron passe l’ennui en se rêvant trappeur ; il a créé un groupe de passionnés de grandes prairies, qui se réunissent pour évoquer la vie des indiens d’avant le Far-West d’Hollywood, se déguiser, jouer comme des enfants sur le sentier de la guerre.
Dans ce cadre troublant, Véra qui a du cran retrouve bientôt la clarté de ses pensées, son appétit de vivre. La rudesse des lieux et de leurs habitants oblige à la justesse. Peu à peu, chacun se laisse aller à se livrer. Le monde s’éclaire d’humanité, de gentillesse, de son lot de drames : le voisin a lui aussi perdu un être cher, dont il croit avoir retrouvé la trace dans cette région morne. Les destins se flairent, s’apparient, favorisent les liens, qui restent cependant difficiles : il n’est guère aisé d’entrer en relation quand la souffrance rend aussi farouche que les bêtes de ces régions écartées.
L’intrigue est tellement bien ourdie qu’il est impossible d’en dire plus sans la dévoiler, et tuer le plaisir du lecteur. Car dès les premières lignes, on est saisi par le texte, on ne le lâche plus, les personnages deviennent des amis qu’on a l’impression de connaître depuis toujours, de reconnaître après un long oubli dû aux malheurs de l’existence. Or, c’est précisément le thème et l’essence de l’action : les choses oubliées contre lesquelles on se heurte longtemps, aussi terriblement que le prisonnier mis au secret se heurte aux murs de sa cellule. Ainsi le lecteur se trouve mystérieusement placé à l’endroit où se trouvent les personnages : dans ce lieu circulaire comme une cage où on ne sait plus que tourner en rond, dans l’inutilité d’un questionnement sans fin et sans aucune réponse satisfaisante.
Le soulagement sera donc aussi grand pour le lecteur que pour les personnages, quand ils passeront le Rubicon de la vérité reparue. Soulagement de savoir, douleur d’avoir à vivre avec ce qu’on vient de se réapproprier. Car la vie est tragique dans tous les cas ; jouer aux indiens ne sauve personne de la guerre et de la mort. Pourtant, le dire, l’entendre dire est un bonheur : le bonheur d’avoir à se tenir debout dans la dignité retrouvée, la dignité que donne la vérité, horrible, mais juste, puisque tout ce qui arrive est juste d’avoir été voulu. Christine Desrousseaux est une âme droite, avec des plumes – et des ailes.
Beau comme une éclipse, Françoise Pirart, M.E.O., 2019, 176 pages, 16 €
 En attendant la neige, Christine Desrousseaux, Calmann-Lévy, 2019, 288 pages, 17,90 €
En attendant la neige, Christine Desrousseaux, Calmann-Lévy, 2019, 288 pages, 17,90 €





 En attendant la neige, Christine Desrousseaux, Calmann-Lévy, 2019, 288 pages, 17,90 €
En attendant la neige, Christine Desrousseaux, Calmann-Lévy, 2019, 288 pages, 17,90 €