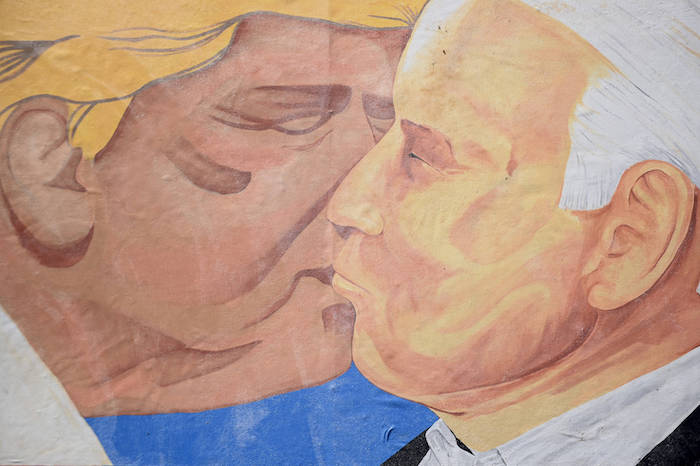On se souvient du long débat autour de la question des racines chrétiennes de l’Europe, et de l’opportunité d’évoquer ces dernières dans les textes constitutifs de l’Union. À l’époque, il se trouva beaucoup de bonnes âmes pour se scandaliser de la lâcheté de gouvernants qui, malgré leurs convictions religieuses et en dépit de leurs promesses réitérées, refusèrent de faire mention de ces racines. Pourtant, réflexion faite, on doit convenir qu’ils n’avaient pas tout à fait tort, bien qu’ils n’en aient peut-être pas eu conscience.
Il faut en effet savoir ce dont on parle. De quelle Europe ? S’il s’agit de l’Europe comme culture et civilisation, de l’Europe historique, alors il serait absurde d’en nier les racines judéo-chrétiennes, de même que les racines gréco-latines : ceci reviendrait à refuser l’évidence et à faire comme si cette civilisation venait de nulle part. Si en revanche on parle, non pas de cette Europe-ci, mais de celle qui s’affiche désormais sur les façades de tous nos bâtiments publics, la « communauté » puis l’ « Union européenne » construite à partir des années 1950, alors la question se pose tout autrement. Et l’on peut effectivement contester que cette Europe-là ait des racines chrétiennes.
Sans doute cette dernière est-elle bien née dans le cadre christianisé de l’Europe civilisation, et elle a été mise en place par des hommes eux-mêmes issus de la tradition chrétienne. Mais cela ne suffit pas pour en déduire qu’elle aurait par conséquent et de ce fait des racines chrétiennes, puisque l’on pourrait dire la même chose, au fond, de la pizza, de la bicyclette ou du cinématographe (etc.). Il faut bien noter que les convictions chrétiennes de ses fondateurs n’ont jamais été expressément affirmées, ni dans les textes constitutifs des communautés européennes, ni à l’occasion des consultations électorales auxquelles la construction a donné lieu, ni a fortiori dans la manière dont elle a été organisée, dans ses principes, ses valeurs et ses projets. Et c’est justement en scrutant ces derniers que l’on en vient à découvrir les racines probables de cette construction. Des racines assumées, du reste, par certains de ceux qui furent les véritables maîtres d’œuvre du chantier européen, en particulier Jean Monnet ; des racines qui, même s’il faut prendre quelques précautions lorsque l’on tente d’établir ce type de généalogie, paraissent moins chrétiennes que saint-simoniennes, du nom de ce courant intellectuel né dans les années 1820, qualifié par Karl Marx de « socialisme utopique », mais dont on reconnaît aujourd’hui qu’il irrigue, outre l’union européenne, une part significative de ce que le président Macron se glorifie d’appeler le « progressisme ».
Le dépérissement du politique
Le primat de l’économie sur le politique constitue, depuis les balbutiements de la construction européenne, depuis les traités de Paris en 1951 et de Rome en 1957, le premier pilier du système : or, on y reconnaît la trace de la fameuse Parabole[1] où Saint-Simon, en 1819, imagine ce qui résulterait de la disparition subite, du jour au lendemain, des 3000 « hommes de génie » qui animent l’économie nationale. Sans eux, sans ces 1750 artisans, 600 cultivateurs, 200 négociants, 450 savants et artistes, d’un seul coup, la nation ne serait plus qu’« un corps sans âme » ; à l’inverse, que résulterait-t-il de la disparition des 30 000 dirigeants du clergé et de l’État, de l’ensemble des parlementaires, des magistrats, des militaires, etc. ? « Aucun mal politique pour l’État », au contraire. Pourquoi ? Parce que ces 30 000 « frelons », qui ne produisent rien mais se nourrissent des richesses du pays, lui sont finalement aussi nuisibles que lui sont indispensables les 3000 « abeilles » précitées. Economique d’abord.
Du côté de la construction européenne, comme chez Saint-Simon, le primat de l’économie n’est donc pas simplement d’ordre chronologique, comme on le dit parfois, et s’expliquant par le fait qu’il serait plus facile de commencer par là afin d’arriver peu à peu, par petits pas, jusqu’au politique, c’est-à-dire, jusqu’à la construction d’un ensemble fédéral dont l’économie ne serait que l’instrument. Dans les deux cas, c’est l’économie qui prime, parce que c’est elle qui compte.
Non point qu’il n’y ait aucune dimension politique dans la construction européenne. Mais comme chez les saint-simoniens, celle-ci n’est en réalité qu’une politique de la disparition du politique : une politique du dépérissement des singularités nationales, des identités, des souverainetés et donc des Etats, et avec eux des conflits et des guerres, que l’on prétend surmonter en les absorbant au sein d’un ensemble intégralement voué à la réalisation du bien-être et au développement industriel : les États-Unis d’Europe. Cette expression célèbre est parfois attribué à Victor Hugo, qui la prononça en 1849. Mais Hugo, passé par le saint-simonisme comme bon nombre de romantiques, connaissait sans doute le petit ouvrage où Saint-Simon en exprime l’idée, De la réorganisation de la société européenne ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples de l’Europe en un seul corps politique (1814). C’est du reste l’un des principaux disciples de Saint-Simon, Charles Lemonnier, qui va populariser le terme en donnant ce nom, Les États-Unis d’Europe, à un journal qu’il dirige, puis en lui consacrant un essai retentissant[2] – avant qu’il ne soit repris par les pères tutélaires de la construction européenne, de Jean Monnet à Valéry Giscard d’Estaing.
Quant à ces « États-Unis d’Europe », ils sont d’abord conçus, par les saint-simoniens comme par leurs lointains héritiers, comme un système où la politique se contente d’être « la science de la production[3] », et d’assurer, pour reprendre le mot célèbre de Frédéric Engels paraphrasant Saint-Simon, non plus le « gouvernement des hommes », mais l’ « administration des choses ».
La disparition des patries
Pour pouvoir instaurer la primauté de l’économie et aboutir au dépérissement corrélatif du politique, il faut faire disparaître les différents éléments de la « polis » : les frontières, les différences juridiques et culturelles, les particularismes et, au bout du compte, les anciennes « patries ». En 1841, Michel Chevalier, l’un des chefs de l’école saint-simonienne, affirme, afin de démontrer que l’unité européenne ne relève plus « du domaine […] de l’utopie », que « partout en Europe aujourd’hui, il y a une telle similitude de sentiments et de mœurs, de pensées et d’études, d’habitudes et de travaux, une telle solidarité d’intérêts, une telle communauté de penchants, on s’est tellement mêlé par les relations d’affaires, de sciences et de plaisir, que l’Europe ne forme plus qu’une seule famille. »[4] Face à cette union en train de s’accomplir, il faut récuser ce qui pourrait y faire obstacle, « le patriotisme rétrograde et barbare » qui s’attache aux formes anciennes. La vraie, la seule patrie, c’est désormais l’Europe. A ce propos, on peut noter que Saint-Simon évoque dès 1814 l’émergence d’un « patriotisme européen » : anticipant par là-même la thématique du « patriotisme constitutionnel » développée par le philosophe allemand Jürgen Habermas. C’est ce concept qui, récupéré à partir des années 1990, va servir à démontrer que, dans le cadre post-national de l’après-Maastricht, l’absence d’un « peuple européen » n’empêche pas l’apparition d’une citoyenneté, d’un patriotisme spécifique et même d’une forme de démocratie construite sur le droit, indépendamment des enracinements et des peuples existants.
L’avènement des technocrates
Autre présupposé du primat de l’économie, l’avènement d’une technocratie, qui semble seule adaptée au projet : car pour « administrer les choses », il faut bien des administrateurs…
Sur un plan institutionnel, dans le cadre de la construction européenne, cette idée se traduit à la fois par le rôle déterminant de la commission, groupe d’experts jouant le rôle de l’exécutif dans un régime parlementaire, mais aussi par l’omniprésence d’une fonction publique pléthorique et surqualifiée ; le seul organe issu du suffrage universel, le parlement, réunit quant à lui des amateurs plus ou moins éclairés, et n’a en toute hypothèse qu’un rôle limité dans la gouvernance européenne. Saint-Simon, l’inspirateur, écrivait à ce propos qu’il fallait un système où « les intérêts généraux seraient dirigés par les hommes les plus capables dans les sciences d’observation, dans les beaux-arts et dans les combinaisons industrielles : système social le meilleur auquel l’espèce humaine puisse atteindre[5]. » Quant au parlement qu’il imaginait pour l’Europe, il le voyait composé exclusivement de négociants, d’industriels et d’administrateurs, tel que le sera plus tard la commission européenne. La construction rationnelle de l’unité européenne exige le règne des experts, et discrédite toute autre forme politique, y compris issue du suffrage universel[6].
Le dépassement des religions
Dans son Europe à lui (comme dans la nôtre), si l’on tolère les religions au nom de la « liberté de conscience », c’est à condition qu’elles se plient à un « code de morale » qui sera « rédigé par les soins du grand parlement » dans le but d’ « être enseigné dans toute l’Europe » à tous les citoyens, ce qui correspond trait pour trait à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne désormais intégrée dans le droit positif par le Traité de Lisbonne. C’est ce code qui se trouve, si l’on peut dire, tout au sommet de la pyramide normative : ce qui implique, précise encore Saint-Simon, que l’on réprimera les religions « dont les principes seraient contraires au grand code de morale qui aura été établi ». Dans leur forme actuelle, les religions ne sont que les reliquats archaïques d’un passé révolu, qu’il faut soumettre à la morale nouvelle des droits de l’homme.
Le triomphe de l’industrie
C’est également dans le saint-simonisme, utopie de polytechniciens et de financiers, que s’enracine la vision industrialiste de la construction européenne. C’est à cette même perspective que s’attache un siècle plus tard le saint-simonien Jean Monnet, lorsqu’il prend la tête de la communauté européenne du charbon et de l’acier entre 1952 et 1955, avant de créer le Comité d’action pour les États-Unis d’Europe. Dans le système de l’avenir, écrivait Saint-Simon en 1825, il faudra faire réaliser « par les savants, par les artistes et les industriels, un plan général de travaux à exécuter pour rendre la possession territoriale de l’espèce humaine la plus productive possible et la plus agréable à habiter sous tous les rapports ». A cet égard, le saint-simonisme systématise une tendance déjà présente dans les utopies antérieures, la primauté absolue de l’agir humain sur la nature, et l’arraisonnement, l’instrumentalisation sinon la disparition de celle-ci, au nom de « l’accroissement » illimité « du bien-être de l’espèce humaine », qui constitue l’unique finalité du politique.
L’entrée dans l’âge d’or
Enfin, même si là encore Saint-Simon est l’héritier d’une tradition utopique plus ancienne, c’est chez lui puis chez ses successeurs que l’Europe, grâce au Progrès, est désignée comme devant devenir le lieu de la paix perpétuelle et d’une prospérité indéfiniment croissante : c’est d’ailleurs sur ce point que se conclut l’opuscule de 1814 : « il viendra sans doute un temps où tous les peuples de l’Europe sentiront qu’il faut régler les points d’intérêt général, avant de descendre aux intérêts nationaux ; alors les maux commenceront à devenir moindres, les troubles à s’apaiser, les guerres à s’éteindre ; c’est là que nous tendons sans cesse, c’est là que le cours de l’esprit humain nous emporte ! […] L’âge d’or du genre humain n’est point derrière nous, il est au-devant, il est dans la perfection de l’ordre social […]. » C’est-à-dire, dans la construction de cette Europe unifiée, progressive, régie par les technocrates et vouée à la maximisation du plaisir et du bien-être individuel.
Hélas, on ne sait que trop bien où risquent de mener les utopies : qui veut faire l’ange fait la bête… Avant de conduire à la construction de l’Union européenne, celle des saint-simoniens hésita, dans les années 1830–1860, entre le sectarisme délirant et le ralliement pur et simple au grand capital puis au despotisme napoléonien, et elle inspira certains des grands systèmes totalitaires du XXe siècle. Sans doute pourra-t-on répondre pour se consoler que l’on ne ressemble pas forcément à ses parents : toujours est-il que l’Europe a de qui tenir.
[1] Parabole de Saint-Simon, 1819, Paris, Everat, 1832.
[2] Ch. Lemonnier, Les États-Unis d’Europe, Paris, Librairie de la bibliothèque démocratique, 1872.
[3] Cl. de Saint-Simon, Œuvres complètes, Paris, Anthropos, 1966, t.1er,p. 188.
[4] M. Chevalier, Les fortifications de Paris, Paris, Gosselin, 1841, p. 14
[5] Cl. de Saint-Simon, Nouveau christianisme, dialogue entre un conservateur et un novateur, Paris, Bossange Père, 1825, p.68
[6] M. Chevalier, A Tous, Paris, A la librairie saint-simonienne, avril 1832, p. 13 : « On sait ce que vaut l’aune d’un suffrage universel »…